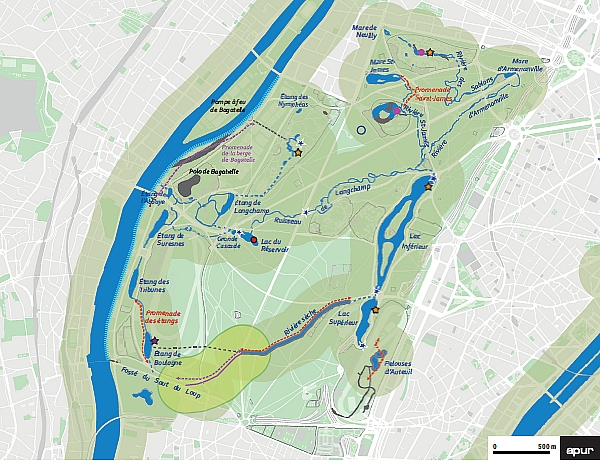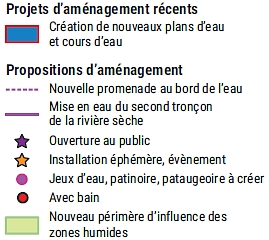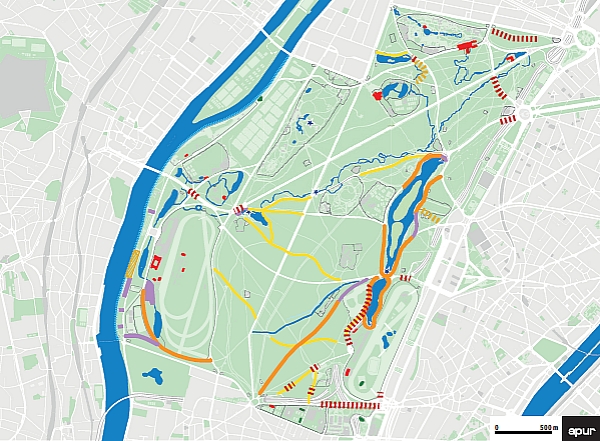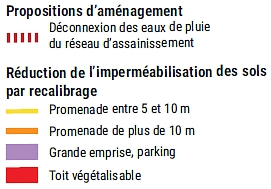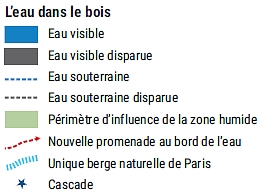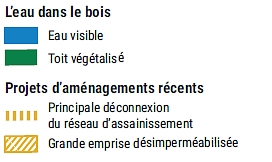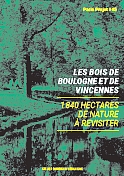|
Les
bois de Boulogne et de Vincennes sont deux espaces de respiration uniques,
situés au cœur du Grand Paris. Représentant à
eux deux près du quart de la surface du Paris urbanisé,
les deux bois occupent un espace équivalent aux huit premiers arrondissements.
Ils sont fréquentés
par des habitués mais sont encore méconnus par beaucoup
d’habitants. Une grande diversité d’usages existe :
pour certains, ils représentent des axes de circulation rapide,
pour d’autres le plaisir du footing dans les allées, de la
promenade et pique-nique sous les arbres, du canotage sur les plans d’eau…
Les Charte du bois de Vincennes et de Boulogne, signées en 2003,
ont constitué un cadre précieux, en définissant quatre
axes majeurs pour structurer un projet ambitieux d’aménagement
durable des bois : réhabiliter les paysages et restaurer les milieux
naturels ; réduire fortement la circulation automobile pour une
promenade tranquille ; reconquérir l’espace public des bois,
et gérer
les activités dans la cohérence et la transparence ; et
enfin innover dans les modes de gestion et de gouvernance.
| Valorisation
et extension de la trame d’eau |
 La
Grande Cascade
La
Grande Cascade
©
doc. Apur in : Les Promenades de Paris, A. Alphand |

Vue
du pont des Îles
©
doc. Apur in : Les Promenades de Paris, A. Alphand |
|
La
valorisation de la ressource en eau dans les bois constitue
un enjeu majeur, qui prend des formes diverses : patrimoniale,
paysagère, environnementale, écologique, d’usages.
L’investissement esthétique et technique, comme
la diversité des usages liés à la présence
de l’eau, témoignent de son importance pour les
concepteurs et les gestionnaires des bois.
Au XIXe siècle, l’eau est avant tout synonyme de
plaisir. Elle est le fil conducteur du promeneur guidé
vers les séquences et points de vue les plus pittoresques
du bois y portant partout le mouvement et la fraîcheur
(Les Promenades de Paris, Alphand). Le
traitement des berges, des biefs, ponceaux et cascades participent
de la cohérence paysagère d’ensemble. Les
activités liées à l’eau contribuent
à l’attractivité, les pratiques des uns
sont le spectacle des autres : embarcadères et canotage
sur les grands lacs, patinage en hiver. L’eau contribue
aussi au décor et au succès des chalets et des
restaurants implantés sur des îles, près
d’un petit plan d’eau ou d’une cascade. Enfin,
l’eau est nécessaire à l’entretien
des routes, ainsi qu’à l’arrosage des pelouses
et des massifs plantés.
Les premiers grands travaux dans le bois de Boulogne en 1853
consistent ainsi à creuser les grands lacs et à
tracer les voies pour les mettre en valeur. Le succès
de ces aménagements conduit au creusement de nombreuses
pièces d’eau et ruisseaux. La trame de surface
et le réseau d’arrosage y seront d’ailleurs
plus développés qu’à Vincennes. L’emprise
même du bois sera modifiée pour lui donner la
Seine comme limite et non cette affreuse clôture
(Mémoires du baron Haussmann).
Les échanges fonciers avec Boulogne et Neuilly en seront
le prix.
Ces aménagements témoignent d’une grande
maîtrise de la topographie. À partir de points
hauts, le lac Supérieur, l’eau du réseau
s’écoule de façon gravitaire en pente douce
et par des surverses agrémentées de cascades.
En point bas, des rejets se font en égout, et en Seine
à l’aval de la passerelle de l’Avre, via
l’ouvrage du Saut du Loup, et à l’aval du
pont de Suresnes, depuis l’Étang de l’Abbaye.
Quand bien même l’eau ne représente que 27
ha - hors Seine - dans le bois de Boulogne, les plans d’eau
visibles sont très plébiscités par les
promeneurs comme en témoigne l’enquête effectuée
: 58 % indiquent se rendre au bord de l’eau.
Le
cycle de l’eau aujourd’hui
Si
l’alimentation des lacs et des rivières et une
partie de l’arrosage se fait toujours à partir
du réseau d’eau non potable (ENP) de la Ville de
Paris, les modes d’alimentation et l’ossature du
réseau enterré ont évolué depuis
le XIXe siècle. Des modifications de la trame d’eau
de surface sont aussi intervenues. L’eau potable alimente
certains plans d’eau, et elle est parfois utilisée
pour l’arrosage des pelouses, des parcs et jardins ou
des équipements sportifs.
L’alimentation
de la trame d’eau
L’Eau
Non Potable est délivrée à plusieurs points
d’entrée par Eau de Paris, mais le réseau
d’ENP reste géré dans les
bois par la DEVE. Pour conserver un écoulement correct
et une eau de qualité, la trame d’eau requiert
un entretien régulier par la DEVE, comme la réfection
de l’étanchéité et le curage des
rivières et des plans d’eau, indispensable pour
assurer un bon écoulement et la qualité de l’eau.
Mais le curage des lacs, plus coûteux, est parfois différé.
Des analyses de qualité de l’eau sont effectuées
chaque année sur les lacs.
La
trame d’eau de surface consomme environ 80 % des volumes
d’eau non potable entrant dans les bois. L’apport
d’eau pluviale, direct ou par ruissellement, est marginal.
Les importantes fluctuations, observées d’un jour
ou d’une saison à l’autre, s’expliquent
par les principales utilisations de l’ENP : maîtrise
des niveaux des plans d’eau et des rivières, arrosage
selon les besoins. Globalement, les apports sont augmentés
en périodes sèches et chaudes, et réduits
en périodes pluvieuses ou hivernales.
Le
bois de Boulogne est aujourd’hui alimenté en ENP
par cinq arrivées : Auteuil-Molitor, Tolstoï, Passy,
Colombie et Maillot. Elles sont approvisionnées, via
le réservoir de Passy, par l’usine d’Auteuil,
qui pompe ses eaux en Seine.
Le réseau enterré d’ENP se compose de 73
kilomètres de canalisations.
Il est maillé, ce qui lui confère une certaine
sécurité de distribution. La pression, globalement
satisfaisante, varie de 1 à 3 bars, mais en été,
2,5 à 3 bars sont nécessaires, avec une augmentation
d’environ 20 % des besoins.
La
trame d’eau du bois de Boulogne est soumise à une
hausse des températures en été. L’écoulement
insuffisant, à cause de l’envasement et des algues,
s’accompagne de mauvaises odeurs et de botulisme ,qui
affecte surtout les poissons et les canards. Cette situation
est en partie due au retard de curage des grands plans d’eau
: aucun depuis 1941 pour le lac Inférieur. En l’absence
de curage des lacs, des solutions palliatives sont mises en
place l’été, en particulier un renouvellement
d’eau plus rapide par une augmentation des débits.
Le réseau d’ENP fonctionne alors à son maximum.
L’alimentation
du bois a dû être réorganisée du fait
de la fermeture de l’usine d’Auteuil en 2022. Dans
la perspective d’une optimisation du réseau d’ENP,
la capacité maximale théorique d’alimentation
reste à préciser et à garantir. Elle était
estimée à 28 000 m³/
jour en 2010-2011.
En
surface, la trame d’eau du bois de Boulogne se compose
de 10 km de rivières reliant 14 plans d’eau qui
couvrent environ 27 ha. Ce réseau hydrographique gravitaire
de 23 m de dénivelée est alimenté depuis
les lacs Supérieur et Inférieur. Il est formé
de trois zones :
-
celle du Jardin d’Acclimatation, constituée de
la rivière et de la mare d’Armenonville, de la
rivière des Sablons et de la mare de Neuilly ;
-
celle de Saint-James, comprend la rivière et la mare
Saint-James, et les lacs du Tir aux Pigeons ;
-
la troisième zone regroupe les autres plans d’eau
: les étangs de Bagatelle, de Longchamp
et de l’Abbaye et leurs rivières de jonction,
le ruisseau de Longchamp, le réservoir de la Grande
cascade, la rivière du Moulin de Longchamp et les trois
étangs de la plaine de Longchamp : Suresnes, Tribunes
et Boulogne.
La
totalité de ces eaux est aujourd’hui déversée
en égout via différents collecteurs.
Dans
le bois de Boulogne, certains plans d’eau ont été
modifiés depuis le XIXe siècle, en particulier
à l’intérieur des concessions, d’autres
ont disparu.
Le sens d’écoulement dans les étangs de
la Plaine de Longchamp a été inversé, et
un ruisseau, au cœur du massif forestier, a en partie disparu.
Le lit de la Seine a aussi été modifié
en aval du pont de Suresnes, lors du comblement du bras séparant
l’île de la Folie de la berge du bois, désormais
occupée par le camping.
L’arrosage
L’arrosage
constitue la principale autre utilisation de l’ENP. Il
demeure nécessaire dans les espaces jardinés d’accès
libre et pour les jeunes arbres, de secteurs forestiers ou d’alignement.
Dans les autres emprises, l’arrosage reste en service
dans les parcs et jardins, les concessions et certains équipements
sportifs. La certification ISO 14001 vise à favoriser
l’usage de l’ENP par rapport à l’AEP.
L’utilisation de l’ENP devrait donc être privilégiée
lorsqu’une eau de qualité potable n’est pas
nécessaire, en évaluant l’impact sur les
consommations et les coûts. Cela concerne les espaces
naturels, les concessions, et les nouveaux projets où
elle est fréquente, mais pas systématique.
Dans
le bois de Boulogne, le système d’arrosage à
l’ENP a été plus développé
au XIXe siècle que dans le bois de Vincennes. Il a été
étendu dans le secteur de la Grande Cascade et du lac
Réservoir. Un pompage dans le lac, avec bâche et
filtres, est relié au système d’arrosage
automatique de la pelouse riveraine. Il fonctionne sans problème
depuis plus de 20 ans.
Plusieurs
concessions arrosent à l’AEP, mais les gros consommateurs
utilisent déjà de l’ENP : le Jardin d’Acclimatation
dispose de forages, l’hippodrome de Longchamp pompe en
Seine pour l’arrosage des pistes et des espaces verts,
le nettoyage des tribunes et l’alimentation des bouches
incendie et des WC des tribunes. Le nouveau plan d’eau
de l’hippodrome d’Auteuil est alimenté par
le réseau d’ENP, qui sert aussi à l’arrosage
des terrains de jeux et des pelouses. Les toilettes de la Fondation
Louis Vuitton récupèrent l’eau pluviale,
mais le bassin de la fondation pour l’art et la création,
dans le Jardin d’Acclimatation, reste alimenté
en AEP. Le Polo de Paris a aussi recours à l’ENP.
L’usage de l’ENP pourrait être étendu
au jardin du Pré Catelan et au parc de Bagatelle.
La
mise en valeur de la trame d’eau récente et à
venir
Parmi
les réalisations récentes des divisions des bois,
plusieurs actions ont ciblé l’amélioration
paysagère et environnementale des lacs, rivières
et cascades. Elles concilient différents enjeux propres
aux deux bois, quitte à en privilégier certains
localement : paysagers et culturels, écologiques et environnementaux,
d’usages et de fréquentation.
La
diminution de la fragmentation de la trame d’eau - axes
de circulation, certaines concessions -, la renaturation et
la végétalisation des milieux sont des objectifs
majeurs.
La
qualité de cette trame bleue fait des bois des réservoirs
de biodiversité reconnus dans le Schéma Régional
de Cohérence Écologique et dans le plan biodiversité
de la Ville de Paris. Les milieux humides et aquatiques qui
abritent une biodiversité spécifique ont fait
l’objet d’une attention particulière.
La
flore - hydrophytes, hélophytes, ripisylve -, et la faune
- mollusques, amphibiens, insectes, oiseaux et mammifères
- de ces milieux ont en commun une dépendance plus ou
moins forte à l’eau. Les fonds et berges bétonnées
de la trame d’eau ont ainsi fait l’objet d’expérimentations
visant à enrichir la qualité des sites tout en
assurant leur étanchéité : argile, liner.
Une limitation de la surpopulation faunistique a aussi été
engagée. Elle concerne des oiseaux aquatiques - bernaches
du Canada… -, qui ont une pression très importante
sur la végétation, le sur-empoissonnement, voire
l’introduction d’espèces étrangères
- écrevisse de Louisiane, tortue de Floride -, qui déséquilibrent
certains écosystèmes.
La
vigilance en matière de qualité des eaux est aussi
essentielle. Les milieux humides et aquatiques, points bas dans
les paysages, sont susceptibles d’accumuler des polluants
de l’air, de l’eau, voire du sol, particulièrement
dans les secteurs les plus exposés, proches des voies
circulées. La capacité de phyto remédiation
des berges plantées peut jouer un rôle important.
Enfin, les curages réguliers, lors des périodes
qui dérangent le moins la biodiversité - d'octobre
à novembre -, permettent d’éliminer les
dépôts qui ont pu s’accumuler, et de retrouver
une profondeur d’eau.
Au
sud du bois, la rivière sèche a été
mise en eau et son tracé prolongé. Pour le ruisseau
de Longchamp, le niveau d’eau a été relevé
de 15 cm, en rehaussant les surverses, pour camoufler les berges
bétonnées et des aménagements ont été
effectués - gabions, nattes - pour favoriser le développement
de milieux humides : poissons, batraciens.
Des projets analogues pourraient concerner les berges des étangs
de la plaine de Longchamp.
En 2012, la remise en service de la Grande Cascade a assuré
un spectacle aux heures d’affluence tout en économisant
la ressource.
Les berges de Seine du bois de Boulogne sont un lieu encore
naturel de contact entre les trames vertes et bleues à
grande échelle. Ce site à forts enjeux environnementaux
nécessite de préserver les plages naturelles et
les zones sablonneuses - frayères -, de conserver la
végétation spontanée, de développer
les techniques de génie végétal - maintien
des berges -, et de renforcer la gestion différenciée.
Étendre
la trame d’eau
La
valorisation de la trame d’eau peut être l’occasion
de mieux guider les promenades, de remettre en valeur des points
de vue et des éléments singuliers, comme les cascades,
voire de créer de nouvelles scènes et séquences.
L’aménagement des rives permet aussi de gérer
des distances entre le chemin et le bord de l’eau, en
conciliant l’accès à l’eau, la qualité
des paysages et la sécurité. S’il n’est
pas toujours possible de restituer les tracés disparus,
ceux-ci peuvent inspirer un plan d’extension visant à
mieux fédérer les espaces, à améliorer
les continuités écologiques et à répartir
la fréquentation en invitant le public à découvrir
de nouveaux lieux.
L’extension
de la rivière sèche pourrait ainsi favoriser les
traversées est/ouest jusqu’à la berge du
fleuve - sur 700 m environ -, via le fossé du Saut du
Loup, dans un secteur où la trame d’eau n’est
plus continue.
Certains plans d’eau mériteraient aussi d’être
plus accessibles au public, comme pour les lacs du Tir aux Pigeons.
D’autres
projets pourraient contribuer au maillage des promenades à
pied et à vélo. L’étang de Boulogne,
dédié à la pêche à la mouche,
pourrait être davantage intégré à
la série des étangs de la plaine de Longchamp
en conciliant lisibilité de la promenade, accessibilité
pour tous et préservation/valorisation de la pêche
sportive. C’est aussi le cas entre la mare Saint-James,
sur fréquentée, et les lacs du Tir aux Pigeons.
La promenade en berge de Seine, aménagée au sud
du pont de Suresnes, ne l’est pas au nord, entre ce pont
et la Pompe à Feu. Cette séquence révélerait
l’ambiance fluviale et le patrimoine naturel du site.
La valorisation des paysages liés à l’eau
passe aussi par la réorganisation du stationnement et
de la circulation, particulièrement au carrefour du Bout
des Lacs, et de la Grande Cascade à la berge de Longchamp.
Le réaménagement du carrefour des Cascades en
témoigne.
Penser
de nouveaux usages : patinage, baignade, événements…
Des
pistes d’évolution sont à étudier
pour développer de nouveaux usages - jeux d’eau,
bain, patinoire, activités nautiques - sans compromettre
l’environnement.
La réhabilitation et l’extension de la trame d’eau
sont étroitement liées à une réflexion
sur les nouveaux usages qui pourraient y être associés.
Des jeux d’eau, ludiques et pédagogiques, pourraient
enrichir une offre souvent standardisée.
Lieux de créations artificielles et sources d’inspirations
artistiques, les bois pourraient s’inscrire dans une perspective
contemporaine en mettant en scène, au fil des saisons,
les différentes formes de l’eau : glace, cascade,
brume… Des artistes contemporains travaillent dans cette
voie : Olafur Eliasson, Isabelle Daëron ou le collectif
Aman Iwan. Ces mises en scène pourraient aussi répondre
et sensibiliser à des enjeux environnementaux : cascades
ou jets d’eau améliorant l’oxygénation.
Le caractère éphémère de ces installations,
en changeant le regard sur certains sites comme la pelouse de
la Muette, pourrait aider à expérimenter la capacité
des lieux à être transformés.
En
complément des sites de baignade identifiés dans
la Seine et la Marne dans la perspective des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024, des activités estivales liées
à l’eau auraient mérité d’être
développées afin de mieux répartir la fréquentation,
et d’ouvrir davantage certaines emprises au public. Suite
à l’appel à manifestation d’intérêt
lancé par la Maire de Paris et le Préfet de Région,
23 sites potentiels de baignade ont été identifiés
en Seine et en Marne en héritage. L’un d’eux
est situé en aval du pont de Suresnes dans le bois de
Boulogne. Il est l’occasion de créer un site de
baignade dans un paysage naturel.
Le long de la berge du bois de Boulogne, des pratiques sportives,
comme l’aviron ou le canoë, pourraient être
envisagées dans le bras de Puteaux. Un ou deux pontons
favoriseraient l’accès à l’eau en
augmentant ponctuellement la fréquentation d’un
site peu fréquenté et méconnu. Le Jardin
d’Acclimatation a intégré des jeux d’eau
: brumisateurs, pataugeoire, canon à eau. L’alimentation
en AEP du Pré Catelan et de Bagatelle pourrait aussi
conduire à des installations de ce type, en les adaptant
à ces contextes, voire renouer avec des pratiques anciennes.
La faible profondeur des lacs du Tir aux Pigeons facilitait
la formation de glace pour le patinage en hiver. En été,
une partie des pièces pourrait servir de pataugeoire,
si la qualité de l’eau le permet.
|
| |
En
surface, la trame d’eau
du bois de Boulogne
se compose de 10 km
de rivières, reliant
14 plans d’eau, qui
couvrent environ 27 ha.
Vue
du Grand Lac
©
doc. Apur in : Les Promenades de Paris, A. Alphand
|
|
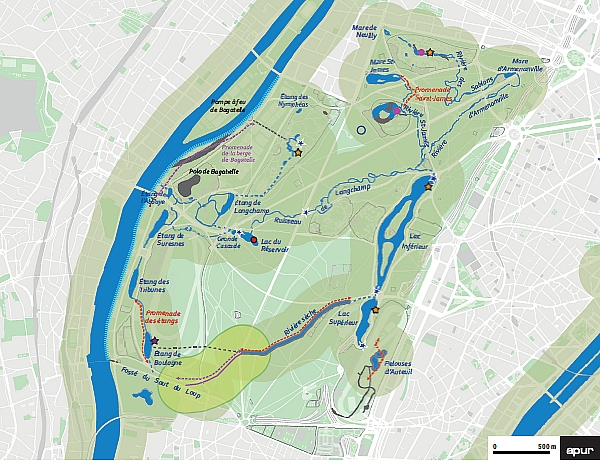 |
|
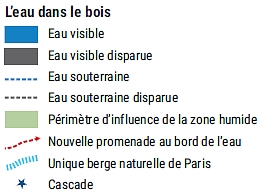
L’eau
dans le bois de Boulogne
|
|
|

Étang
de Suresnes ©
Apur - Vincent Nouailhat |

Lac
Inférieur ©
Apur - Vincent Nouailhat |
|

Rivière
et cascade ©
Apur - Vincent Nouailhat |

Rivière
et cascade ©
Apur - Vincent Nouailhat |
|

Fontaine
sèche au Jardin d’Acclimatation
©
Photo_Traveller / Shutterstock.com
|

Jets
d’eau au Jardin d’Acclimatation
©
Apur |
|

Rivière
aux abords de l’étang de Suresnes
©
Apur - Vincent Nouailhat
|

Le
ruisseau de Longchamp rénové en 2012
©
Apur
|
|

Gargouille
le long de la boucle cyclable ©
Apur
|

Fossé
du Saut-du-Loup ©
Apur
|
|
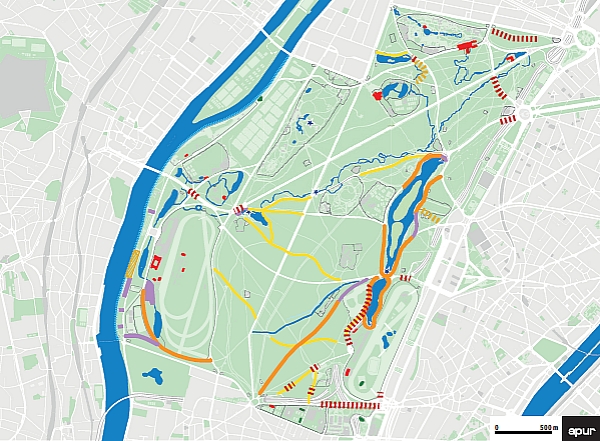 |
|
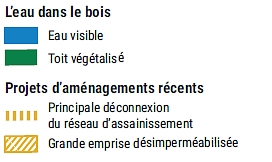
Gestion
et mise en valeur de la ressource en eau pluviale
|
|
|
|
Zoom
sur… Le
déversoir d’orage Bugeaud
Traitement
innovant des eaux de ruissellement du Périphérique
par une filière végétalisée
Les
eaux pluviales issues du ruissellement de voiries fortement circulées
constituent des pressions majeures en micropolluants et un obstacle
à l’atteinte du bon état des masses d’eau
si elles ne sont pas suffisamment traitées.
À Paris, le déversoir d’orage Bugeaud collecte,
pour 95 %, les eaux de ruissellement de voirie fortement polluées
par le trafic routier d’un tronçon du Boulevard périphérique.
Construit en 1970, il s’étend de la porte Dauphine
à son rejet en Seine en amont du pont de Puteaux. Les eaux
du Périphérique transitant par le déversoir
sont rejetées en Seine dès qu’il pleut - plus
de 100 fois par an -, soit près de 9 % des déversements
parisiens.
Afin d’améliorer la gestion quantitative et qualitative
de ces rejets urbains par temps de pluie, la Ville de Paris a
construit un démonstrateur au sein du bois de Boulogne.
Le principe consiste à exploiter la capacité de
stockage du déversoir pour contenir les évènements
pluvieux sans rejet direct en Seine. Les eaux stockées
sont ensuite pompées et renvoyées vers un filtre
planté qui les épure, avant de rejoindre le réseau
hydrographique des mares du bois. De type filtre planté
de roseaux comprenant un substrat spécifique - Rainclean
-, ce démonstrateur doit permettre l’adsorption des
micropolluants dissous, d’ordinaire, mal retenus par les
dispositifs conventionnels.
Le projet européen Life Adsorb, dans le cadre
d’un partenariat de la Ville avec une équipe pluridisciplinaire,
a assuré un suivi scientifique de ce démonstrateur
de 2020 à 2023. Son objectif est de mieux comprendre les
processus à l’œuvre, d’optimiser son fonctionnement
et de faciliter une transposition sur d’autres sites. L’enjeu
de la démonstration est majeur : montrer la compatibilité
des objectifs de préservation de la biodiversité,
de conservation du patrimoine et de bien-être social avec
ceux du traitement d’eaux pluviales chargées. En
parallèle, et hors projet Life Adsorb, l’aménagement
porte aussi sur la déconnexion des eaux du réseau
hydraulique des mares de Saint-James et de Neuilly. Encore rejetées
dans le réseau départemental d’assainissement
des Hauts-de-Seine, ces eaux claires n’ayant pas vocation
à se rejeter au réseau d’assainissement, s’écouleront
bientôt directement en Seine via une nouvelle canalisation. |
|
|
Le
déversoir d’orage Bugeaud :
•
9,6 M€ / 2018- 2023 •
Maîtrise d’œuvre : DPE •
3 500 m³
de stockage
•
Démonstrateur de dépollution d’eau pluviale
de voies très circulées
•
Suivi scientifique de 2020 à 2024 dans le cadre du projet
européen Life Adsorb
•
Création d’un milieu favorable à la promenade
et à la biodiversité
•
Déconnexion du réseau des mares du réseau
d’assainissement du 92
•
Subventionnement : fonds européen LIFE pour l’environnement,
MGP, AESN
•
Partenaires du projet Life Adsorb : Cerema, ENPC, UPEC,
INRAE, AgroParisTech, Ecobird. |
|

Construction du fond de forme en juin 2019 ©
Apur |
|

Le filtre planté en décembre 2019 ©
DPE |
..
.....
...... .Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares
de nature à revisiter .Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares
de nature à revisiter
.................Atelier
parisien d’urbanisme
......... |
| |
Les deux bois restent encore des espaces fragmentés,
à la fois par les infrastructures routières
et par les concessions qui les morcellent. L’enjeu
est d’atteindre un juste équilibre entre
les différents usages, les activités
économiques, la préservation et la valorisation
du patrimoine paysager et bâti et le développement
de la biodiversité.
L'ouvrage présente, 17 ans après les
Chartes des bois, un diagnostic mettant en avant,
dans une vision holistique, les actions réalisées,
et esquisse des pistes d’évolutions.
Aujourd’hui, à la fois l’urgence
climatique, les nouvelles attentes des citadins, et
l’exigence patrimoniale nous invitent à
engager une nouvelle étape de développement
des deux bois. Ce diagnostic prospectif peut constituer
un socle commun pour nourrir les échanges et
choix à venir par la Ville de Paris et les
collectivités riveraines.
|
|
| |
....
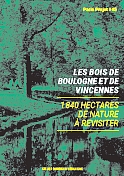
Bois
de Vincennes © Apur |
.....
©
Atelier parisien d’urbanisme, Paris 2020
Directrice
de la publication : Dominique ALBA, directrice générale
de l’Apur
Directrice de la rédaction : Patricia PELLOUX,
directrice adjointe - Rédacteurs en chef
: Patricia PELLOUX et Frédéric BERTRAND
Étude réalisée par : Frédéric
BERTRAND, Florence HANAPPE, Vincent NOUAILHAT, Yann-Fanch
VAULÉON
Avec le concours de : Anne-Marie VILLOT
Cartographie et traitement statistique : Marie-Thérèse
BESSE, Christine DELAHAYE, Tristan LAITHIER, Nathan PAULOT
Photographies et illustrations : Apur sauf mention
contraire
Dépôt
légal : mai 2020 - ISBN : 978-2-36089-017-0 - ISSN
: 1773-7974
apur.org |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes :
Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes :