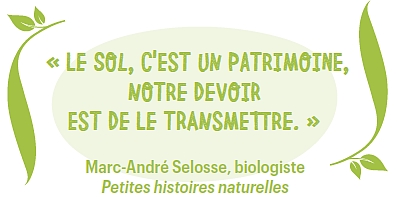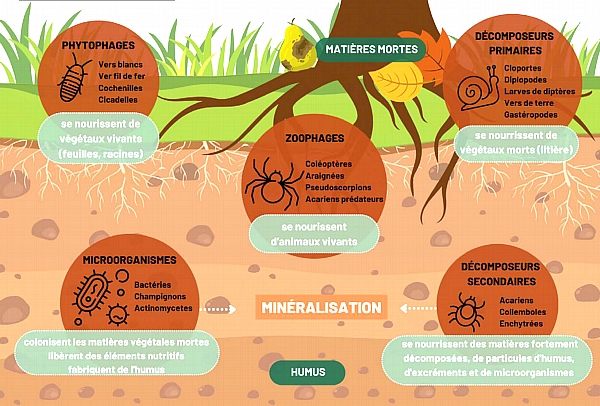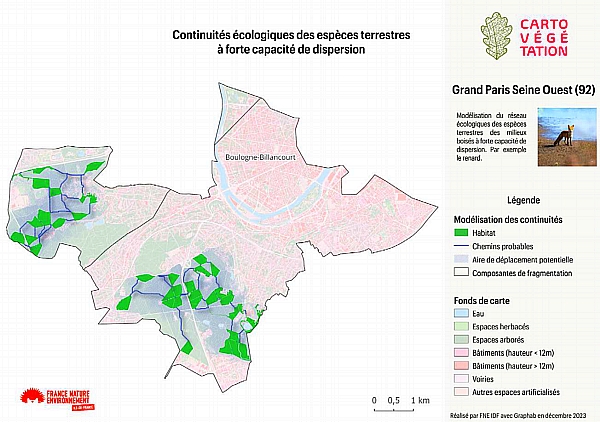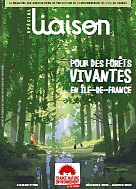|
Ce projet de manifeste est un point d’étape, la base à
partir de laquelle nous réfléchissons à des solutions
pertinentes pour sauvegarder nos
forêts. Ce n’est pas simple, toutes les forêts d’Île-de-France
ne se ressemblent pas. Elles ont des statuts et des fonctions différentes.
67 % de nos forêts sont des forêts privées, celles
qui sont en zone urbaine dense ne peuvent pas être traitées
comme les autres…
Cette complexité demande que l’on prête attention au
contexte, que l’on identifie les menaces, que l’on analyse
les conflits
d’usages. Au plus près du terrain, nos associations sont
particulièrement bien placées pour le faire
et pour coélaborer les politiques publiques nécessaires.
Constats et propositions.
| Le
trésor fragile des sols forestiers |
|
| Il
y a plus d’êtres vivants dans une poignée de
sol forestier que d’êtres humains sur Terre. La plupart
sont microscopiques, beaucoup restent inconnus. Un gramme de sol
forestier contient un milliard de bactéries et cent mille
champignons. Ces dizaines de milliers d’espèces et
ces milliards d’êtres vivants interagissent pour produire
et maintenir l’écosystème forestier. C’est
cette vie foisonnante du sol qui donne à la forêt
sa résistance en présence d’une perturbation.
Ce sont aussi les innombrables interactions qui permettent sa
résilience après une perturbation importante.
Il y a les macro-invertébrés : les cloportes,
mille-pattes, vers de terre, termites, fourmis… Ce sont
les ingénieurs physiques qui structurent et brassent
le sol pour maintenir sa porosité à l’air
et à l’eau, la distribution spatiale des ressources
en matière organique et en eau, ainsi que la dispersion
des graines.
Il y a les ingénieurs chimistes : les bactéries
et champignons. Ils transforment la matière organique en
éléments minéraux dans une forme qu’ils
rendent assimilable par les racines des arbres, aidées
des champignons dans l’immense réseau mycorhizien
d’échanges.
Il y a les ingénieurs régulateurs qui contrôlent
la décomposition de la matière organique ainsi que
les maladies et les parasites : les nématodes, collemboles,
acariens. Ils forment des chaînes alimentaires qui contrôlent
la prolifération des microorganismes du sol.
Cette fabuleuse biodiversité anime dans le sol les cycles
du carbone, de l’azote, du phosphore qui conditionnent la
vie de la partie aérienne, visible, des arbres. C’est
l’abondance et la diversité des organismes du sol
qui œuvrent aux grandes fonctions écologiques des
forêts pour l’atmosphère respirable, la circulation
et la filtration de l’eau, la production de sols fertiles,
l’amortissement des extrêmes climatiques.
L’accélération du changement climatique est
une perturbation majeure. Nous savons maintenant que les forêts
anciennes, peu perturbées par l’action des hommes,
résistent mieux grâce au volume et à la biodiversité
de leurs sols. Au contraire, les coupes importantes, surtout des
arbres les plus forts, détruisent la biodiversité
du sol. Ainsi, les coupes contiguës amoindrissent les fonctions
écologiques des sols forestiers, celles qui contribuent
aux grands cycles de la biosphère, dont nous dépendons
d’autant plus que nous les ignorons.
Il y a encore plus de vie dans le sol forestier qu’au-dessus
: respect !
Jean-Claude
MARCUS, Président de l’université populaire
de la biosphère |
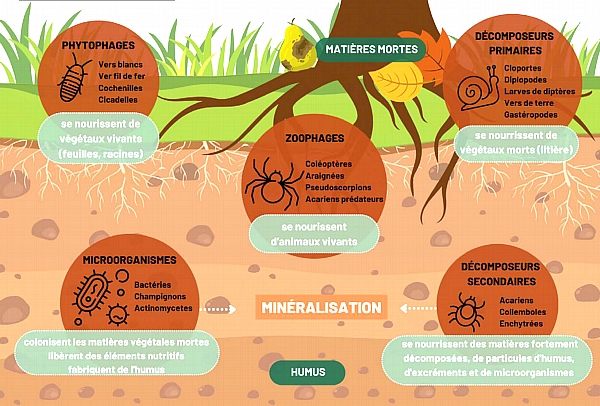
|
|
| Nous
pouvons détruire en moins d’une journée
ce que la nature fait
en un millénaire. |
|
|
| Biodiversité
forestière, une richesse à préserver |
|
| |
Les
milieux forestiers constituent un incroyable réservoir
de biodiversité. Les arbres contribuent à cette
biodiversité non seulement par la diversité des
essences, mais surtout par les espèces qui vivent, se nourrissent,
se reproduisent et dépendent d’eux pour se développer.
La forêt de Fontainebleau possède par exemple plus
de 6 000 espèces animales dont 5 700 insectes, quelque
1 800 plantes à fleurs, fougères, mousses et près
de 3 900 champignons, lichens et algues (1),
tout un univers à découvrir….
Les forêts sont aussi les habitats de prédilection
des grands mammifères sauvages. Les gros arbres morts ou
à cavité abritent des oiseaux, des chauves-souris,
des petits carnivores et de nombreux coléoptères.
Les zones humides sont les habitats privilégiés
des amphibiens, des insectes aquatiques, et d’une grande
quantité d’espèces végétales
spécifiques. Souvent riches en végétaux rares,
les zones rocheuses sont aussi des lieux de guet pour les oiseaux
et les reptiles. Zones de transition, les lisières sont
des milieux très diversifiés où de nombreux
prédateurs des parasites forestiers trouvent refuge.
En dehors du peuplement en lui-même, une forêt contient
généralement de nombreux milieux associés
: ruisseaux, mares, clairières, zones humides, tourbières,
landes sèches, lisières…
Une part importante de la biodiversité en forêt se
situe dans ces milieux. Ces zones sont d'une grande importance
parce qu’elles abritent aussi de nombreuses espèces
protégées, et participent de manière générale
au bon fonctionnement de l'écosystème forestier.
Sans intervention humaine, les milieux ouverts intra forestiers
seraient rapidement recolonisés, alors que leur maintien
présente également l'avantage d'offrir abri et nourriture
à la faune sauvage.
La pression exercée par les grands animaux sur la régénération
des peuplements forestiers est une des contraintes les plus citées
par les propriétaires et les gestionnaires de forêts.
La consommation de fruits forestiers, des jeunes pousses, l'écorçage
ou les frottis, ont un impact important sur la forêt qui
peine alors à se renouveler. Si diminuer les populations
de grands animaux paraît complexe, il s’avère
alors nécessaire d’augmenter la nourriture disponible.
Pour cela, l’ONF a mis en place des zones de pâturage,
qui sont des espaces ouverts intra forestiers offrant de la nourriture
aux cervidés. La gestion des lisières forestières
peut également remplir ce rôle de nourrissage en
favorisant à la fois des espèces de milieux ouverts,
des espèces forestières et des espèces spécifiques
des lisières : merisiers, érables, arbustes riches
en baies. Des éclaircies régulières permettent
de maintenir un tapis végétal, et de favoriser le
développement d’une flore herbacée. (1)
Vallauri et Neyroumande, 2009
Catherine GIOBELLINA, Administratrice de FNE Île-de-France
Concernant
la biodiversité forestière, sont représentées
en pastilles en page de gauche : le renard mulotant, l’écureuil
roux, le mulot, une biche en silhouette, le pinson des arbres,
le pic épeiche, la huppe faciée, le moyen duc, le
crapaud commun, le lucane cerf-volant, les abeilles sauvages,
et le sylvain azuré. ©
Christian Weiss - © Daniel Auclair - © DR |
|
| Préserver
les boisements anciens : le CEN Île-de-France à l'œuvre
Avec
son programme de préservation des boisements naturels franciliens,
le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Île-de-France
est l’un des lauréats de l’appel à projet
Aux Arbres Citoyens de France Télévision
et France Nature environnement, dans la catégorie Pérenniser
la libre évolution de peuplements forestiers. Entretien
avec son directeur, Christophe Parisot |
Les
grandes lignes du projet du CEN
- Réaliser
un état des lieux de la biodiversité et de la
naturalité des parcelles boisées propriétés
du CEN Île-de-France
- Acquérir
de nouvelles parcelles boisées et/ou contractualiser
des ORE avec des propriétaires privés en Île-de-France
- Améliorer
l’appropriation des enjeux liés aux milieux boisés
par la population
|
|
| En
quoi consiste le projet préservation des boisements
naturels franciliens ?
Il consiste, d’une part, à améliorer la connaissance
des sites forestiers appartenant au Conservatoire, en réalisant
des inventaires de la faune et de la fonge liée aux vieux
bois et aux sols anciens, en recensant les chauves-souris, les
oiseaux forestiers, les insectes saproxylophages, les champignons
et la faune du sol, mais également en évaluant la
quantité de bois mort du sol ou sur pied, le diamètre
des arbres, les essences présentes… D’autre
part, à identifier, à l’échelle régionale,
les boisements anciens. Ces termes ne désignent pas uniquement
des boisements abritant des vieux arbres. En effet la gestion
des forêts peut conduire à leur disparition. Il s’agit
donc d’identifier aussi les boisements déjà
présents sur les cartes d’état-major du milieu
du XIXe siècle, qui cartographient des boisements alors
existants et constitués, et de regarder leur existence
aujourd’hui, en vérifiant notamment s’il n’y
a pas eu d’interruption du caractère boisé.
Pour cela, nous consultons les photographies aériennes
anciennes de 1949.
Pourquoi
rechercher des boisements sans vieux arbres et donc avec une biodiversité
qui peut être altérée ?
Parce
que ces boisements ont vu leur sol peu modifié durant de
longues périodes et, par conséquent, abritent une
faune du sol préservée, mais également un
stock de carbone important qu’il convient de ne pas relarguer.
Bien évidemment, un changement trop important de l’état
boisé, par exemple par la conversion en peupleraie ou en
plantation résineuse, déclassera les boisements
recensés.
Sur
quoi va déboucher ce travail de recensement des boisements
anciens ?
Une
fois ce travail de repérage et ce découpage réalisés,
il s’agira de contacter les propriétaires ainsi que
les notaires afin, soit de pouvoir acquérir de nouvelles
parcelles de forêts anciennes, soit de proposer un partenariat
sous différentes formes et notamment les obligations réelles
environnementales : respect des sols en place et, si possible,
mise en place d’îlots de vieillissement - augmentation
de l’âge d’exploitabilité - ou mieux
encore, d’îlots de sénescence - l’îlot
est laissé en libre évolution jusqu’à
son dépérissement - au sein du boisement.
Les parcelles acquises par le Conservatoire seront vouées
à la libre évolution, sauf en bordure de chemins,
routes, habitations ou autres nécessitant une mise en sécurité,
et ce, afin de contribuer à constituer en Île-de-France,
à terme, une trame de vieux bois, et, lorsqu’ils
répondent aux critères, de les rattacher au réseau
Sylvae, porté par la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels.
Propos
recueillis par Jane BUISSON, Secrétaire générale
de FNE Ile-de-France |

©
Crédit CEN IDF |
|
| Cartovégétation
: préserver les continuités écologiques |
|
Dans
le pays le plus bétonné d’Europe, l’Île-de-France
est la région la plus urbanisée, et qui bétonne
toujours le plus par rapport à sa superficie. La pression
exercée par l’artificialisation des sols sur les
écosystèmes est particulièrement importante,
et constitue la première cause du déclin de la biodiversité.
C’est pour cela que nous demandons le zéro artificialisation
brute. Dans l’attente de sa mise en place, l’association
développe le projet Cartovégétation.
Celui-ci donne des solutions pour un aménagement du territoire
qui lutte contre l’effondrement de la biodiversité
et s’adapte au changement climatique.
L’urbanisation grignote les forêts franciliennes au
fil des années, d’une part, elle les découpe
en une multitude d’espaces isolés et, d’autre
part, elle réduit leur surface. Ce double effet, comparable
à la transformation d’un continent en archipel d’îles,
est très néfaste pour les habitats écologiques
et les déplacements des espèces.
En effet, celles-ci utilisent habituellement plusieurs espaces
lors de leur cycle, que ce soit pour leur alimentation, leur repos
ou pour leur reproduction. Leurs déplacements entre les
réservoirs de biodiversités, appelés corridors,
sont aussi vitaux pour la dispersion des espèces : recherche
de partenaire, de nouveaux territoires…
L’ensemble des réservoirs de biodiversité
et des corridors qui les relient sont appelés réseaux
écologiques, on parle également de trame verte pour
les espaces naturels et semi-naturels terrestres.
Lorsque ces réseaux sont fragmentés, les espèces
ne peuvent plus réaliser leur cycle de vie ou se disperser.
L’augmentation de la fragmentation conduit donc à
une baisse des effectifs des populations et de leur diversité.
Les individus ont plus de mal à se reproduire, ce qui entraîne
une dégénérescence génétique.
En conséquence, les forêts sont de moins en moins
résistantes aux
risques, et ont de plus en plus de mal à s’en remettre
(résilience).
Il est donc primordial de veiller à la connectivité
des espaces boisés franciliens pour maintenir la diversité,
les flux d’individus et de gènes, le déplacement
des populations et des individus. Ainsi FNE ÎDF, sous l’impulsion
d’Environnement 92 et de Sud Environnement, développe
le projet Cartovégétation. En s’appuyant sur
les données écologiques de certaines espèces
représentatives - Pipistrelle commune, Hérisson
d’Europe, Mésange charbonnière, Myrtil…
-, elle modélise très précisément
les réseaux écologiques par types d’espèces,
par exemple les petits mammifères à faible capacité
de dispersion.
Ces données permettent d’identifier aussi les zones
à forts enjeux : les espaces existants qui sont les plus
importants et qu’il faut protéger, ainsi que les
espaces à restaurer pour améliorer la connectivité
des espaces. Des diagnostics plus précis intégrant
d’autres données - présence d’espèces,
protections environnementales et urbanistiques, zones à
construire… - sont aussi réalisés pour compléter
l’analyse. Ces cartes sont un nouveau support pour orienter
l’aménagement et construire les territoires de demain.
Les résultats sont librement accessibles sur la plateforme
Cartovégétation.
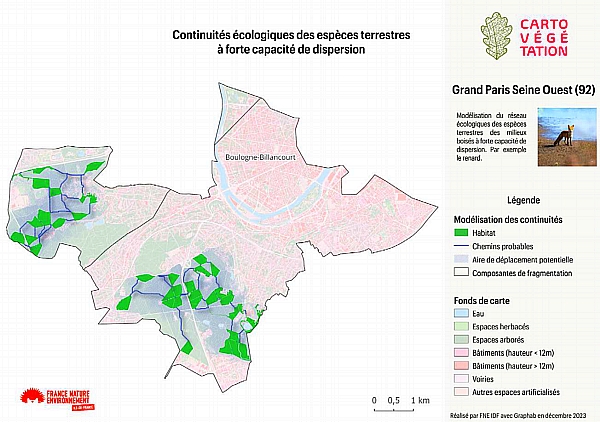
|
|
|
Depuis
1988, le Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France
préserve les espaces naturels franciliens à travers
des actions de protection, gestion, connaissance, valorisation
et accompagnement. |
|
.....
...... .Pour
des forêts vivantes en Île-de-France .Pour
des forêts vivantes en Île-de-France
..............
................Édité
par FNE Ile-de-France - Association régionale
agréée Environnement - Publié avec
le concours du Conseil Régional d’Île-de-France
................Directeur
de publication : L. Blanchard - Dépôt
légal : Décembre 2023 - Janvier 2024 -.N°
Commission Paritaire : 0124 G 81563 - ISSN 2555-2546
.................
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
.....
....
Le
devenir des forêts franciliennes nous préoccupe
tous.
Nos forêts souffrent du réchauffement climatique.
Les sécheresses à répétition
les fragilisent, les maladies et la surexploitation
les mettent à genoux. En 2022, les forêts
du Grand Est ont émis plus de carbone qu’elles
n’en ont capté ! L’alerte est très
sérieuse. Il fallait faire le point avec l’ensemble
des acteurs et élaborer des propositions. C’est
ce que nous avons fait le 8 juin 2023 lors d’un
colloque à l’Académie du climat.
Nous en avons publié les actes, et rédigé
un projet de manifeste qui occupe le cahier central
de ce numéro de Liaison.
Nous
devons un grand merci à toute l’équipe,
salariés et bénévoles, qui anime
notre fédération FNE Ile-de-France. C’est
grâce à l’investissement de chacune
et de chacun que notre mouvement peut contribuer à
la transition. Nous dédions à tous les
touches de poésie qui émaillent ce numéro.
fne-idf.fr
|
|
.....
.
.
.
Le
magazine des associations
de protection de l'environnement
de l'Île-de-France
Comité
de rédaction :
J. Buisson, M. Colin, C. Giobellina,
M. Holvoet, P. Latka, I. Lledo,
M. Martin-Dupray, J-P. Moulin,
C. Nedelec, I. Nenner, F. Redon,
M. Riottot, H. Smit, D. Védy. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Pour
des forêts vivantes en Île-de-France
Pour
des forêts vivantes en Île-de-France