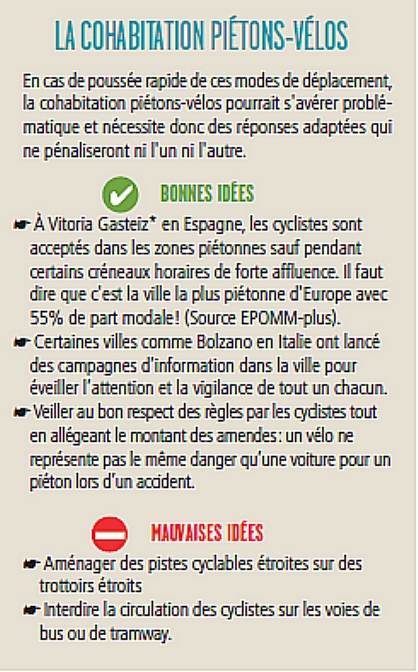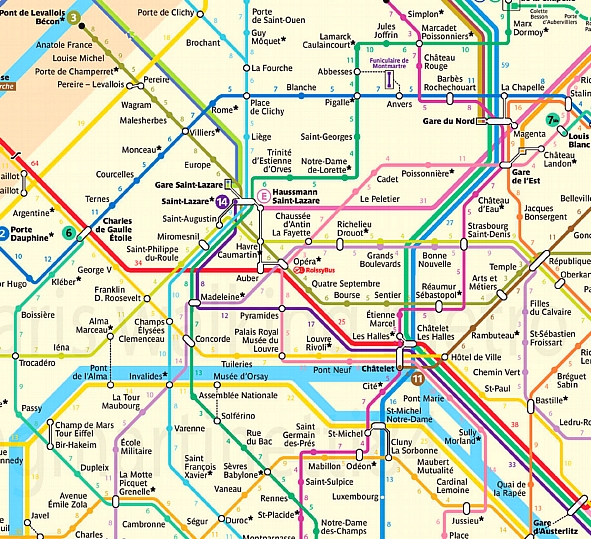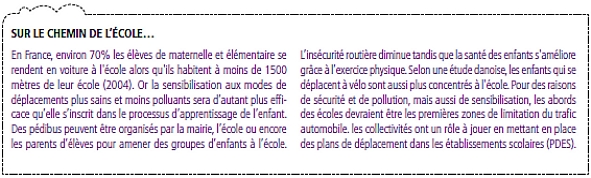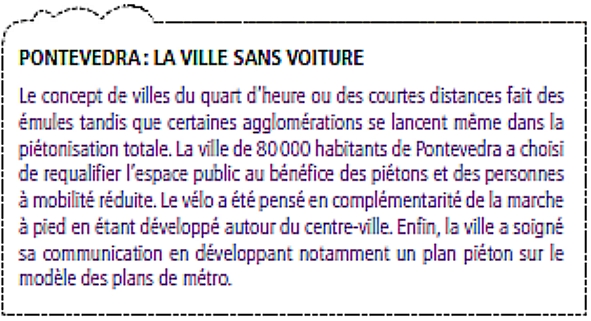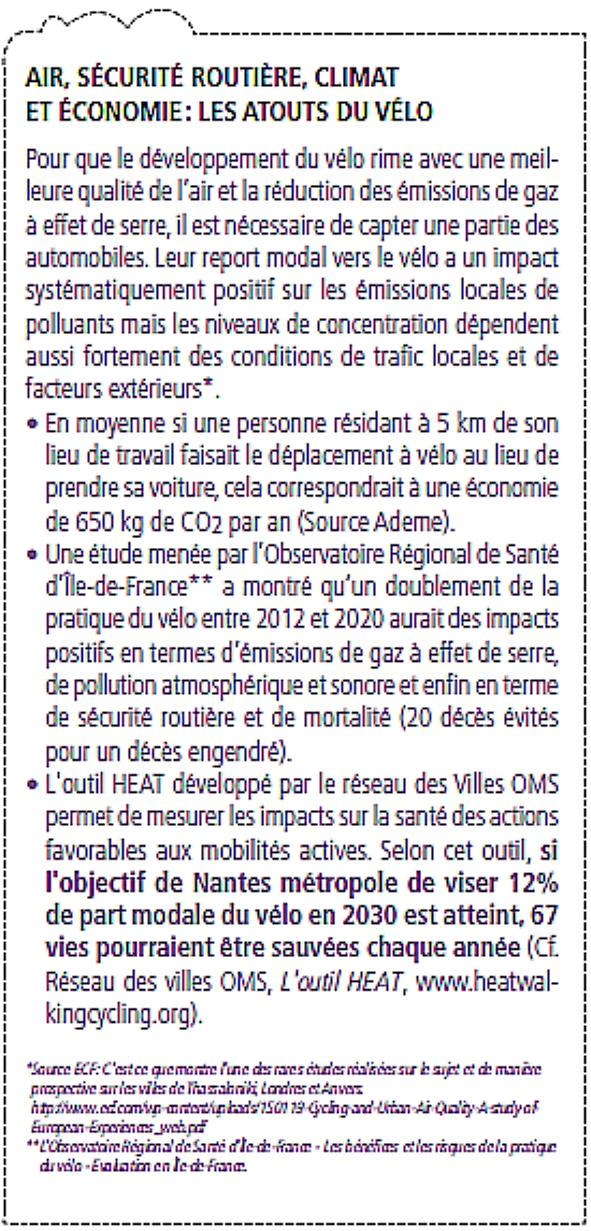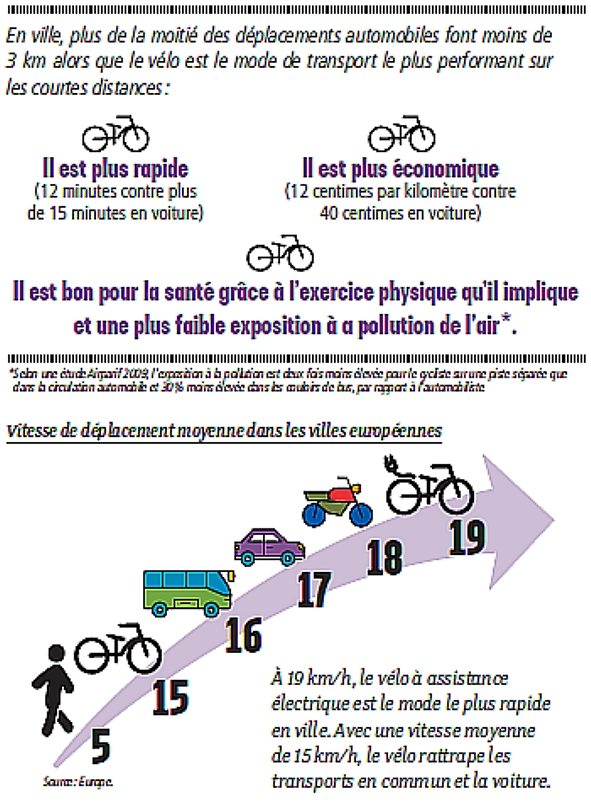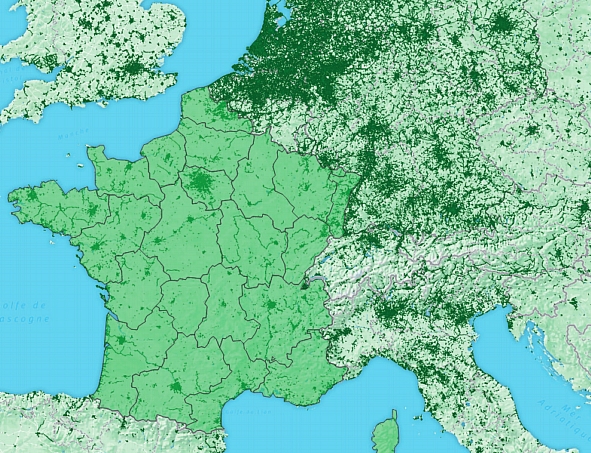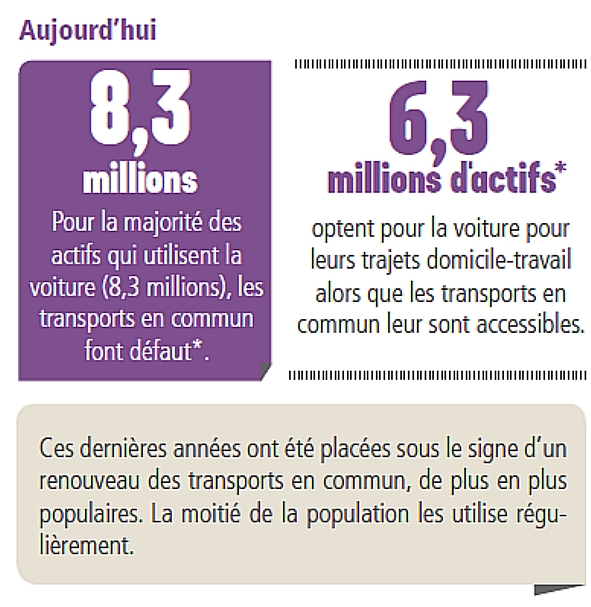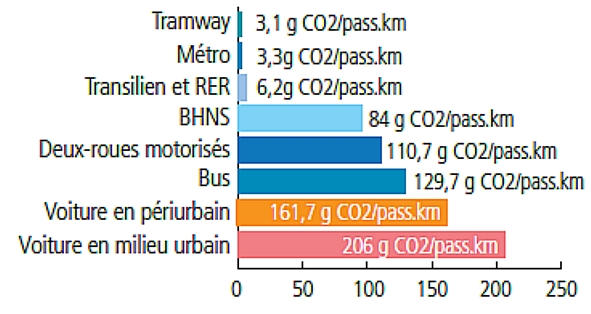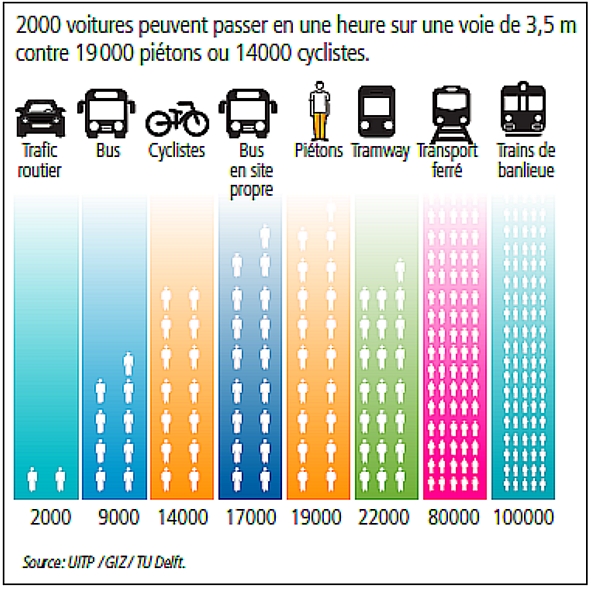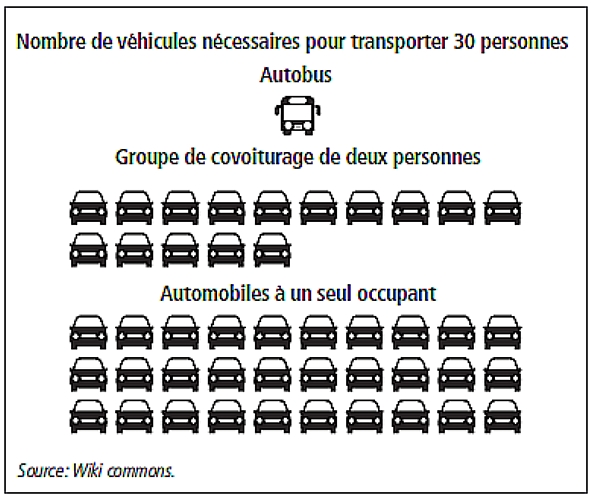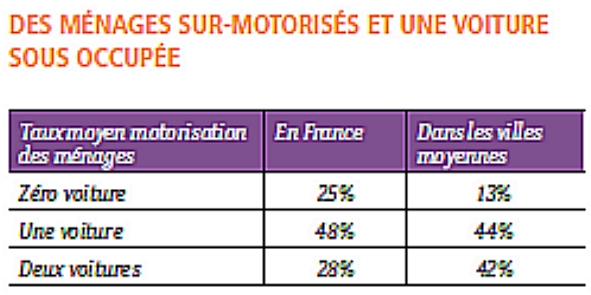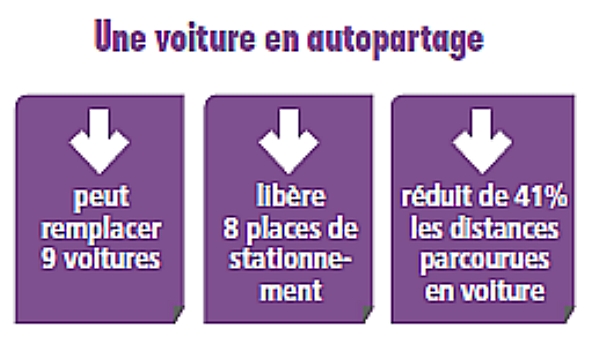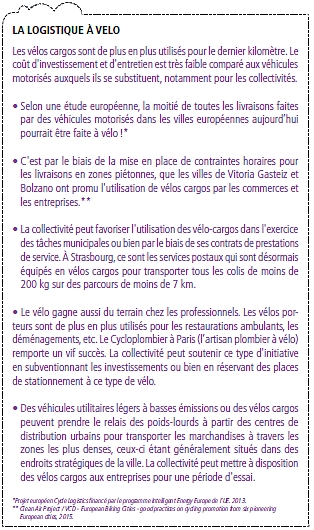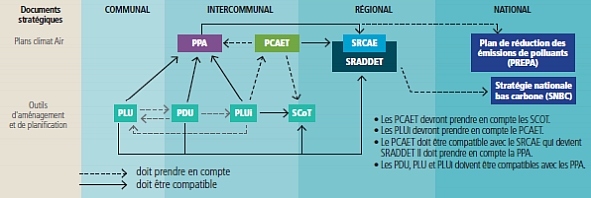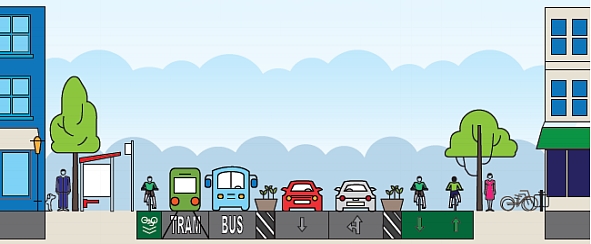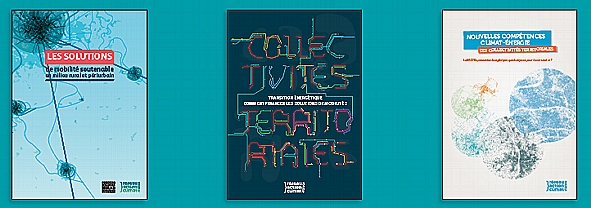|
Modérer
la place de la voiture en ville est une étape incontournable pour
lutter contre la pollution de l’air dont souffre la
population dans les zones denses et réduire les émissions
de gaz à effet de serre causées par nos déplacements
quotidiens.
Il n’y a pas d’opposition claire de la population locale aux
mesures de modération de la circulation mais, qu’elle passe
par
une zone à circulation restreinte, une gestion du stationnement
plus dissuasive ou bien l’expansion des zones à circulation
apaisée, la démarche soulève bien des interrogations,
parfois même des oppositions, qu’il faut appréhender
pour mieux
accompagner cette transition. Avant tout, ne pas arriver en terre inconnue.
Les règles d’or pour une transition en douceur :
Informer
et impliquer la population : les bonnes pratiques de la concertation
Organiser
des campagnes de communication et d’animation
Une
mobilité soutenable pour tous : ne laisser personne sur le quai
De
la ville marchable à la ville sans voiture : le retour
du piéton en ville
|
Se déplacer à pied est à la fois tout ce
qu’il y a de plus naturel et un exercice délaissé
par la population dans son quotidien. En effet, contre toute
attente, tous les citadins habitant en France ou en Europe ne
marchent pas dans les mêmes proportions. À Strasbourg,
la part modale de la marche à pied est de 33%, bien au-delà
de la moyenne française de 25%. Les Strasbourgeois marchent
aussi plus longtemps : 33% estiment marcher plus de 30 minutes,
ce qui est le cas de 25% de la population totale mais de seulement
11% des Bordelais.
Sans surprise, la propension à marcher est inversement
proportionnelle à la place qu'occupe la voiture en ville.
Néanmoins, ces disparités sont aussi liées
aux aménagements existants dans la ville. Pour développer
la marche à pied, un meilleur partage de l’espace
public est un passage obligé. Celui-ci passe forcément
par une modération de la place de la voiture, soit par
les limitations de trafic, à l'instar des zones à
trafic limité, ou par les politiques de stationnement.
Redonner goût à la marche à pied en ville
n’est pas si évident et requiert des efforts spécifiques.
C’est pourquoi de plus en plus de collectivités
se dotent d’un plan piéton comme axe stratégique
de leur politique locale de déplacement. Rappelons ici
que la moitié des trajets en voiture en ville font moins
de 3 km en moyenne, 40% des trajets moins de 2 km, et 20% moins
de 800 mètres.
Premier
objectif : assurer la sécurité des piétons
!
Selon la Sécurité routière, les piétons
représentent 15% des décès sur les routes
en 2014, dont les deux-tiers circulaient en milieu urbain. La
mortalité piétonne a augmenté de 7% entre
2013 et 2014. Surtout, 85% des personnes sondées par
MMA/Opinion Way se sentaient en ville plus en danger à
pied qu’en voiture ou en deux-roues en 2015. Les piétons
ont besoin d’une meilleure protection !
Second objectif : redonner goût à
la marche à pied
La pratique de la marche est aussi très bonne pour la
santé. Seulement 42% de la population âgée
entre 15 et 75 ans pratiquent un niveau suffisant d’activité
physique favorable à la santé selon l’Inpes.
50% de la population marche moins de 4 minutes par jour et plus
de la moitié de la population serait en meilleure santé
avec un peu plus d’exercice : 30 minutes de marche par
jour a minima.
Qu’est-ce
qu’une ville marchable ?
Plus qu’une ville normale, la ville marchable est réellement
accessible aux piétons, mais aussi hospitalière,
pratique, et idéalement agréable. Alors que les
centres-villes piétons ont conquis la population par
leur cadre de vie et leur dynamisme, nombre de quartiers périphériques
sont devenus déserts et ont découragé la
marche à pied. Pour que la ville marchable ne se cantonne
pas au centre, chaque quartier devrait accueillir des loisirs
et des services de proximité pour reconquérir
les passants, en mettant la mixité fonctionnelle au coeur
du plan d’urbanisme.
Marche
à suivre pour réhabiliter la marche à pied
en ville
Conseil n°1 : Lever les obstacles physiques
-
Des opérations ponctuelles d'aménagements pour
résorber les points difficiles pour les piétons
: renforcement du partage de l'espace public au profit des
piétons, sécurisation des traversées,
travail sur les ambiances lumineuses et sonores, etc.
-
Construites ou aménagées pour accueillir le
trafic routier, les infrastructures comme les ponts et les
tunnels sont très peu propices à la marche à
pied. Parfois dépourvus de trottoirs, elles obligent
à des détours conséquents et décourageants
pour les piétons.
-
Aménager les espaces publics et les trottoirs pour
rendre les cheminements piétons agréables (nature
en ville, animation, mobilier urbain) et sécurisants
(l’éclairage, notamment pour les femmes qui se
déplaceraient de nuit).
Conseil
n° 2 : Lever les obstacles psychologiques
-
Pour sensibiliser les habitants, les salariés et les
usagers du territoire à la marche, la marche à
pied doit devenir une véritable alternative à
leurs yeux. Sa promotion se fait donc dans la rue elle-même
avec une signalétique spécifique aux piétons
détaillant les directions et les temps de parcours
vers les grandes centralités du territoire.
-
Un plan dépliant grand public, présentant les
itinéraires conseillés et des informations sur
les temps de déplacements associés et distribué
dans toutes les boîtes aux lettres.
-
Cela se joue aussi en ligne avec notamment l’intégration
de la marche à pied dans les moteurs de recherche consacrés
aux transports sur internet.
Conseil
n°3 : Se mettre à la place du touriste
Au coeur du plan marche doit figurer l’attractivité
de la ville. Un cadre de vie pratique et agréable est
déterminant pour encourager le plus vieux mode de déplacement,
tant la ville habituelle est devenue peu propice à la
marche à pied.
Conseil
n°4 : Concerter et communiquer sur le plan piéton
Trois démarches inspirantes
-
À
Paris,
la mairie a lancé une vaste consultation publique autour
du réaménagement de sept grandes places parisiennes
- Bastille, Place des Fêtes, Gambetta, Italie, Madeleine,
Nation et Panthéon - avec l’objectif principal
de créer d’ici 2020 des lieux apaisés
et conviviaux réservant 50% d'espaces supplémentaires
aux piétons.
-
L’intercommunalité
Plaine Commune (93) est certainement l’un des territoires
les plus traversés par le trafic automobile, et par
conséquent les plus exposés à un air
pollué. Elle s’est lancée dans un processus
d’élaboration d’un plan marche en concertation
avec ses habitants, les usagers et les salariés.
Elle organise des marches sensibles - promenades en ville
- pour permettre aux habitants de se réapproprier la
marche.
-
À Bordeaux, la marche intermodale
Puisque les usagers des transports en commun sont avant tout
des piétons, la ville de Bordeaux s’est donnée
pour mission de mettre en marche les usagers des transports
en commun avec l’opération Marche à
suivre. Des indications sonores et des panneaux d’informations
sur les temps de parcours à pied comparé aux
temps d’attente sont diffusées dans le tramway
et aux stations pour permettre au voyageur de faire un choix
rapide quand au mode de déplacement le plus pertinent.
Des guides de marche sont aussi distribués aux stations
sous forme de mini-plans par quartier où figurent de
manière ludique les temps de parcours des lignes de
marche, les trajets alternatifs, mais aussi des repères
géographiques et des monuments pour faciliter le repérage
des piétons. Au vu de la saturation des transports
en commun dans les métropoles comme Paris ou Marseille,
ce type d’action de sensibilisation est très
pertinent.
Pour
aller plus loin
-
Technicités n°227, Développer la marche
en ville : pourquoi, comment ? 2012
-
Cerema, Développer la marche et le vélo
: l’expérience de 4 liaisons intercommunales
|

© Lorelei Limousin
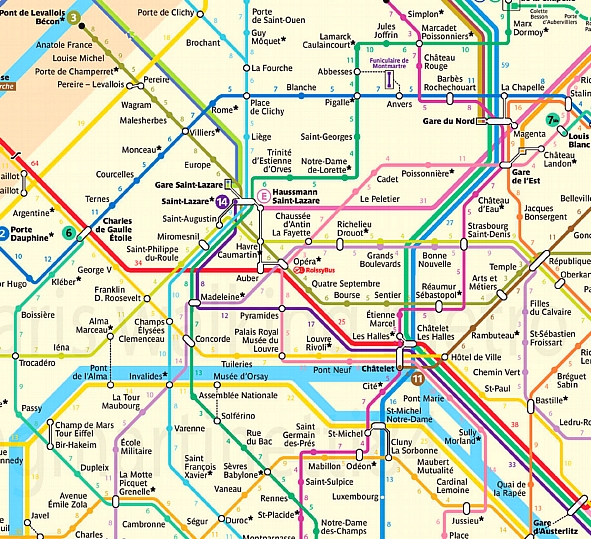
Cette carte
indique les temps approximatifs - en minutes - de marche à
pied entre chaque station d'une même ligne de métro,
RER ou tramway à Paris. Elle indique également les
temps entre deux stations proches mais de ligne différente,
situées à 6 minutes de marche ou moins.
Source : Guillaume Martinetti
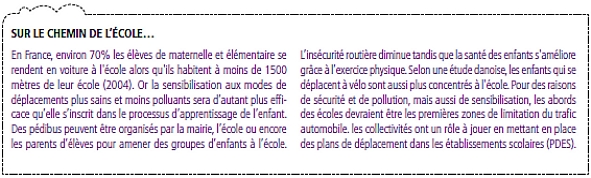

©
Trevor Huxham
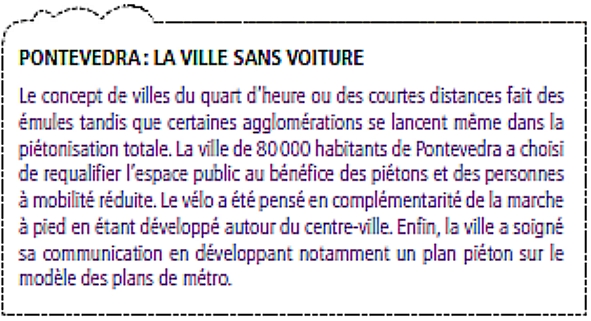
|
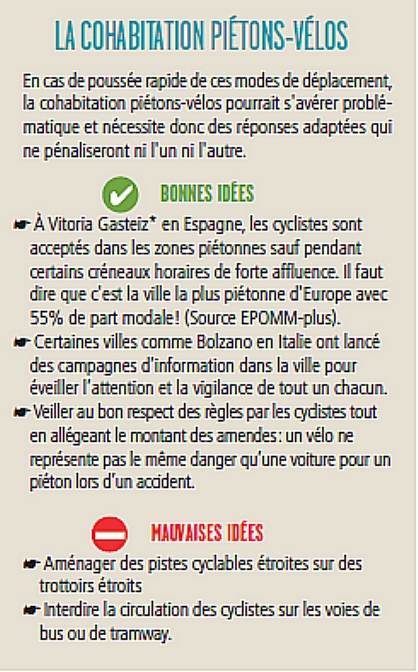 |
*
European Biking Cities - good practices on cycling promotion
from six pioneering European cities 2015 VCD Clean air Project
|
| Devenir
une ville cyclable : faire le pari du vélo comme transport
de masse
|
| |
Des
collectivités de plus en plus nombreuses se sont fixées
pour objectif d'atteindre 15% des déplacements effectués
à vélo à l’horizon 2020, multipliant
par cinq la part modale moyenne actuelle du vélo. L’objectif
étant aussi fixé dans la politique pluriannuelle
de l’énergie à 12,5% en 2030, toutes les collectivités
sont concernées. Le saupoudrage des pistes cyclables en
ville ne peut suffire pour multiplier par 2, 3 ou 4, le nombre
de cyclistes réguliers. Aux Pays-Bas, où le vélo
est utilisé dans 27% des déplacements, ou encore
au Danemark dans 18% des cas, soit 8 et 6 fois plus, la météo
n’est pas plus clémente qu’en France et pourtant
son utilisation continue d’augmenter ! C’est le fruit
d’une politique très volontariste de développement
du vélo comme mode de déplacement, qui fut historiquement
associée à la modération du trafic routier
- deux-roues motorisés inclus - et de sa vitesse.
Une
politique globale mais un budget dédié
En
qualité d’autorité organisatrice de la mobilité,
les collectivités sont sommées de prendre en considération
l’ensemble des mobilités dont le vélo dans
le cadre de leurs compétences déplacements.
En sus du plan de déplacements urbains, leurs actions peuvent
alimenter les plans de protection de l’atmosphère,
les plans climat air énergie territoriaux et les plans
locaux d’urbanisme, qui doivent notamment délimiter
les normes de stationnement pour les vélos, intégrer
les itinéraires cyclables et les emplacements réservés.
Les actions de développement du vélo permettent
de lutter contre la pollution de l’air à moindre
coût mais méritent un financement dédié
dans le budget de la collectivité pour les dépenses
de sensibilisation et de communication notamment. Les investissements
significatifs sont rentables : à Strasbourg, première
ville cyclable de France, le nombre d’habitants exposés
aux particules fines est passé de 60 000 à 15 000,
au dioxyde d’azote de 100 000 à 60 000 personnes
entre 2008 et 2012.
Adoptez
le réflexe vélo
Il
faut s’assurer que toutes les infrastructures et les projets
d’urbanisme peuvent accueillir les cyclistes. Depuis la
loi Laure adoptée en 1996, tous les travaux de réfection
sur voirie doivent donner lieu à la création d’aménagements
cyclables. Il est important de pouvoir transmettre aux maîtres
d’ouvrage une culture d’aménagement
des modes actifs.
Plus
il y a d’aménagements vélos, plus il y a de
vélos
En
2012, seul un cinquième de la voirie comporte un aménagement
cyclable - piste ou bande cyclable, zone 30 - dans les villes
et agglomérations de plus de 100 000 habitants. De surcroit,
il existe de fortes disparités entre les villes –
la part de voirie couverte passant de 49% à Strasbourg,
Rennes ou Metz à 17% à Caen par exemple –
qui se reflètent dans les taux d’utilisation du vélo*.
*Ces
chiffres portent sur tous les aménagements confondus, intramuros
: Strasbourg et ses quelques 300 km de voies cyclables, Nantes
et ses 370 km, Grenoble avec plus de 220 km, Bordeaux 200 km,
Rennes 147, Paris 185km, Le Mans 150km et Angers 83km…
Source FUB. www.fub.fr/velo-ville/villes-qui-aimentvelo/villes-qui-aimentvelo-france-etrange
Le
vélo : un investissement positif pour l’économie
locale et nationale
-
Pour la ville, un km de piste cyclable coute 200 fois moins
cher qu’un km d’autoroute urbaine et 35 fois moins
qu’un km de tramway. source : F. Papon
-
Chaque année, les cyclistes font d’ores et déjà
économiser 6 milliards d’euros en non dépense
de santé à l’État !
-
En outre, le secteur pèse 3 milliards d’euros dans
l’économie nationale et 35 000 emplois.
-
La sécurité routière s’améliore
: plus la présence des cyclistes est importante, plus
les automobilistes sont incités à lever le pied,
moins il y a d'accidents.
Comment
mettre ses habitants en selle ?
La
politique vélo doit cibler les deux freins principaux à
l’usage des vélos : l’insécurité
ressentie et la crainte du vol.
1.
Aménager la voirie pour tous
-
Là où les vitesses sont élevées
- 50 km/h -, des pistes cyclables séparées de
la voirie et larges sont généralement préférables
pour permettre le passage des vélos volumineux et anticiper
la hausse future du nombre de cyclistes.
-
Dans toutes les voies à sens unique limitées
à 30 km/h ou moins, le double-sens cyclable est devenu
obligatoire.
-
Les chau-ci-dou - la chaussée à voie
centrale banalisée -, facilite la cohabitation des
modes quand les rues sont trop étroites pour aménager
deux voies et des pistes cyclables.
-
Ouvrir les couloirs de bus et de tramway aux cyclistes, prévoir
des goulottes au niveau des escaliers, généraliser
le cédez-le-passage cycliste aux feux et la priorité
à droite… la voirie peut être aménagée
pour faciliter la circulation des cyclistes à moindre
coût.
Enfin
il est indispensable de faire connaître les nouvelles règles
du décret PAMA 2015 et de verbaliser les enfreintes
: le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons
et aux vélos est passible d’une amende de 135 euros,
de même que l’attente des cyclomoteurs dans l'espace
réservé aux cyclistes réservé aux
vélos.
2.
Le stationnement sécurisé dans l’espace public
et privé, meilleure arme contre le vol*
-
Au domicile et au bureau il est désormais obligatoire
de réaliser des espaces de stationnement pour le vélo
dans tous les bâtiments construits après 2011 et
plus anciens, en cas de travaux.
- La ville de Vitoria-Gasteiz en Espagne a obligé
les propriétaires et co-propriétés à
créer des locaux à vélo dans tous les nouveaux
immeubles. Les déplacements à vélo ont
doublé en 3 ans - de 6,8 à 12,3% en 2014 -, se
traduisant par une baisse de la part modale de la voiture de
28,4 à 24,7%,en 3 ans.
- À Paris, les copropriétés peuvent
bénéficier d’un montant de 50% du coût
de l’installation d’un abri vélo sécurisé,
dans la limite de 2000€.
-
Des locaux vélo sécurisés, équipés,
accessibles, dans tous les lieux d’attractivité
existants et en projet : les établissements collectifs,
les entreprises, les commerces, les écoles. Leur installation
doit être systématique dans des règles urbanistes.
*25%
des cyclistes abandonnent le vélo en cas de vol, les autres
achètent un vélo de moindre qualité ou l’utilisent
moins
La
suppression de places de stationnement automobiles en surface
permet de libérer de la place aux vélos-box et aux
arceaux, surtout à côté des pôles générateurs
de trafic. Situer les aires de stationnement vélo en
amont des passages piétons sécurisant la traversée
des piétons.
Face aux craintes de vol, Strasbourg a installé 1200 nouveaux
arceaux par an, en commençant par substituer d’anciennes
places de parkings automobiles.
Les vélos-box ont une capacité limitée
- 10 places - mais peuvent s’insérer facilement dans
les recoins urbains en couvrant moins d’espace qu’une
place de stationnement et rassurent notamment les propriétaires
de vélos
à assistance électrique (VAE).
- À
la gare : les stationnements sécurisés sont indispensables
à proximité de pôles multimodaux. Paris
va déployer 20 places de stationnement dans des consignes
vélo Veligo dans les gares parisiennes, 20 000 places
seront accessibles pour un coût de 20 euros par an, pour
les abonnés. 28 000 vélos peuvent désormais
se garer gratuitement dans les parkings de Strasbourg.
3.Équipez
les habitants
Des aides à l’achat pour les vélos à
assistance électrique et les utilitaires
La collectivité peut aider directement ses habitants en
subventionnant l’achat de vélos classiques, vélos
utilitaires, vélos pliants - pour l’intermodalité
avec les transports en commun -, ou de VAE. Une trentaine de villes
a déjà mis en place ce type d’aide mais aucune
d’entre elles ne semble prévoir d’aide pour
les vélos cargos - électrique ou non - qui
peuvent permettre le transport des enfants ou les déplacements
des professionnels. Dans l’enquête de la Fub, plus
de 70% des usagers utilisaient leur voiture avant d’opter
pour le vélo à assistance électrique. Le
gain environnemental est donc net : le rejet de 6 tonnes de CO2
a pu être évité grâce aux bénéficiaires
de l‘aide à Chambéry.
Les systèmes de vélos en libre service et système
de location longue durée
En 2013, plus de 35 villes mettaient à disposition un système
de vélos en libre-service. Ceux-ci se sont révélés
efficaces pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre et la pollution de l’air grâce à
un transfert, même modeste, depuis la voiture. Dans les
autres villes, la location de longue durée de vélos
publics est une alternative intéressante, moins coûteuse
et attrayante, en particulier pour les étudiants. Les vélos
sont prêtés pour 4 à 12 mois par les collectivités
d'Angers et de Bordeaux par exemple.
4.
Favoriser l’apprentissage du vélo
-
La collectivité peut encourager l'apprentissage du vélo
à l'école primaire au même titre que la
natation, et faciliter la mise en place de bus cyclistes
animés par des employés municipaux ou des parents
d'élèves pour amener les enfants à l'école
de manière groupée.
-
Les vélos-écoles méritent aussi le soutien
des collectivités locales pour déployer leurs
missions d'accompagnements et d'apprentissage du vélo
auprès des adultes.
5.
Assurer le service après vente
-
La collectivité peut encourager le marquage des vélos
bicycode et informer sur les meilleures astuces contre
le vol : un bon antivol.
-
Les ateliers de réparation associatifs sont une véritable
boîte à outils participative et solidaire. Un soutien
financier et parfois organisationnel des collectivités
pour s’installer et se pérenniser est indispensable
et sera récompensé par la création d’emplois
locaux.
Pour
aller plus loin
Les fiches du Cerema – Centre d’expertises et d’études
sur les risques
La présentation de François Tortel Réseau,
Cyclable à haut niveau de service
- Journée Technique du Club des Villes et Territoires Cyclables,
2014.
www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/tortel_rchns-cvtc-jt-17-09-2014-03.pdf
www.fub.fr
Ademe Pays de la Loire - Cahier de ressources pour développer
les modes actifs sur les territoires, 2015
*Lire
à ce sujet : Julien Demade Les embarras de Paris,
ou l’illusion techniciste de la politique parisienne des
déplacements, L’Harmattan, Septembre 2015
|
| Transports
en commun : pilier de la réduction des pollutions en ville |
| Autorités
organisatrices de la mobilité, les collectivités
locales joueront un rôle déterminant pour encourager
l’usage des transports en commun et ainsi réduire
la pollution et les émissions de gaz à effet de
serre des transports. Alors que les transports en commun sont
saturés dans les grandes métropoles, ils sont sous-développés
dans la plupart des territoires peu denses et méritent
dès lors une approche régionale. Celle-ci sera rendue
possible par le schéma régional de l’intermodalité
coordonné par les nouvelles régions.
Et
demain ?
Il ne faut pas sous-estimer la demande potentielle qui sera accentuée
par des évolutions économiques (hausse du prix de
l'énergie et baisse concomitante du pouvoir d'achat), sociales
(hausse démographique et démotorisation) et bien
sûr écologiques. Un tiers des Français est
prêt à se passer de voiture à condition d’avoir
accès à de meilleurs transports en commun. Une vision
de long terme doit prévaloir pour dégager les financements
nécessaires au transport d’un nombre croissant de
passagers résultant à la fois du report modal et
de la croissance démographique.
Les
transports dans les plans climat des métropoles
Le
renouveau du tramway à Bordeaux est corrélé
à une baisse de 30% de la circulation automobile dans le
centre de Bordeaux, entre 2002 et 2012.
À Lyon, la hausse de 24% de la fréquentation des
transports en commun entre 2006 et 2014, associée à
l'aménagement de 640 km de pistes dans le réseau
cyclable et à la pratique régulière du covoiturage
chez 24 000 à 42 000 personnes sur le Grand Lyon, a permis
une réduction de 108 000 tonnes eq CO2/an dans le secteur
des transports.
Zurich (Suisse), réputée pour son système
de transports en commun très performant (vitesse moyenne
de plus de 25 km/h), est l’une des rares grandes villes
européennes à respecter les seuils de pollution
pour les PM10 et les NOx.
Les transports en commun polluent moins que la voiture
Les
transports en commun sont minoritaires dans le total des émissions
de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques
d’une ville mais ils se doivent d’être exemplaires.
Avec les dispositions de la loi de transition énergétique,
les flottes publiques vont progressivement évoluer vers
des flottes de moins en moins polluantes.
L’énergie utilisée par les transports en commun
peut devenir 100% renouvelable dès aujourd’hui, avec
le biogaz en remplacement du gaz naturel avec de l’électricité
renouvelable.
Pendant la transition, il est possible de diminuer l’impact
sanitaire des plus vieux transports en commun : grâce au
retrofit – fait d’équiper un bus diesel ancien
d’un filtre à particules – un bus classé
(avant euro II) peut voir son niveau de pollution diminuer au
niveau des bus Euro IV.
L’opération coûte 5000a + 500a de pose par
véhicule, à comparer au prix d’un bus urbain
situé entre 150 000 et 200 000 euros.
Les transports en commun coûtent moins cher pour l’usager
Le coût pour l’utilisateur revient à
20 à 27 centimes par km pour la voiture, soit deux à
trois fois plus que le coût pour les transports publics
(10 centimes par km).
Les
transports en commun sont plus avantageux pour les commerçants
Les
usagers des transports en commun et les piétons passent
plus de temps que les automobilistes dans les commerces de centre-ville
et dépensent en moyenne plus que les automobilistes.
L’empreinte carbone d’un déplacement automobile
est diminuée de 25% avec le bus, divisée par 20
avec le RER ou le transilien, par 60 avec le métro ou le
tramway. Ces bénéfices sont perçus aussi
pour les NOx et les particules.
À Angers, l’effet « tramway » a eu un
effet positif sur les trois axes empruntés par la ligne
avec une diminution des concentrations de dioxyde d’azote
de 20% pour les rues concernées.
Les
transports en commun prennent moins de place
Un bus peut transporter en passagers l’équivalent
de 40 à 50 voitures. Plus les transports publics seront
remplis, plus le report modal sera intéressant en termes
d’impact écologique.
Les transports en commun sont plébiscités Les transports
publics devraient être une priorité des gouvernements
dans la lutte contre les changements climatiques pour 85% des
personnes interrogées pour un sondage international.
Ils figurent en tête des attentes des particuliers touchés
par les zones où la circulation routière pourrait
être limitée.
Quelles
priorités pour renforcer le report modal vers les transports
en commun ?
Étoffer
les réseaux de transports en articulation avec l’urbanisme
-
La fréquentation des transports collectifs dépend
directement de l’offre kilométrique en transports
urbains. Elle est deux fois plus élevée dans les
villes de 100 000 à 200 000 habitants que dans celles
de 50 à 100 000 habitants.
-
Les appels à projets pour les transports collectifs en
site propre ont permis de rattraper un certain retard des villes
moyennes de moins de 100 000 habitants mais l’effort doit
se poursuivre pour les développer : bus sur voies réservées,
tramway, métros, navettes et les transports à
la demande.
-
Toutes les villes ne sont pas encore équipées
de transports en commun en site propre. L’offre doit être
renforcée en priorité autour des axes structurants,
pour combler les zones blanches afin de créer un véritable
réseau et surtout en bonne articulation avec les programmes
d’urbanisme.
Rendre
les transports plus efficaces
La vitesse commerciale étant un critère déterminant
pour les usagers des transports en commun, leur circulation sur
des voies réservées doit être privilégiée.
Quel choix entre le bus à haut niveau de service (BHNS)
et le tramway? Ce dernier représente généralement
une option plus attractive pour capter des automobilistes mais
il a un coût plus élevé.
Pour
qu’un BHNS soit performant, il doit disposer d’un
site propre continu sur son itinéraire et de priorités
de circulation aux carrefours. C’est le cas à Metz
où la fréquentation a augmenté de 21% un
an après la mise en service du vrai BHNS Mettis. Le coût
par kilomètre (13 Ma/km) se rapproche de celui d’un
tramway (à partir de 14 Ma/km) qui devient de plus en plus
compétitif. Les nouveaux bus à haut niveau de service
(TEOR à Rouen, Busway à Nantes) ont été
rapidement saturés.
Une gestion alternative des horaires et des besoins en transports
en commun peut également permettre d’éviter
leur saturation et des investissements supplémentaires.
À partir d’une analyse fine des besoins par type
de public et motif de déplacement, les fréquences
de passages peuvent être augmentées de manière
non pas linéaire mais ciblée.
-
En milieu urbain, les bureaux des temps se développent
afin d'optimiser le temps et d’organiser les journées
des étudiants et travailleurs, en diminuant les files
d'attentes dans les transports. À Rennes par exemple,
les étudiants commencent désormais les cours quinze
minutes plus tard, ce qui désengorge considérablement
le métro rennais dont la fréquence atteint 90
secondes en horaire de pointe.
-
En milieu rural ou périurbain, le « transport à
la demande » peut pallier l’insuffisance de l’offre
de transports en commun. La concertation avec les différents
acteurs économiques et sociaux permettra d’identifier
les besoins mais aussi d’éviter la juxtaposition
de différentes offres. Les
transports scolaires peuvent également accueillir des
usagers non scolaires quand ils ne sont pas remplis.
Enfin,
il convient de ne pas sous-estimer le potentiel des trains régionaux
et Intercités pour réduire l’usage de la voiture
entre centre et périphérie. Strasbourg a ainsi décidé
de réunir dans un même abonnement les transports
publics urbains et le train express régional (TER) afin
d’encourager les pratiques multimodales.
Des
transports modernes
Les
attentes des usagers sont la ponctualité (pour 54%), la
fréquence (50%) et la sureté (48%) ; viennent ensuite
le confort, l’information des voyageurs et l’accueil.
Informer,
communiquer et devenir encore plus pratique Complémentaires
aux informations sur papier, les systèmes d'information
multimodale (SIM) en temps réel rendent l’utilisation
des transports en commun plus pratique et plus attractive, notamment
grâce aux déplacements intermodaux qu’ils préconisent
et aux supports qu’ils utilisent (application mobiles…).
La collectivité peut également sensibiliser à
l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication
à travers ses missions de conseil en mobilité.
Des tarifications attractives viennent compléter
les nécessaires tarifications solidaires (fixées
en fonction des revenus). Vienne (Autriche) a, par exemple, lancé
l’abonnement annuel aux transports à 365 euros, soit
un euro par jour, entraînant une hausse de la fréquentation
de 25% (et compensant ainsi le coût pour la collectivité)69.
En France, les autocars et les « transports à un
euro » ont aussi rencontré un certain succès.
Ce type d’action marketing a pour effet de dynamiser la
demande sur ces lignes et d’augmenter les recettes commerciales.
L’intermodalité
: enchaîner plusieurs modes de transports différents
-
Pouvoir garer son vélo à la gare en toute sécurité,
de même à proximité des arrêts de
bus, sur les aires de covoiturage et dans les parkings-relais.
-
Pouvoir embarquer son vélo dans le tramway, voire même
dans le métro quand celui-ci n'est pas saturé,
attacher son vélo à l’avant ou l’arrière
du bus ou du car.
-
En étant connectés aux réseaux de transports
en commun et aux gares, les réseaux cyclables (en particulier
les réseaux express vélo) peuvent favoriser les
déplacements entre agglomérations. Aujourd’hui,
seuls 2% des usagers des TER viennent en vélo à
la gare.
Comment
concilier transports en commun et modération de la vitesse
?
Avec les mesures de modération de la place de la voiture,
les transports en commun peuvent gagner en espace et en rapidité.
La vitesse moyenne des bus dépassant très rarement
30 km/h, que ce soit en heure de pointe ou en temps normal, ils
ne devraient pas être freinés dans la ville à
30 km/h. Secondaires par rapport aux piétons et aux cyclistes,
les transports en commun doivent néanmoins rester prioritaires
devant les voitures : aux feux et aux croisements, afin de conserver
une vitesse commerciale attractive par rapport aux voitures. En
particulier, la libre circulation des véhicules dits propres
sur les voies réservées aux transports en commun
peut réserver de mauvaises surprises comme le montre l’exemple
d’Oslo où leur circulation a été ralentie. |

©
Nico54300
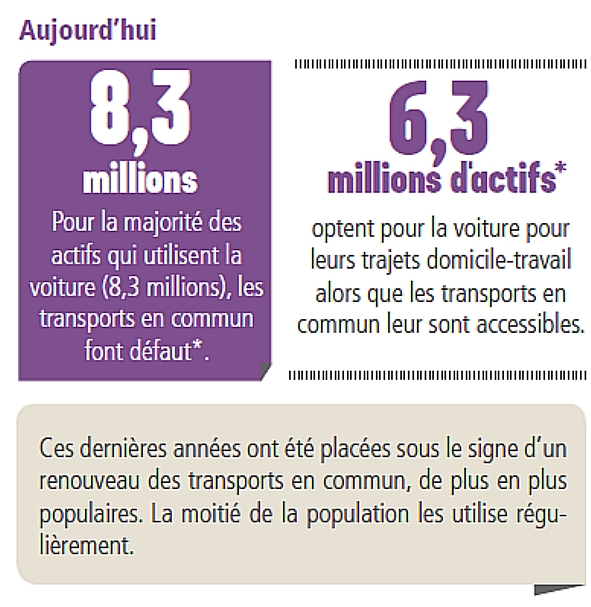
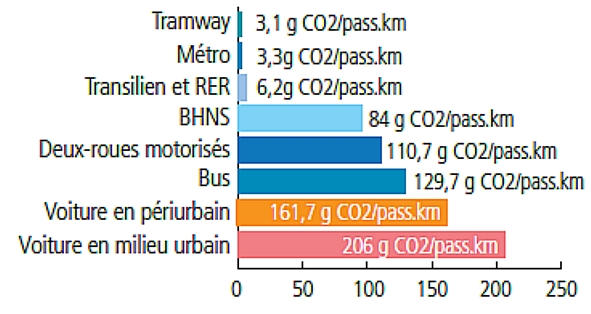
Les
émissions de CO2 globales du puits à la roue des
modes de transports*
Source : Ademe/Deloitte Efficacité énergétique,
émissions de CO2 et autres émissions gazeuses spécifiques
des modes de transport, 2007. Le CGDD a construit une méthodologie
pour faciliter l’évaluation des gains en émissions
d’un projet de TCSP.
* L’Ademe a construit une méthodologie pour faciliter
l’évaluation des gains en émissions d’un
projet de TCSP.
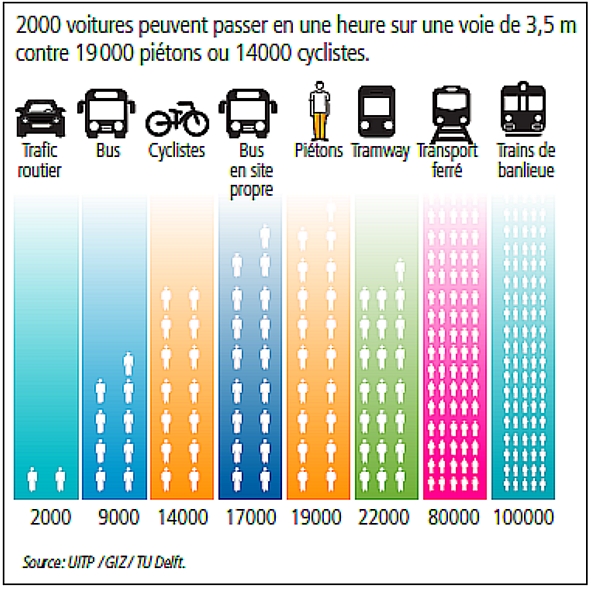

©
Frédéric Bisson
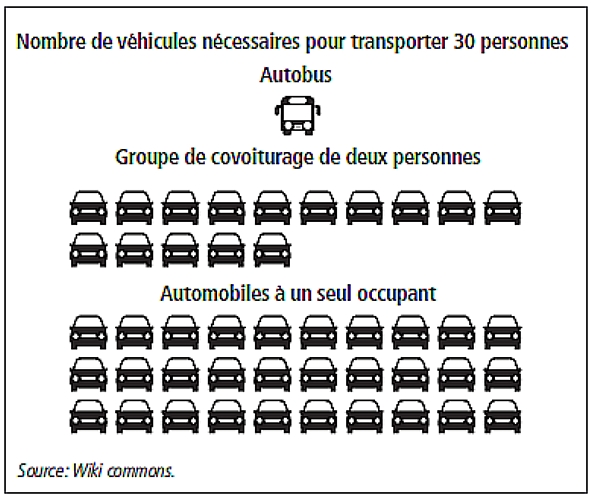

Exemple
d'intermodalité : les stationnements vélos sont
prévus en nombre devant - et à l'intérieur
- de la gare de Strasbourg © Arran Bee
|
| Pour
aller plus loin |
Certu,
Articuler urbanisme et transport : chartes, contrats d’axes,
etc. Juin 2010 |
Fédération nationale des associations d'usagers
des transports, www.fnaut.fr
|
Mobilités
partagées : nouveaux maillons indispensables de la politique
de mobilité
|

©
JPS68 - Creative Commons
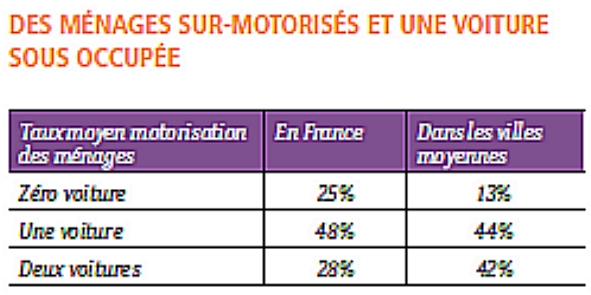
Source
: GART Mobilité et villes moyennes. État des
lieux et perspectives 2015
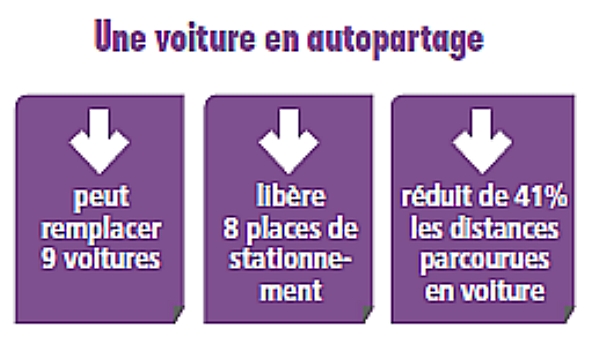
L’autopartage
bénéficie à tous les modes puisque les
autopartageurs utilisent davantage les transports en commun
(25%), le train (24%), le covoiturage (12%) et surtout, la marche
(30%) et le vélo (29%).


|
Les
autorités organisatrices de la mobilité sont devenues
compétentes pour les mobilités partagées
comme le covoiturage et l’autopartage, deux pratiques alternatives
à l’usage individuel de la voiture dont le potentiel
est aujourd’hui sous-exploité et pourtant bien réel
pour lutter contre la pollution de l'air et les changements climatiques.
Les collectivités locales ont désormais l'obligation
de faciliter les solutions de covoiturage pour les déplacements
domicile-travail et de réaliser des schémas d’aires
de covoiturage.
Des
ménages sur-motorisés et une voiture sous occupée
Une voiture est à l’arrêt 95% de son temps
et son taux d’occupation est de seulement 1,2 personne
en moyenne - 1,08 pour les déplacements domicile-travail
- alors qu’elle peut généralement transporter
4-5 personnes.
Le covoiturage représentait, en 2008, 2,5% des déplacements
de courte distance domicile-travail. Si le taux de motorisation
des ménages a augmenté de manière généralisée
en France, il reste fortement corrélé à
la disponibilité des transports en commun, au cadre offert
par la ville pour les déplacements actifs comme le vélo
et la marche à pied et surtout à la densité
urbaine. Les villes moyennes comptent en effet deux fois moins
de ménages sans voiture mais 50% de plus de ménages
possédant deux voitures.
Les
bénéfices pour le climat et la qualité
de l’air du covoiturage
Des
études menées dans l’Arc Jurassien et le
Grand Lyon démontrent les avantages environnementaux
du covoiturage courte distance. En effet, les émissions
liées aux déplacements sur le bassin d’emploi
ont diminué de 10 à 30% grâce aux dispositifs
locaux de covoiturage. Ce gain significatif est lié à
la forte proportion - 80% - d’autosolistes dans les nouveaux
covoitureurs. Le covoiturage s’est développé
en complémentarité des transports publics.
L'essor
du covoiturage au niveau local est bénéfique tant
pour la lutte contre les changements climatiques que pour la
qualité de l'air puisqu’environ les trois-quarts
des usagers délaissent leur voiture individuelle pour
le covoiturage, tandis qu’un quart seulement vient d’un
mode de déplacement autre que la voiture, ce qui engendre
un gain environnemental net.
L'Ademe a développé une méthodologie d'évaluation
pour permettre aux collectivités territoriales de mesurer
l'impact de leurs actions pour le covoiturage. Dans le Grand-Lyon,
le covoiturage concerne potentiellement 620 000 actifs et étudiants
de plus de 18 ans.
Son impact est estimé à 1 250 tonnes/an de CO2,
3 710 kg/an de NOx, 935 kg/an de COV, 230 kg/an de PM2,5 et
280 kg/ an de PM10 en moins.
Au-delà des bénéfices environnementaux,
la pratique du covoiturage a pour effet de diminuer le trafic
automobile, de réduire les nuisances sonores, de décongestionner
les routes et de faciliter les liens entre centre et périphéries,
rural et urbain.
Les
effets de l’autopartage sur le plan environnemental sont
encourageants
Concernant
l’autopartage entre particuliers, 21% des locataires en
moyenne sont amenés à renoncer à l’achat
d’un véhicule. En étant un fort levier de
démotorisation, le choix de l’autopartage en remplacement
de la deuxième ou troisième voiture peut donc
s’avérer aussi positif sur la fréquentation
des transports en commun également.
L’autopartage bénéficie à tous les
modes puisque les autopartageurs utilisent davantage les transports
en commun - 25%-, le train - 24% -, le covoiturage - 12% - et
surtout, la marche - 30% - et le vélo : 29%.
Que
peut faire la collectivité locale pour encourager le
covoiturage et l’autopartage ?
La
question qui se pose aux élus est de savoir comment contribuer
à mettre le covoiturage et l’autopartage au service
de la mobilité durable, alors que ces pratiques relèvent
bien souvent d'initiatives privées. La recherche d’une
masse critique d’utilisateurs est le principal défi
auquel sont confrontés les adeptes de ces nouvelles pratiques
collaboratives.
Si la promotion de ces nouvelles mobilités et leur développement
chez les automobilistes est le fruit de la mobilisation d’une
grande variété d’acteurs notamment privés
et particuliers, la collectivité peut contribuer à
réunir les conditions nécessaires à l'essor
du covoiturage et de l’autopartage en agissant sur :
-
La sensibilisation et le passage à l’acte : campagne
d’information et incitation des entreprises et des administrations
à travers les plans de mobilité. Les études
de faisabilité des Zones d'actions prioritaires pour
l'air - ZAPA - ont montré qu’il est nécessaire
de faire connaître l’autopartage et le covoiturage
comme moyens d’adaptation à la ZCR car il y a
déficit de notoriété des outils existants
les concernant.
-
L’attractivité et l’utilisation de ces
mobilités avec l’aménagement de la voirie
en leur faveur : les aires de covoiturage, les voies réservées
aux covoitureurs et les places de stationnement réservées
à l’autopartage, à positionner de préférence
sur les parkings existants.
-
L’offre disponible, en mettant à disposition
des véhicules de sa propre flotte publique ou en soutenant
la création de systèmes de covoiturage ou d’autopartage
en boucle, à titre d’expérimentation par
exemple.
-
L'intermodalité entre covoiturage et transports en
commun, avec la synchronisation des moteurs de recherche de
transports publics avec les sites internet de covoiturage,
via les systèmes d’informations multimodales.
Surtout,
la collectivité peut accélérer la transition
en limitant la circulation des véhicules, en favorisant
ces modes à travers le stationnement et la tarification
et en limitant le nombre de places de parking par famille. Elle
peut aussi choisir de co-construire ses projets d’urbanisme
avec les services d’autopartage et les promoteurs immobiliers.
Enfin, le télétravail peut être encouragé
par la collectivité directement avec la création
de tiers-lieux qui permettent d’éviter les situations
d’isolement ou indirectement par le biais de campagnes
d’information et de sensibilisation.
Ademe,
Indiggo, Étude nationale sur le covoiturage de courte
distance, 2015
Certu, Le covoiturage : des pistes pour favoriser son développement,
2013
IDDRI, Les nouveaux acteurs de la mobilité collaborative
:
des promesses aux enjeux pour les pouvoirs public, 2016
Réseau Action Climat et Fondation Nicolas Hulot,
Les solutions de mobilité soutenable en milieu peu dense,
2014
|
| Les
transports de marchandises en ville : réduire l’impact
du dernier kilomètre |
| Les
autorités organisatrices de mobilité sont appelées
à s’impliquer davantage dans l’élaboration
de politiques locales de gestion du dernier kilomètre.
Les transports de marchandises en ville représentent une
part non négligeable des émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre dont les
causes ne peuvent être ignorées. Il est crucial d’intégrer
aux plans de déplacements urbains et PCAET des actions
efficaces pour concilier la réduction des nuisances des
transports de marchandises avec le dynamisme des livraisons en
centre-ville dont dépend un urbanisme fonctionnel.
Quels
enjeux et responsabilités pour la collectivité ?
Dans
les villes françaises, le fret urbain représente
en moyenne 20% du trafic et 1/3 des émissions de polluants.
En plus d’être intégré aux politiques
d’aménagements, ce constat doit conduire la ville
à envisager plusieurs solutions : créer des espaces
de logistique urbains, privilégier les livraisons nocturnes
pour diminuer la congestion et la pollution pendant le jour, encourager
le renouvellement de la flotte avec des véhicules à
faibles émissions, faciliter l’intermodalité
par voie fluviale, ferroviaire et cyclable.
Créer une instance de concertation avec les acteurs concernés
et créer un poste de coordination des missions ayant trait
au transport de marchandises dans le cadre du PDU assurent une
meilleure prise en considération de la problématique
des livraisons en ville sur la durée.
Faciliter
les livraisons avec les centres de distribution urbains
L’une
des solutions les plus intéressantes pour pallier à
l’interdiction des véhicules de transports de marchandises
polluants en ville est l'aménagement de centres de distributions
urbains (CDU). Proche d’un service public de transport de
marchandises, cette infrastructure permet de centraliser une partie
des opérations de livraisons afin qu’un seul et unique
opérateur soit délégué pour gérer
la desserte d’une partie de l’agglomération.
Les expériences de Monaco, Lille ou La Rochelle témoignent
de l'efficacité logistique et environnementale des CDU,
mais les structures sont encore trop rares en France. L’espace
logistique urbain vient compléter ce dispositif en mutualisant
et optimisant les livraisons en ville grâce à la
mise en oeuvre de points de rupture de charge. Ce service est
particulièrement utile pour éviter les trajets à
vide.
Réduire
les nuisances
Au-delà
des émissions de polluants et de gaz à effet de
serre dont ils sont à l’origine, les transports de
marchandises ont aussi des impacts indésirables en matière
de bruit et causent des conflits dans l’usage de la voirie,
avec les véhicules particuliers ou les mobilités
douces.
La collectivité peut encourager la circulation de véhicules
alternatifs moins polluants par des dispositifs de soutien financiers
ou de tarification préférentielle pour le stationnement...
La commune doit utiliser au mieux le pouvoir de police du maire
pour contrôler le stationnement des véhicules de
livraisons dont la majorité enfreint souvent les règles
et s'assurer qu'ils respectent bien les interdictions : stationnement
en double file, sur les voies cyclables, et les trottoirs... En
parallèle, la collectivité peut mettre en place
de nouvelles aires de stationnement pour pallier les besoins.
L’association Certibruit a créé le label
livraisons de nuit respectueuses des riverains et de l’environnement
pour encourager les professionnels de la distribution et
de la restauration à effectuer leurs livraison de nuit
au moyen de véhicules moins bruyants et moins polluants. |

©
Vladimir Zlokazov

Nouveau
plan de circulation dans le Vieux Port de La Rochelle où
les livraisons peuvent s'effectuer entre 6h et 10h30 du matin
©
Réseau Action Climat

©
Colville-Andersen

©
Liz Patek
Aller plus loin
Ademe, France Nature Environnement : Logistique urbaine :
agir ensemble.
Un guide d'aide aux élus, associations, professionnels,
pour organiser
le transport de marchandises en ville, 2010 |
| *Projet
européen Cycle Logistics financé par le
programme Intelligent Energy Europe de l’UE, 2013
** Clean Air Project / VCD - European Biking Cities - good
practices on cycling promotion from six pioneering European cities,
2015
|
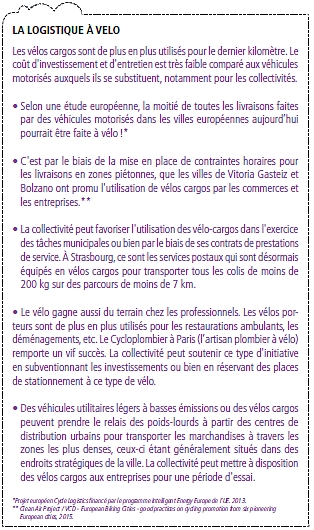
|
| |
Conclusion |
| 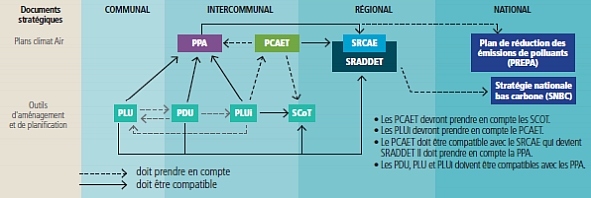
Les
bons plans pour aménager et planifier son territoire
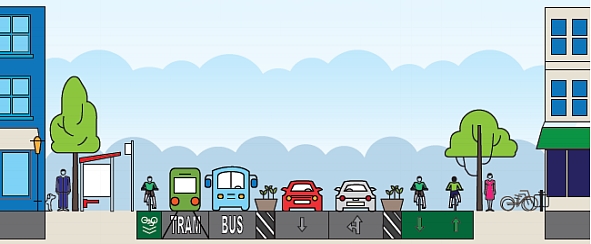
Pour
en savoir plus sur le sujet : http://www.rac-f.org/Nos-publications
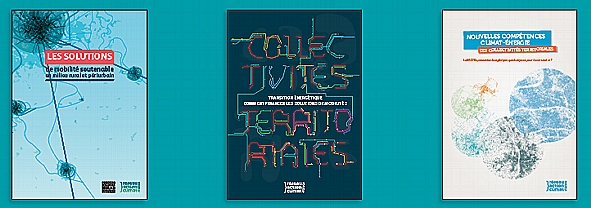 |
En
promouvant une politique globale de transports, de mobilité,
d’urbanisme et d‘aménagement axée
sur le recul des déplacements motorisés et sur
le développement des modes les plus respectueux de l’environnement
comme les transports en commun, les mobilités actives,
les mobilités partagées et les véhicules
plus sobres et moins polluants, les collectivités peuvent
et doivent agir à la fois pour la qualité de l’air
et la lutte contre les changements climatiques.
De
leur engagement au service de ce double objectif dépendra
pour une large part le succès à court, moyen et
long terme de la politique française de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et de l'amélioration
de la qualité de l’air mais aussi la portée
de notre contribution à l’effort mondial pour enrayer
les dérèglements climatique engagé lors
de la COP21 à Paris.
Elles ont donc une responsabilité particulière
pour mieux réguler l'usage des véhicules motorisés
et polluants qui causent de nombreuses nuisances en ville pour
libérer l’espace public, aujourd’hui fortement
congestionné, au profit des autres usages et d’autres
modes de transports.
Il
n’y a aucune raison d’hésiter à agir.
Les bénéfices à tirer d’une action
ferme et ambitieuse en la matière sont multiples, tangibles
et dépassent la sphère environnementale. À
travers les retombées économiques locales, la baisse
des nuisances sonores et visuelles et de la morbidité (asthme,
bronchites, conjonctivites…) due à la pollution de
l'air, l’amélioration de la sécurité
routière et de la fluidité de circulation, c’est
la qualité de vie dans son ensemble qui sortira renforcée
de la mise en oeuvre volontariste de l’éventail d’actions
suggéré dans ce guide. Le coût de l’inaction
sur le plan du climat et de la pollution de l’air est une
incitation à agir supplémentaire pour les collectivités.
Enfin, si les choix en matière d’infrastructures,
d’aménagement et d’urbanisme ne sauraient produire
des effets immédiats, ce sont eux qui engagent vraiment
l’avenir. Il appartient donc aux collectivités d’articuler
leurs actions dans ces domaines avec une politique de transports
et de mobilité visant véritablement à réduire
les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions.
Parfois, cette cohérence d’ensemble appelle à
des renoncements, certains projets n’ayant plus lieu d’être
au XXIe siècle. Heureusement, le sens des priorités
fera émerger une alternative concrète, réaliste
et désirable dont la société ne pourrait
de toute façon se passer pour faire face aux défis
actuels. |
Les villes Respire de
demain : agir sur la mobilité et les transports pour
faire face à l'urgence sanitaire et climatique
Basé en large partie sur le transport
routier, notre modèle de transports est à bout
de souffle : premier secteur d'émissions de gaz à
effet de serre en
ville et l'une des principales causes de pollution de l'air,
la prédominance du tout voiture a un coût élevé
pour les acteurs économiques, les citoyens et la collectivité
toute entière. Fort heureusement, les collectivités
territoriales disposent d'un nombre croissant d'outils pour
agir à la source et modérer la place des véhicules
motorisés et polluants au profit des mobilités
alternatives, qu'elles soient actives comme le vélo et
la marche à pied ou collectives et partagées.
Comment assumer ses responsabilités tout en bâtissant
des villes où il fait bon respirer en emportant le soutien
de la population locale ? Les solutions favorables au report
modal ne manquent pas. Elles n'attendent que vous pour être
concrétisées dans les territoires !
|
Le
Réseau Action Climat-France
Association spécialisée sur le thème des
changements climatiques, regroupant 15 associations nationales
de protection de l’environnement,
de solidarité internationale, d’usagers des transports
et d’alternatives énergétiques, elle est
le représentant français
du Climate Action Network International, fort de 900
associations membres dans le monde.
Les
missions du rac sont :
-
Suivre les engagements et les actions de l'État et
des collectivités locales en ce qui concerne la lutte
contre les changements climatiques.
-
Dénoncer les lobbies et les États qui ralentissent
ou affaiblissent l'action internationale.
-
Proposer des politiques publiques cohérentes avec les
engagements internationaux de la France
|
 Les
villes Respire de demain
Les
villes Respire de demain
Rédactrice
: Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports
au Réseau Action Climat France
Graphisme : solennmarrel.fr
Remerciements
:
Aux membres du Comité de pilotage pour leurs précieux
conseils.
Aux experts du service de la Qualité de l'air et
du service Transports et mobilités de l'Ademe ainsi
qu'aux membres du Réseau Action Climat pour leur
relecture attentive.
|
| |
Les
villes Respire
de demain |
|
Comité de pilotage :
Mohamedou
Ba, Marie Pouponneau, Ademe
Silvano Domergue, Stéphane Taszka, Commissariat Général
au Développement Durable
Marie Molino, Groupement des Autorités Responsables
des Transports
Bernadette Humeaux, Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette
Marie Larnaudie, Plaine Commune
Charlotte Marchandise, ville de Rennes, réseau des
villes-santé de l'OMS
Experts
du service de la Qualité de l'air et du service Transports
et mobilités de l'Ademe :
Nathalie
Martinez et Bertrand-Olivier Ducreux
Membres
du Réseau Action Climat :
Morgane
Creach, Charlotte Isard, Meike Fink
Bruno Gazeau, Fédération Nationale des Associations
d'Usagers des Transports
Olivier Schneider, Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette |
|
|
|
|
|
|
![]() Les villes Respire de demain
Les villes Respire de demain