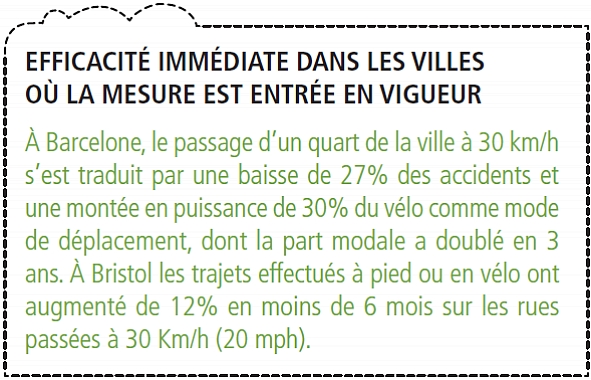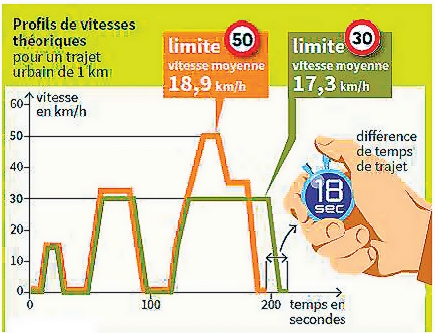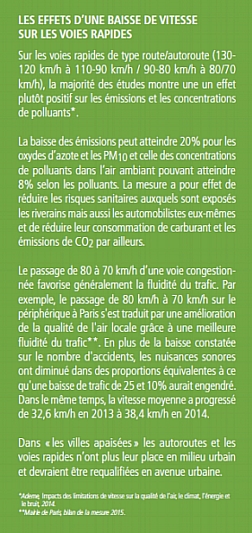|
Le
coût de la majorité des actions proposées dans ce
guide est relativement modeste en comparaison avec les investissements
traditionnels des collectivités. Des ressources dédiées
et pérennes sont néanmoins nécessaires pour garantir
au projet des moyens humains et financiers appropriés et une légitimité
suffisante pour être mené à bien. Mené avec
l’implication et le soutien d’une
pluralité d’acteurs locaux, l’investissement portera
rapidement ses fruits tant sur le plan économique que la qualité
de vie.
Un
plan de stationnement pour les véhicules, les deux-roues
motorisés et le vélo
|
Aujourd’hui, 15% des trajets automobiles effectués
en ville s’étalent sur moins de 500 mètres,
notamment parce qu’il est trop facile de stationner au
départ et à l’arrivée. Entre 5 et
20% des véhicules en circulation en ville sont à
la recherche d'une place de stationnement (GART ). Paradoxalement,
les automobilistes passent donc un temps considérable
à chercher une place, augmentant inutilement leur consommation
de carburant. Intuitivement, la tentation est grande de résoudre
cette situation en multipliant le nombre de places disponibles
et de proximité mais ce serait une erreur car la collectivité
conforterait le choix de la voiture. Plus généralement,
le recours à la voiture ayant tendance à décroître,
l’offre en stationnement devrait aussi être régulée.
Ces dernières décennies, les collectivités
ont fait le choix d’étendre les offres en stationnement
dans l’objectif d’attirer un nombre toujours croissant
de voitures. La tendance actuelle cherche davantage à
concilier des intérêts environnementaux et sociaux
au moyen d’une politique de stationnement plus équilibrée
afin de désencombrer la ville et d’atténuer
la congestion routière. La réforme du stationnement
en cours est l'opportunité de concrétiser et d'accélerer
cette tendance.
Réguler
le stationnement pour réguler le trafic
Le
stationnement est un facteur déterminant du taux de recours
à la voiture dans les déplacements locaux. À
Lille par exemple, si le stationnement est assuré sur
le lieu de travail, la voiture est choisie par 80% des gens.
Ce taux tombe à 58% quand ce n’est pas le cas.
Certaines politiques de gestion des conditions de stationnement
menées en France et à l’étranger
montrent qu’il est tout à fait possible d’infléchir
la politique de stationnement à l’aune d’une
politique de mobilité plus soutenable, sans s’attirer
une levée de boucliers de la part des habitants. Là
encore la pédagogie et le dialogue doivent être
de mise car la disponibilité comme le prix du stationnement
représentent des sujets délicats pour l'acceptation
publique.
Avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles s’opère
la décentralisation et la dépénalisation
du stationnement et avec elle, l’intégration
du stationnement comme outil clé des politiques de déplacements.
À partir du 1er janvier 2018, les collectivités
pourront fixer les prix horaires du stationnement et les montants
des redevances pour non-acquittement du paiement du stationnement
sur voirie, mieux gérer les flux automobiles et dégager
des ressources financières pour la mobilité durable.
Les collectivités pourront saisir cette nouvelle liberté
pour optimiser leur politique de stationnement de façon
à fluidifier la circulation routière au bénéfice
des automobilistes eux-mêmes tout en apportant des réponses
aux nouveaux enjeux qui vont de la mise à disposition
de places de stationnements pour les vélos à la
prise en compte des deux-roues motorisés et des mobilités
partagées. Ne sacrifiez pas vos efforts pour la mobilité
durable avec une politique de stationnement contradictoire !
La ville de Valletta, à Malte, a significativement réduit
le nombre de stationnements disponibles dans le centre-ville
tout en rendant payant le stationnement des non-résidents
- 6,25a/ jour - avec les bons résultats suivants :
-
Baisse de 7,4% du nombre de voitures dans le centre ville.
-
Hausse
de 10% de transfert de la voiture vers les transports publics,
le vélo et la marche à pied.
Favoriser
les mobilités alternatives
Adapter les parkings existants aux nouvelles mobilités
: on voit apparaître un nombre croissant de places
réservées aux covoitureurs ou à l’autopartage,
de panneaux d’autostop organisé, voire même
de box réservés aux vélos en libre-service,
de stations d’autopartage et de vélo en libre service,
etc. Le stationnement représente un levier déterminant
pour développer et promouvoir l’intermodalité.
Développer les aires de covoiturage aux abords
des axes très fréquentés et aux abords
des stations - terminus - de transports collectifs pour encourager
la pratique dans les déplacements quotidiens.
Tout bâtiment neuf de bureaux, commerces, cinéma
ou d'habitations, ou bien faisant l'objet de travaux de rénovation
doit désormais être équipé d'un parking
sécurisé pour les vélos et de bornes de
recharge pour les véhicules électriques.
Des tarifs adaptés à la transition
énergétique
Il
est grand temps de tourner la page du stationnement gratuit
pour assurer une rotation suffisante des véhicules motorisés
et diversifier l’offre de mobilité sur la voirie.
Sans stationnement payant, la ville reste remplie de voitures
ventouses. En outre, environ 65% des usagers ne payent
pas leur stationnement (GART) et s’exposent donc à
une amende alors que le paiement pourrait être facilité
et les contrôles plus réguliers.
D’autres idées pour des tarifs plus adaptés
aux objectifs de lutte contre la pollution existent :
-
Limiter le nombre de stationnements à tarif préférentiel
pour chaque ménage pour les encourager à se
tourner vers l’autopartage entre particuliers.
-
Inverser le rapport entre le prix du stationnement sur
voirie et celui du stationnement en ouvrage - privé
et ou public - afin de rééquilibrer le partage
de l’espace public au bénéfice d’autres
usages.
-
Réserver des modalités de stationnement favorables
aux véhicules moins polluants
grâce aux certificats Crit’air.
Avec la réforme de la dépénalisation du
stationnement, il sera bientôt possible de moduler la
tarification du stationnement sur voirie en fonction des quartiers
et des stratégies locales de redynamisation de certaines
zones. La collectivité pourra également décider
de moduler les tarifs selon le type d'usage du stationnement
pour tenir compte des différents besoins : livreurs,
professionnels...
Les idées reçues sur le stationnement
Idées
reçue 1 : No parking no business : sans parking,
les clients vont fuir !
Ouvrir le dialogue avec les commerçants locaux est indispensable
pour entendre leurs préoccupations et leurs besoins et
rechercher les meilleurs ajustements pour l'intérêt
général.
Idées reçue 2 :
Il n’y a pas de place pour se garer !
La politique de régulation du stationnement doit veiller
à rendre plus accessible l'offre disponible dans les
parkings fermés afin de dissuader le stationnement en
voirie.
Idées reçue 3 : C’est trop cher !
Au regard du taux actuel de non paiement - 65% environ selon
le GART - le coût actuel du stationnement en voirie s'avère,
en réalité, plutôt modeste en France.
|
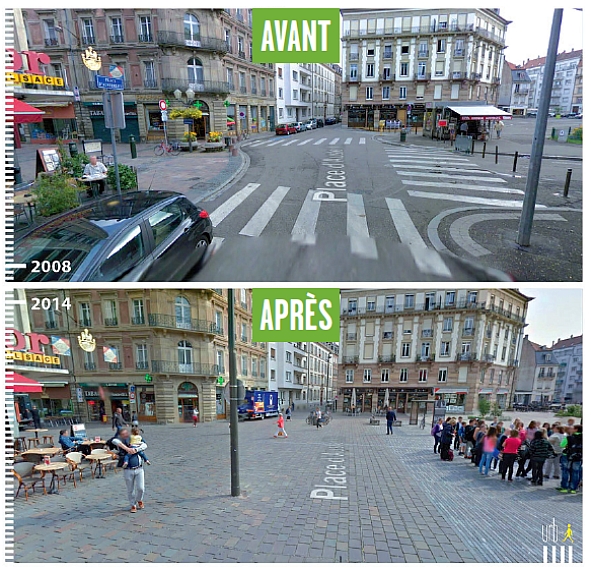 ©
Urb-i / Google streetview ©
Urb-i / Google streetview
Nîmes,
Poitiers, Bordeaux, Saint-Étienne, Dijon, etc.: toutes
ces villes ont réalisé des aménagements visant
à rééquilibrer le partage de l'espace public
en faveur des mobilités alternatives au transport routier.
Des clichés des progrès réalisés sont
observables sur urb-i.com
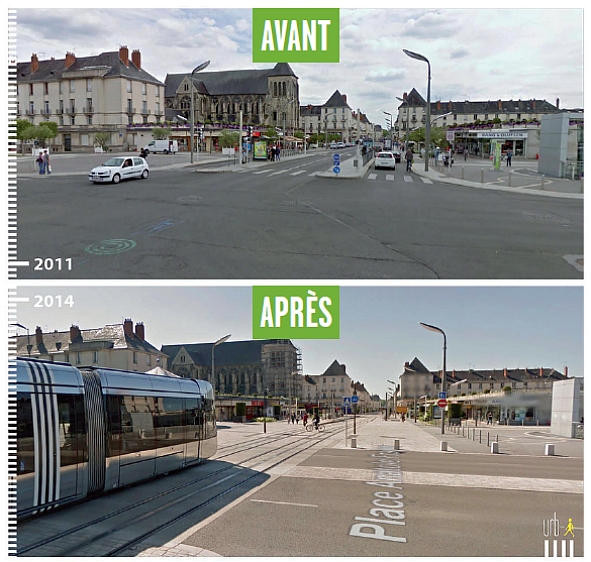 ©
Urb-i / Google streetview
©
Urb-i / Google streetview

©
Sam Saunders
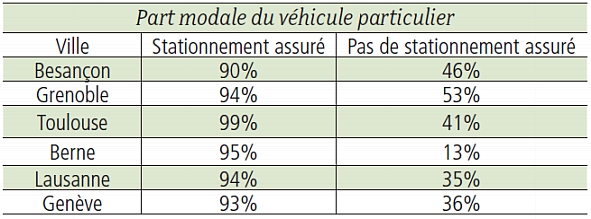
L’utilisation
de la voiture diminue de moitié au moins lorsque la possibilité
de
stationner à destination n’est pas garantie.
Source : Cédis, Indiggo Transport
et Écologie 2012
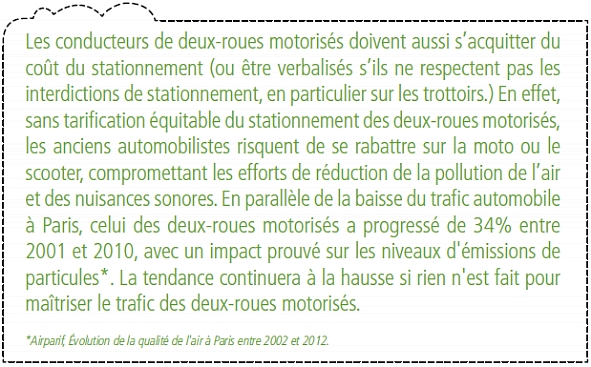
|
| Les
pistes pour emporter le soutien de la population locale à
une régulation du stationnement
Conseil
n°1 : Réévaluer les besoins de stationnement
Conseil n°2 : Rendre utiles les recettes du stationnement
Conseil n°3 : Et surtout, donner du sens à l’espace
libéré des parkings
|
| Les
zones à circulation restreinte : la moitié de la
population potentiellement mieux protégée !
|
| |
C’est
la grande nouveauté ! La Loi de transition énergétique
a donné aux maires et aux présidents d’établissement
public de coopération intercommunale qui disposent du pouvoir
de police la possibilité de mettre en place une zone à
circulation restreinte (ZCR) sur leur territoire si celui-ci est
couvert par un plan de protection de l'atmosphère (PPA).
L’objectif de la mesure est d’interdire la circulation
de certains véhicules en fonction de leur niveau de pollution
dans toute la ville ou bien sur une ou plusieurs zones délimitées,
de manière permanente ou temporaire. L'interdiction de
circuler peut s'appliquer aussi bien aux véhicules lourds
qu'aux véhicules légers ou deux-roues motorisés.
La mesure s’apparente aux zones à basses émissions
mises en oeuvre dans de nombreuses villes européennes et
dont l’efficacité environnementale sur le renouvellement
du parc automobile et sur la diminution des concentrations des
polluants dans l’air s’est fait ressentir très
rapidement. En France, la moitié de la population réside
dans le périmètre d'un PPA et pourrait donc être
mieux protégée. Une vingtaine de collectivités
territoriales ont été désignées lauréates
en 2015 de l'Appel à projet national Villes respirables
pour préfigurer ou créer des zones à circulation
restreinte. Ces villes pilotes sont accompagnées par les
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement
et du logement et doivent bénéficier d'un soutien
financier de l'État.
Mode d'emploi pour créer une zone à
circulation restreinte
La commune ou l’intercommunalité peut prendre
l’initiative d’une ZCR pour lutter contre la pollution
de l’air et inscrire son action dans le PPA et le Plan Climat
Air Énergie territorial. L’accord de l’État
est nécessaire pour inclure des voies du domaine public
routier national ou de voies du domaine public routier départemental.
Seule obligation, une étude d’impact environnemental
doit évaluer la réduction attendue des émissions
de polluants avec la création de la ZCR.
Les expériences de zones à basses émissions
en Europe et les études de faisabilité des zones
d'action prioritaire pour l'air (ZAPA, ex-ZCR) en France sont
riches d’enseignements. Les collectivités peuvent
agir à cinq niveaux au moins pour renforcer l’efficacité
environnementale, économique et sociale des zones à
basses émissions et leur acceptabilité et adapter
le dispositif de ZCR à leur territoire.
1ère
condition de réussite : Le périmètre de la
mesure
Tous les véhicules pouvant être concernés,
la collectivité peut choisir d'intégrer ou non les
véhicules lourds, les véhicules utilitaires légers,
les voitures et les deux-roues motorisés, en fonction de
ses particularités locales : source de pollution, taux
d'utilisation des véhicules, existence d'alternatives...
-
Plus le scénario est ambitieux - périmètre
géographique, catégories de véhicules
- plus les gains sont significatifs sur la qualité
de l'air. Il faut cibler les véhicules non pourvus
de filtres à particules en premier lieu. L’amélioration
de la qualité de l’air est nette : des réductions
des concentrations de NO2 et de PM10 dans l’air ambiant
de 1 à 10% peuvent être observées ainsi
qu’une diminution du nombre de journées de dépassement
de la concentration journalière en PM10. Le nombre
de citadins exposés à des niveaux de pollution
qui dépassent les valeurs limites réglementaires
diminue.
-
Le contrôle est indispensable : la réussite du
dispositif repose en grande partie sur les moyens de surveillance
déployés. Une période blanche à
visée pédagogique peut être envisagée
mais les sanctions devront être effectives pour dissuader
les infractions relatives à l'interdiction de circuler.
2ème
condition de réussite : La progressivité de la
mesure
Les véhicules autorisés dans la zone à
circulation restreinte sont choisis en fonction de leur motorisation
- diesel, essence ou électrique, hydrogène - et
de leur taux d’émissions de polluants atmosphériques,
réglementé par les normes Euro. La collectivité
dispose de la nomenclature des véhicules de 2016, sur
laquelle se fonde le dispositif de macaron Crit’air
lancé en juillet 2016. Ce dernier permet d'identifier
visuellement les véhicules concernés ou non par
le dispositf de restriction de circulation.
Commencer au plus tôt une mise en oeuvre progressive de
la mesure permet de gagner le soutien de la population locale.
Rien ne vaut la démonstration par les faits !
Limiter
la circulation des camions et des cars avant d’appliquer
la mesure aux voitures peut donc constituer une première
étape dans le cadre d’un plan échelonné
sur plusieurs années. En revanche, l’impact sur
les concentrations de polluants sera moins marqué. La
lutte contre la pollution de l’air ne peut passer à
côté du premier contributeur des sources d'emissions
de polluants : les véhicules particuliers.
Pour ne pas faire de déçus, la ZCR doit être
mise en oeuvre sur une zone desservie par les transports alternatifs.
Le calendrier de mise en oeuvre doit être connu suffisamment
à l’avance afin de permettre aux particuliers et
aux professionnels de se préparer et de s’adapter
à la mesure
3ème
condition de réussite : Des possibilités d'exemption
pour quelques-uns
Les collectivités peuvent ajouter des dérogations
particulières aux dérogations nationales prévues
: véhicule d’intérêt général,
de personnes à mobilité réduite, du ministère
de la défense et les transports collectifs basses ou
très basses émissions. Ce peut être une
condition de mise en oeuvre et de succès de la zone à
circulation restreinte, à condition que ces dérogations
permettent de véritablement lever certaines barrières
liées à des cas particuliers. Les professionnels
et les personnes dont les revenus sont modestes peuvent se trouver
dans une impasse pour se déplacer. Si une minorité
de véhicules bénéfice de dérogations,
l’efficacité de la mesure n’est pas remise
en cause.
4ème condition de réussite : Ne pas faire cavalier
seul
Il va de soi que le processus d’élaboration de
la zone à circulation restreinte ainsi que ses modalités
de mise en oeuvre mérite l’implication de tous
les acteurs du territoire pendant la phase préparatoire.
Comme la pollution, le territoire d’une zone à
circulation restreinte ne correspondra pas nécessairement
au territoire de la commune ou de la communauté de communes.
Il est souvent plus pertinent de raisonner au-delà des
frontières administratives ou bien de co-construire le
projet au niveau de la communauté de communes voire même
du département ou de la région pour tenir compte
des flux ou des dynamiques et des dichotomies existantes entre
périphérie et centre-ville, milieu rural et zone
urbaine. Le dimensionnement de la zone à basses émissions
est variable et dépend du contexte local. Une démarche
collective est bénéfique grâce au partage
des responsabilités, des coûts de mise en oeuvre
et des mesures d’accompagnement mais aussi pour garantir
la pérennité de la mesure dans le temps
5ème
condition de réussite : Des aides à la transition
et des dispositifs de soutien
Accompagner les plus fragiles : une prime à la conversion
automobile - aide au renouvellement du véhicule - a été
mise en place au niveau national pour remplacer un véhicule
ancien diesel par un véhicule à plus faibles émissions.
Ces aides peuvent être complétées au niveau
local par des aides au changement de mode de transport ou bien
de changement de véhicule utilitaire pour les professionnels
par exemple.
Communiquer avec pédagogie : les habitants comme les
visiteurs ont besoin d’information claire pour comprendre
le fonctionnement des ZCR. Un numéro téléphonique
peutêtre mis à disposition des habitants, des entreprises
et des
professionnels indépendants pour informer et conseiller,
au moins au début de la mise en place du dispositif.
La pédagogie et la valorisation des bénéfices
de l’action seront de mise.
LA
ZCR ne peut se suffire à elle-même
Les expériences montrent que ce dispositif ne peut constituer
à lui seul une solution aux problèmes de dépassements
des valeurs limites réglementaires pour la qualité
de l’air et doit s’inscrire dans le cadre d’un
plan d'actions plus large.
Les études menées sur les zones à basses
émissions ou leur expérimentation témoignent
aussi de la nécessité de combiner habilement les
mesures restrictives aux actions de promotion des alternatives.
Pour diminuer l’emprise de l’automobile en ville,
encore faut-il rendre les alternatives possibles et attractives.
Les personnes touchées par la ZCR expriment des attentes
fortes en matière de transports en commun et d’accompagnement
au report modal qu’il ne faut pas sous-estimer.
|
|
Les
villes lauréates de l'appel à projet Villes respirables
(2015)
Les
zones à circulation restreinte potentielles en France :
ces villes ont été nommées lauréates
de l'appel à projet Villes Respirables pour la création
ou la préfiguration d'une zone à circulation restreinte
sur leur territoire.
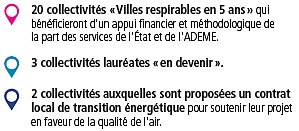
Les
zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère
(PPA)
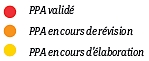
Source
: Ministère de l'environnement |
Pour
aller plus loin :
-
Ademe, Les zones à faibles émissions (Low Emission
Zones - LEZ) à travers l'Europe, 2014.
-
Ademe, Synthèse des études de faisabilité
réalisées par les sept collectivités ZAPA,
2015.
-
Ademe, État de l'art sur les péages urbains :
objectifs recherchés, dispositifs mis en oeuvre et impact
sur la qualité de l'air, 2014.
|
Des
zones de circulation apaisée aux zones à trafic
limité |
| Le
code de la rue à fait son apparition en 2008 avec la création
de nouvelles zones de circulation apaisée et la
modification des aires piétonnes. Depuis, ces zones se
sont largement développées. Les collectivités
peuvent aussi faire primer leur droit à l’expérimentation
pour aller plus loin et rétablir un partage plus équitable
entre les modes de transport dans des zones plus étendues.
Ouvrir des zones à circulation apaisée et des espaces
mixtes, c’est avancer pas à pas dans une ville conviviale,
pacifiée et pratique à la fois. Ces zones apportent
des réponses à différentes attentes: augmenter
la fréquence et la régularité des transports
en commun, favoriser le vélo et la marche à pied,
limiter les nuisances notamment sonores, préserver le centre
ville, etc. Ces aménagements doivent naturellement s’intégrer
dans une démarche globale qui articule la lutte contre
la pollution de l’air et les émissions de gaz à
effet de serre avec les politiques de déplacements (PDU)
et d’urbanisme (PLUi). Les zones à trafic limité
représentent un exemple de projet abouti.
Développer
les zones à circulation apaisée
Les lieux à apaiser en premier
-
Les parvis et les places centrales, les quartiers touristiques
et historiques.
-
Les zones concentrées de commerces, services publics,
transports.
-
Les rues résidentielles ou de lotissements, les éco-quartiers.
Ces
zones doivent être pensées dans une stratégie
globale d’aménagement à l’échelle
du territoire et ne sont pas réservées aux quartiers
centraux. A fortiori, seule une minorité de la voirie urbaine
est consacrée à l'écoulement du trafic, le
reste de la chaussée faisant généralement
l'objet de déplacements fonctionnels liés à
l'habitat ou aux sorties des écoles... La circulation peut
donc aisément être ralentie et apaisée, en
dehors des axes de grande circulation.
Ça doit se voir !
La zone à circulation apaisée doit être facilement
reconnaissable par les différents usagers de le voirie.
Certains signes ne trompent pas : il est ordinaire de marcher
sur la route sans risque dans une zone de rencontre à condition
que celle-ci soit aménagée au profit de tous. Paradoxalement,
les feux, les panneaux stop ont pour effet d’encourager
les excès de vitesses et peuvent donc être supprimés
dans ces zones.
Et les autres ? Vélos, transports en commun, c’est
au maire de décider !
Le maire peut décider de la circulation des vélos
et des transports publics dans les aires piétonnes. De
même, les commerçants peuvent se faire livrer à
certains horaires. À condition d’inscrire sur le
panonceau livraison de 7h à 10h.
Il
suffit d’un sens interdit… pour faire respirer tout
un quartier
Nantes
La ville de Nantes expérimente depuis 2012 une zone à
trafic limité autour du boulevard des 50 Otages. Les véhicules
des riverains - les familles disposent de deux macarons - des
artisans, des livreurs et des commerçants, sans oublier
les bus et les taxis, peuvent circuler librement. Les touristes
peuvent accéder au centre-ville sous couvert de présenter
une réservation d’hôtel.
C'est en installant un panneau sens interdit à
l'entrée du quartier central que Nantes a fait bon usage
de son droit à l'expérimentation et mis en place
une zone à trafic limité sur le modèle italien.
La communication est clé ! La métropole de Nantes
a communiqué de manière positive auprès du
grand public avant et pendant les travaux tout en consacrant des
efforts particuliers pour des publics spécifiques. Les
commerçants ont bénéficié d'une attention
particulière qui s'est concrétisée par la
distribution d'un guide dédié sur la question des
travaux. Les transporteurs, les livreurs et les artisans ont également
été en première ligne de la concertation
engagée par la métropole. La ZTL de Nantes a eu
pour effet de doubler le trafic cycliste en un an dans la zone.
Le nombre de véhicules passant par jour sur le cours des
50 Otages a été divisé par trois. Nantes
a aussi choisi la ville apaisée comme nouvelle
identité.
Montpellier
En tête des classements des villes préférées
des Français, Montpellier a piétonnisé une
grande partie de son centre-ville depuis 2004, et comptabilise
aujourd’hui, après plusieurs vagues de piétonisation,
plus de 24 kilomètres de rues piétonnes, contre
300 m à Toulouse par exemple. La démarche répondait
à trois objectifs : préservation de l’environnement,
dynamisme du commerce et protection du patrimoine, et a été
complétée par la création d’un réseau
de tramways particulièrement dense et convivial dont le
développement se poursuit aujourd’hui.
La
piétonisation a des effets bénéfiques sur
la qualité de vie et la pollution : l’accès
au centre-ville est désormais effectué davantage
en vélo ou à pied (35%) qu’en voiture (25%)
et majoritairement en transports en commun (40%).
Paris
À Paris, la fermeture aux voitures des voies sur berges
sur la rive droite de la Seine s’est avérée
positive sur le plan acoustique selon Bruitparif et de la pollution
de l’air avec une baisse de 15% du dioxyde d’azote
sur le site, et ce, au prix de deux petites minutes supplémentaires
de temps de parcours entre l’Est et l’Ouest de la
ville seulement.
Pour
aller plus loin, les collectivités peuvent s’inspirer
des zones à trafic limité à l’italienne
Le principe des zones à trafic limité consiste
à réserver la possibilité de circuler aux
résidents, ainsi qu’aux transports publics et aux
services de sécurité et d’interdire l’accès
à la majorité des véhicules de façon
permanente ou à certains
horaires. Dans certains cas, la zone à trafic limité
italienne fonctionne sur la base d’un péage d’accès
pour les véhicules. Apparues en Italie dans les années
1960, avant d’être consacrées par une législation
nationale en 1989, il existe plus de 100 zones à trafic
limité en Italie aujourd’hui, qui couvrent généralement
les centres historiques. Les motivations répondent à
des enjeux de sécurité, santé, ordre public,
patrimoine environnemental et culturel – autant de préoccupations
impactées par le trafic automobile.
Les règles
- À
la différence des zones à basses émissions
ou des zones à circulation restreinte françaises,
les autorisations de circuler ne dépendent pas de la
pollution des véhicules, sauf pour les électriques
et hybrides qui peuvent être avantagés.
-
Malgré l’attachement à la Vespa, les deux-roues
motorisés sont généralement exclus des
zones à trafic limité. En France ils peuvent aussi
être interdits d’accès dans les zones à
circulation restreinte.
-
Les livraisons sont autorisées en fonction de leur tonnage
et des horaires - entre 6 et 9h à Sienne par exemple
-et doivent respecter les emplacements dédiés.
-
Le nombre de véhicules autorisés par foyer - à
titre gratuit ou payant, cela dépend - varie en fonction
de la collectivité.
-
Le stationnement est généralement délimité,
voire interdit pour les résidents qui ont un parking
privé.
Les
exceptions qui confirment la règle
Des dérogations sont prévues pour les transports
publics, les taxis, les véhicules de services public -
gaz, téléphone, service de nettoiement, poste, services
municipaux… - les médecins en service, la police,
les pompiers et les secours, les personnes invalides et certains
véhicules, comme les voitures électriques. À
Sienne, les artisans peuvent circuler pendant les heures de travail.
Un
dispositif plébiscité
-
Avant même leur apparition dans la loi, la mise en place
de zones à trafic limité avait recueilli le soutien
massif de la population - de 60 à 70% - à l’occasion
de référendums locaux au début des années
198028.
- À
Padoue, les effets sur les commerces et les résidents
sont positifs, alors même que les commerçants y
étaient plutôt opposés, comme en témoignent
le nombre de baux commerciaux et l’augmentation des prix
de l’immobilier.
-
Aujourd’hui, de nouvelles zones à trafic limité
font leur apparition, comme à Bologne, mais aussi dans
les régions plus méridionales, comme à
Naples.
-
Le contrôle, assez strict, représente généralement
une source de financement pour la commune. Efficacité
environnementale grâce au report modal Dans certaines
villes italiennes, la pratique du vélo est digne des
pays nordiques. Ces résultats ont été obtenus
grâce à la création des zones à trafic
limité. Les transports en commun sont fluides et sont
de plus en plus fréquentés en ville.
|

©
Alain Rouiller |
| La
zone de rencontre
La zone de rencontre permet à la rue de retrouver la diversité
de ses usages, en redonnant la priorité au piéton.
La différence avec la zone piétonne est la présence
de véhicules motorisés. Mais le piéton bénéficie
de la priorité sur tous - sauf le tramway - sur toute la
largeur de la voie, même la chaussée. La vitesse
des véhicules est limitée à 20 km/h, et le
stationnement impossible sur ces voies. Au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas, les rues calmes et à vélo qui s’apparentent
aux zones de rencontre en France ont changé la qualité
de vie. |
 |
| L’aire
piétonne
C’est une zone dédiée où seuls les
tramways ont la priorité sur les piétons. Les cyclistes
et les véhicules doivent rouler au pas. La circulation
des véhicules motorisés est exceptionnelle, et conditionnée
à la desserte de la zone, de même que le stationnement,
y compris pour les résidents. Un accès temporaire
à la zone piétonne peut être maintenu pour
les véhicules motorisés des riverains et les livreurs
qui disposent d'un badge pour passer les bornes automatiques. |
 |
| Zone
30
La zone 30 est aussi une zone de circulation qui se veut apaisante
puisqu’elle limite à 30 km/h la vitesse des véhicules
et rassure les autres usagers de la voirie (piétons et
cyclistes). La généralisation des double-sens cyclables
y est devenue obligatoire (décret juillet 2008). Mais limitée
à quelques voies seulement, les effets de la zone 30 ne
sont pas perceptibles. La ville 30 est nettement plus audacieuse
!
À vos marques ! Prêts ? Partez !
Il est possible de commencer certains jours, à certains
horaires… C’est ainsi que l’opération
Paris respire consistant à fermer les berges de
la Seine et d’autres quartiers de Paris à la circulation
routière le dimanche a évolué vers la piétonisation
pérenne des voies sur berges. Comme nous sommes tous piétons,
nous en profitons tous ! |
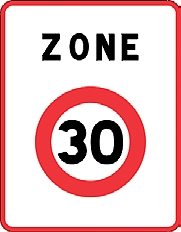 |
| 
La
zone à trafic limité de Nantes
© Alain Rouiller

© Alain Rouiller
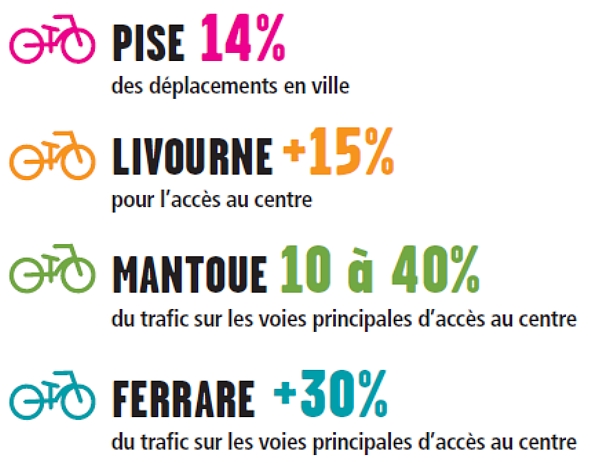 La
part du vélo dans les déplacements dans les zones
à trafic limité La
part du vélo dans les déplacements dans les zones
à trafic limité
Source
: Rue de l'Avenir, Les zones à trafic limité, la
solution italienne, 2014
Aller plus loin
-
Cerema - Direction technique Territoires et ville, Une voirie
pour tous
voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr
-
Cerema - Les zones de circulation apaisée - Une voirie
pour tous 2012
-
Rue de l'Avenir - Les zones à trafic limité,
la solution italienne, 2014
|
Efficacité
environnementale grâce au report modal
Dans certaines villes italiennes, la pratique du vélo est
digne des pays nordiques. Ces résultats ont été
obtenus grâce à la création des zones à
trafic limité. Les transports en commun sont fluides et
sont de plus en plus fréquentés en ville.
|
La
ville à 30 - réduire les limitations de vitesses
en ville et sur les rocades
|

©
Sylvain Frappat - Ville de Grenoble 2014

©
Sylvain Frappat - Ville de Grenoble 2014

©
Alain Rouiller
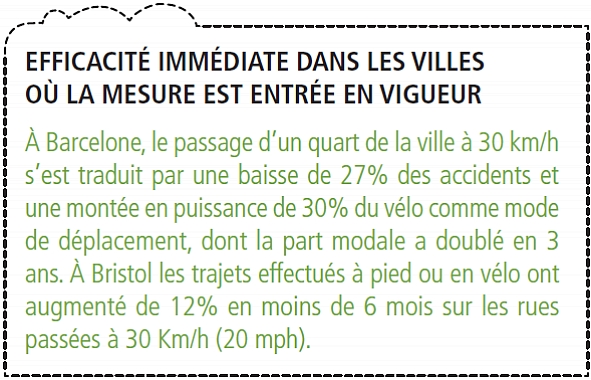
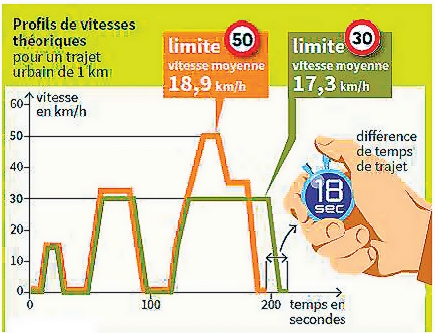
La
vitesse moyenne diminue à peine
avec la baisse des limitations de vitesse
Source : ville30.org
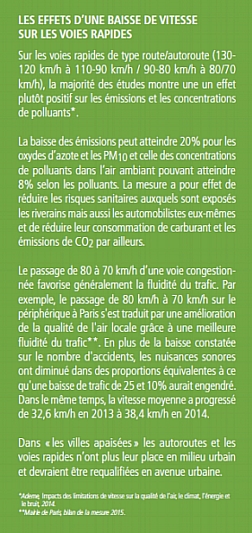
|
La
loi de transition énergétique pour la croissance
verte a introduit la possibilité pour le maire de réduire
la vitesse de circulation sur tout ou partie des voies de l’agglomération.
Non seulement, le maire peut décider de passer toute sa
ville ou la majorité de la voirie à 30 km/h alors
que seules les zones 30 étaient autorisés
jusqu'en 2015 mais il a également la liberté de
diminuer la limitation des vitesses sur les rocades et les grands
axes. Cette mesure à fait ses preuves là où
elle a été mise en oeuvre en France et à
l'étranger, en contribuant à rééquilibrer
le partage de l'espace public et à favoriser le report
modal mais aussi à diminuer les pollutions et les insécurités
routières.
Inversez
la règle et l’exception
Dans la ville à 30 nulle obligation d’abaisser
la vitesse à 30 km/h sur la totalité de la voirie
mais la vitesse de 30 km/h est la mieux adaptée sur 80%
de la voirie urbaine, à commencer par les zones résidentielles,
les rues commerçantes et aux abords des écoles.
Certains grands axes, où circulent notamment les lignes
de bus structurantes peuvent rester ou passer à 50 km/h.
Aux Pays-Bas, la vitesse maximale est d’ores et déjà
limitée à 30 km/h sur 80% du réseau urbain.
Une baisse de 42% des accidents a été constatée
depuis la mise en place des zones 30 et des espaces de rencontre.
La ville 30 est tendance
Après les annonces de Paris sur l’objectif de mettre
la moitié de la capitale à 30 km/h dès
2016 - contre 20% en 2015 -, la métropole de Grenoble
lui a emboité le pas en généralisant la
limitation des vitesses de 30 km/h à l'ensemble de 43
communes sur 49. Dans la métropole apaisée, 30
km/h devient ainsi la règle et non plus l’exception.
Un certain nombre de petites et moyennes villes françaises
ont déjà generalisé le 30 km/h - Sceaux,
Ville-du-Bois, Fontenay-aux-Roses - et d'autres villes pourraient
bientôt préciser les mêmes ambitions : Annecy,
Rodez, Tournai...
Une
efficacité à moindre coût
La mesure a un coût relativement modeste qu’il faut
engager pour les marquages au sol et les panneaux, et éventuellement
les contresens cyclables et les feux pour vélos. Paris
consacre 4 millions d’euros pour baisser la vitesse maximale
sur 173 km de rues. L’usage du vélo se développe
naturellement et exige moins d’investissements dans les
aménagements dédiés. La Suisse économise
120 à 130 millions d'euros par an grâce à
la généralisation du 30 km/h dans 30 zones.
Les
atouts de la ville à 30km/h pour la population locale
La
sécurité routière progresse
Le risque baisse considérablement : alors qu’il
faut 13 mètres pour s’arrêter lorsqu’on
roule à 30 km, l’automobiliste roulant à
50 km/h aura parcouru 14 m avant même d’avoir commencé
à freiner ! Le choc est moins grave : lors d’un
choc avec un piéton ou un cycliste à 50 km/h le
risque de décès est multiplié par 9 par
rapport à un choc à 30 km/h. De manière
générale l’OCDE estime que le passage à
la Ville 30 permet de réduire d’environ 25% les
accidents corporels et jusqu’à 40% le nombre de
blessés graves. Les villes ayant adopté ce concept
de « Ville 30 » constatent toutes une forte diminution
de la mortalité et des blessés graves sur leurs
routes : -20% des accidents à Hambourg en Allemagne depuis
l’instauration des zones 30 et -25% d’accidents
à Bruges en seulement 7 mois après le passage
à 30 Km/h d’une grande partie de la ville. En dix
ans, le nombre d'accidents a été divisé
par trois dans la commune de Fontenay-aux-Roses selon le maire
Pascal Buchet.
La pollution baisse
L’impact direct au niveau local est contrasté :
en ville, le passage de 50 km/h à 30 km/h peut augmenter
ou diminuer légèrement la pollution - entre -10%
à +30% -, en fonction de la configuration des voies -
rue canyon -, de la présence de ralentisseurs et de la
fluidité du trafic. Néanmoins, la congestion routière
tend à augmenter les émissions de polluants. Abaisser
la limitation des vitesses peut donc s’avérer positif
à condition de fluidifier le trafic en limitant le nombre
de ralentisseurs par exemple et en aménageant la voirie.
Si
le passage à 30 km/h ne peut garantir seul une baisse
de la pollution localisée, la vitesse de 30 km/h a un
effet catalyseur, par l’effet dissuasif qu’elle
occasionne sur l’utilisation de la voiture et positif,
sur les autres modes de déplacement qui sont moins polluants.
En effet, en augmentant le sentiment de sécurité
des cyclistes et des piétons et leur réelle sécurité,
la vitesse à 30 km/h encouragent la mixité des
modes de déplacement.
Le niveau sonore diminue
Réduire de 10 km/h la vitesse de la circulation routière
a pour effet de diminuer de 2-3 dB le volume sonore. Le bruit
causé par 5 voitures roulant à 50 km/h est le
même que 10 voitures roulant à 30 km/h.
Sans pénaliser les automobilistes
En réalité, si la limitation de vitesse baisse,
on ne va pas vraiment moins vite. La vitesse limite est rarement
atteinte en ville, la vitesse moyenne n’étant souvent
que de 18,9 km/h en réalité. Abaisser la vitesse
limite revient à limiter avant tout les points d’accélération,
ce qui a pour effet de diminuer la vitesse moyenne à
17,3 km/h. En théorie une baisse de 40% de la limitation
de vitesse en ville entraîne une baisse de 10% de la vitesse
moyenne et une hausse de 10% du temps de parcours. Les
automobilistes jouissent des conditions de sécurité
routière renforcées et d'une baisse de la pollution
locale.
Mise
en oeuvre : de l’information à la verbalisation
Dans un premier temps, il peut être opportun de suivre
l’exemple de Grenoble qui souhaite mettre en place des
radars à visée pédagogique. Des sanctions
devront en revanche être imposées aux automobilistes
qui ne respecteraient pas la nouvelle limitation de vitesse.
Donner à voir et communiquer de façon
positive
En vue de faire connaître les bienfaits de la mesure au
plus grand nombre, la ville peut lancer une grande campagne
d’information pédagogique en commençant,
par exemple, aux abords des écoles et des résidences
pour personnes âgées, où la mesure semble
plus qu’évidente. La réduction des vitesses
maximales est mieux acceptée une fois qu’elle a
été mise en place et pu porter ses fruits. Pourquoi
ne pas organiser une course entre les différents modes
de transports pour casser le mythe de la vitesse automobile
en ville ?
Évaluer les impacts de la politique menée
Il est indispensable de mesurer les impacts de la mise en place
d’une zone 30, d’une zone de rencontre ou de la
limitation à 30 km/h de toute une ville. Non seulement
cela permet de constater l’efficacité du dispositif
et de communiquer sur cette efficacité mais cela permet
aussi de relever d’éventuelles faiblesses et, si
besoin, de réaliser des ajustements pour améliorer
le dispositif.
La ville à 30 km/h constitue un point de départ
pour apaiser la circulation routière et la ville dans
son ensemble. Les communes ayant choisi le 30 km/h vont généralement
plus loin avec la piétonisation de certaines voies, la
généralisation des contre-sens cyclables, la création
de zones de rencontres et de zones à 20 km/h, au profit
des mobilités douces.
-
Le
site internet de la pétition citoyenne pour la généralisation
de la vitesse limite de 30 km/h dans les villes européennes
: ville30.org
-
Ademe, Impacts des limitations de vitesse sur la qualité
de l’air, le climat, l’énergie et le bruit,
2014
|
Les villes Respire de
demain : agir sur la mobilité et les transports pour
faire face à l'urgence sanitaire et climatique
Basé en large partie sur le transport
routier, notre modèle de transports est à bout
de souffle : premier secteur d'émissions de gaz à
effet de serre en
ville et l'une des principales causes de pollution de l'air,
la prédominance du tout voiture a un coût élevé
pour les acteurs économiques, les citoyens et la collectivité
toute entière. Fort heureusement, les collectivités
territoriales disposent d'un nombre croissant d'outils pour
agir à la source et modérer la place des véhicules
motorisés et polluants au profit des mobilités
alternatives, qu'elles soient actives comme le vélo et
la marche à pied ou collectives et partagées.
Comment assumer ses responsabilités tout en bâtissant
des villes où il fait bon respirer en emportant le soutien
de la population locale ? Les solutions favorables au report
modal ne manquent pas. Elles n'attendent que vous pour être
concrétisées dans les territoires !
|
Le
Réseau Action Climat-France
Association spécialisée sur le thème des
changements climatiques, regroupant 15 associations nationales
de protection de l’environnement,
de solidarité internationale, d’usagers des transports
et d’alternatives énergétiques, elle est
le représentant français
du Climate Action Network International, fort de 900
associations membres dans le monde.
Les
missions du rac sont :
-
Suivre les engagements et les actions de l'État et
des collectivités locales en ce qui concerne la lutte
contre les changements climatiques.
-
Dénoncer les lobbies et les États qui ralentissent
ou affaiblissent l'action internationale.
-
Proposer des politiques publiques cohérentes avec les
engagements internationaux de la France
|
 Les
villes Respire de demain
Les
villes Respire de demain
Rédactrice
: Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports
au Réseau Action Climat France
Graphisme : solennmarrel.fr
Remerciements
:
Aux membres du Comité de pilotage pour leurs précieux
conseils.
Aux experts du service de la Qualité de l'air et
du service Transports et mobilités de l'Ademe ainsi
qu'aux membres du Réseau Action Climat pour leur
relecture attentive.
|
| |
Les
villes Respire
de demain |
|
Comité de pilotage :
Mohamedou
Ba, Marie Pouponneau, Ademe
Silvano Domergue, Stéphane Taszka, Commissariat Général
au Développement Durable
Marie Molino, Groupement des Autorités Responsables
des Transports
Bernadette Humeaux, Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette
Marie Larnaudie, Plaine Commune
Charlotte Marchandise, ville de Rennes, réseau des
villes-santé de l'OMS
Experts
du service de la Qualité de l'air et du service Transports
et mobilités de l'Ademe :
Nathalie
Martinez et Bertrand-Olivier Ducreux
Membres
du Réseau Action Climat :
Morgane
Creach, Charlotte Isard, Meike Fink
Bruno Gazeau, Fédération Nationale des Associations
d'Usagers des Transports
Olivier Schneider, Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette |
|
|
|
|
|
|
![]() Les villes Respire de demain
Les villes Respire de demain


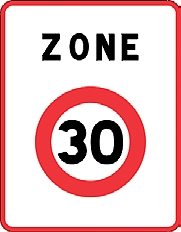
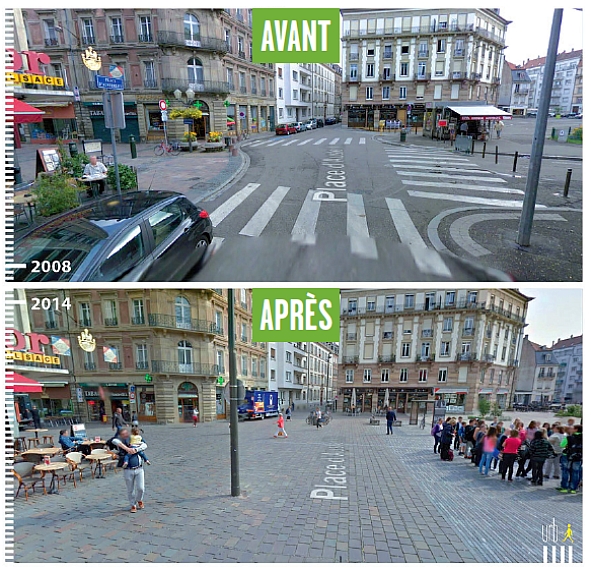 ©
Urb-i / Google streetview
©
Urb-i / Google streetview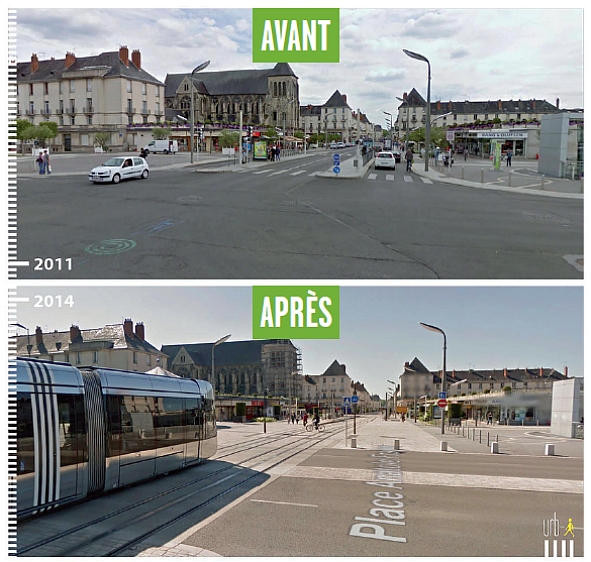 ©
Urb-i / Google streetview
©
Urb-i / Google streetview
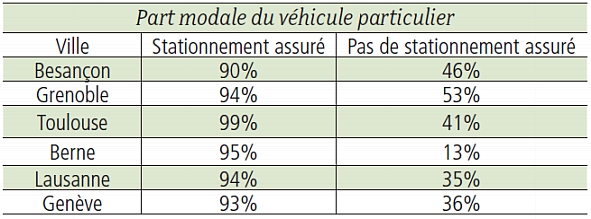
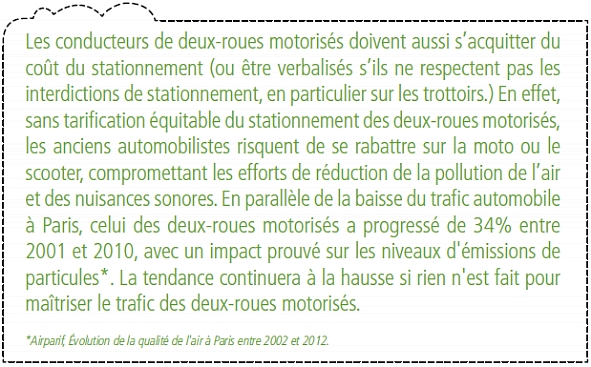


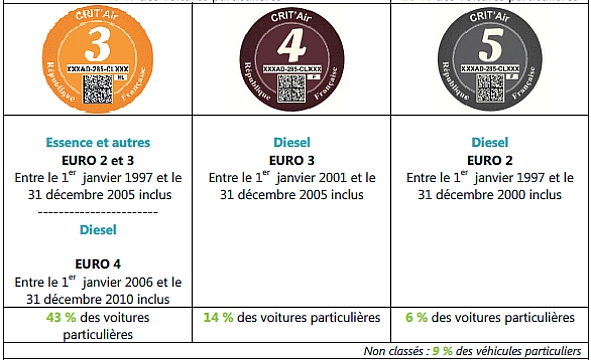

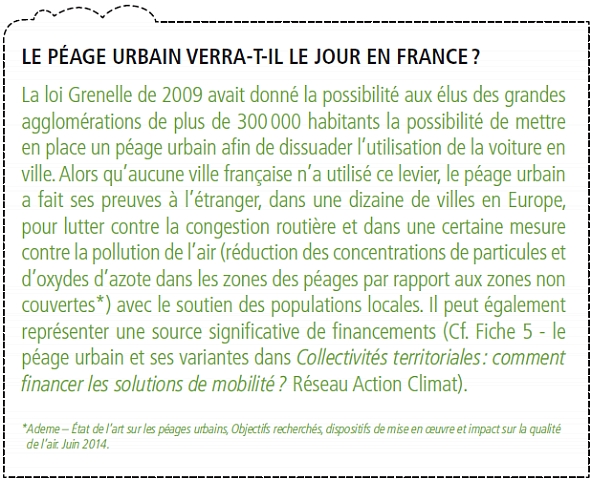
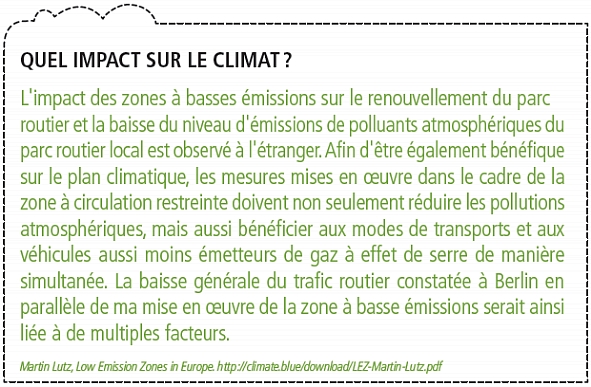
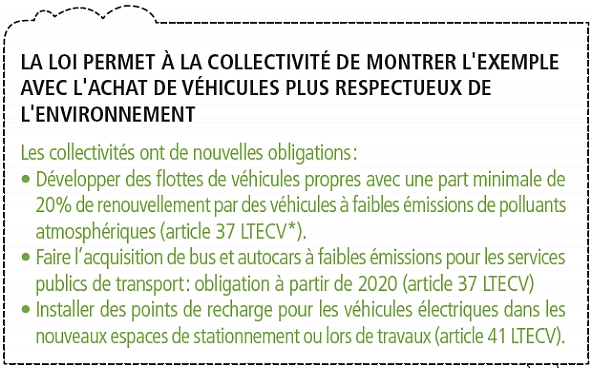
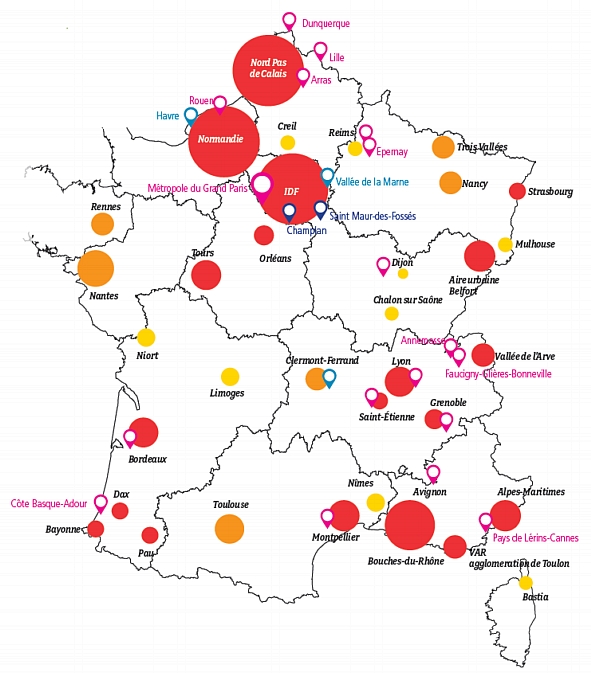
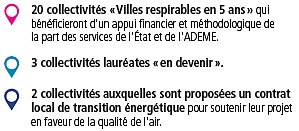
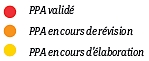


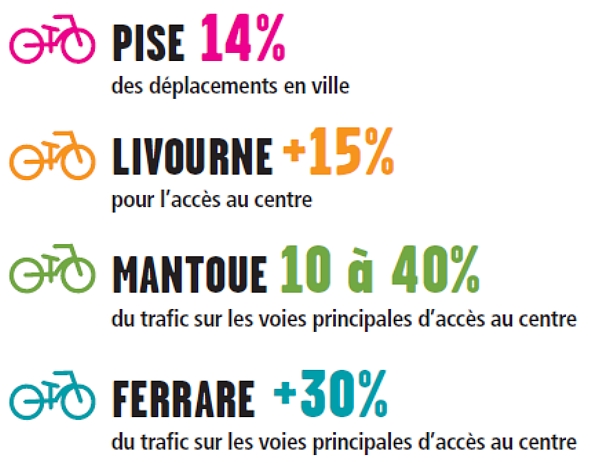 La
part du vélo dans les déplacements dans les zones
à trafic limité
La
part du vélo dans les déplacements dans les zones
à trafic limité