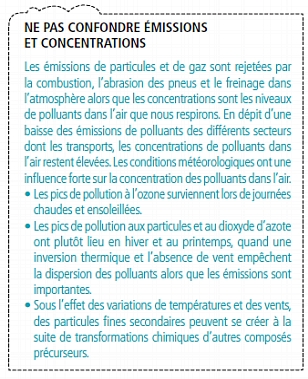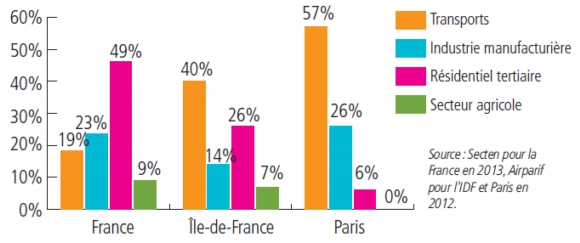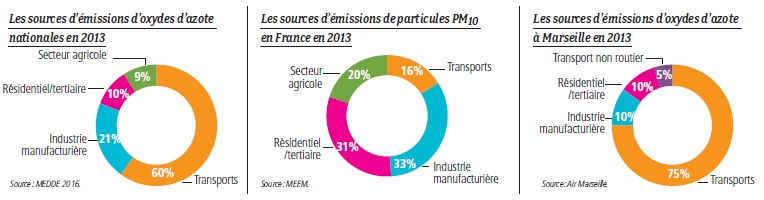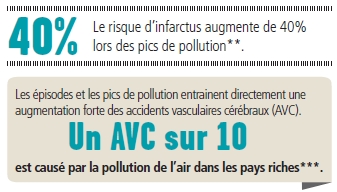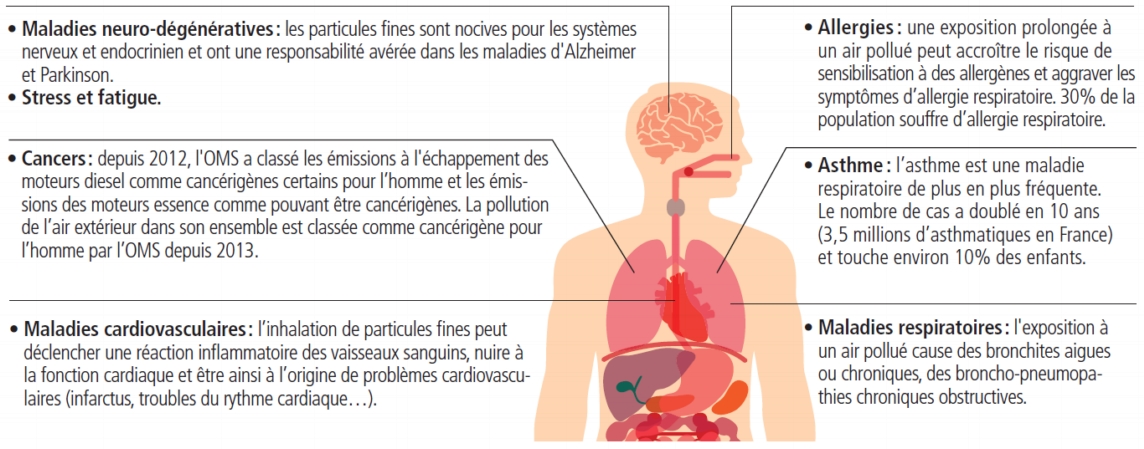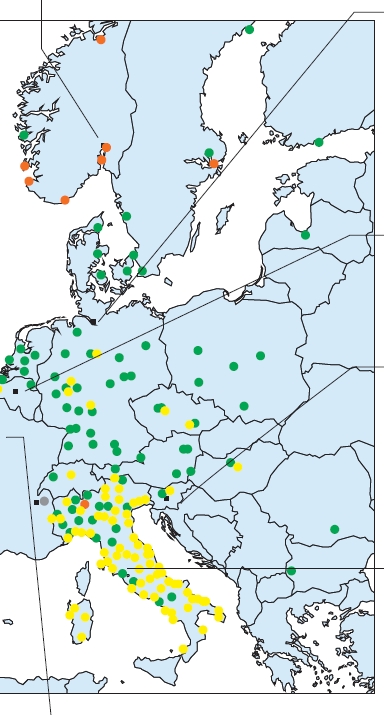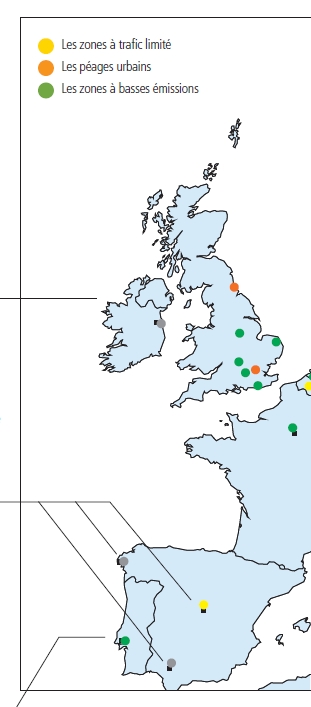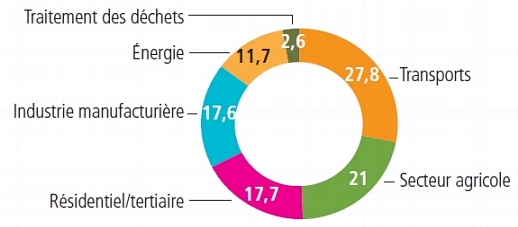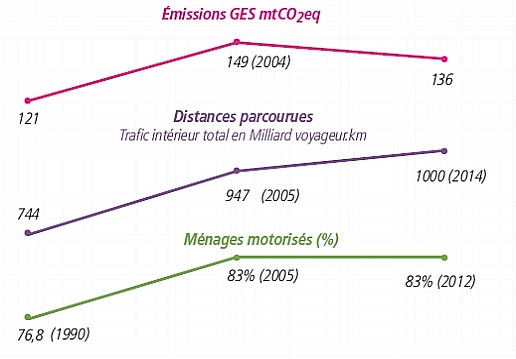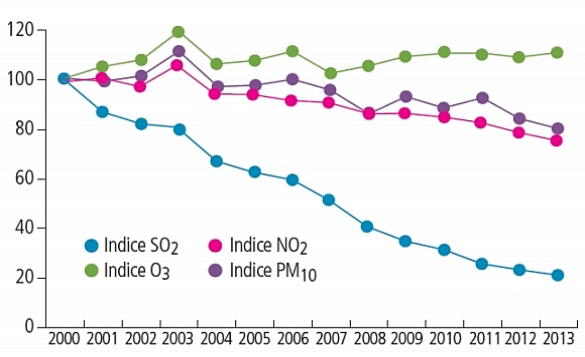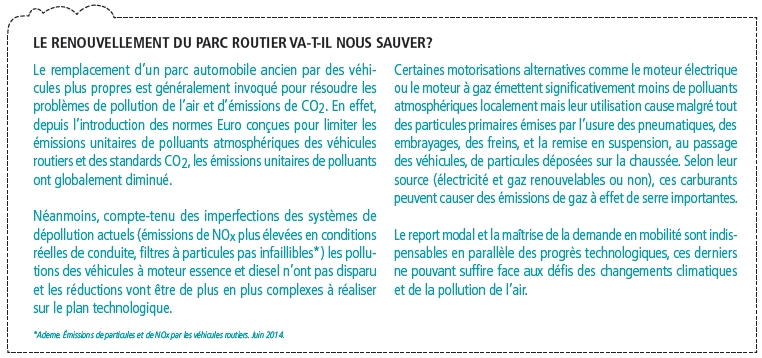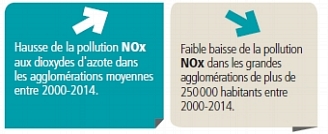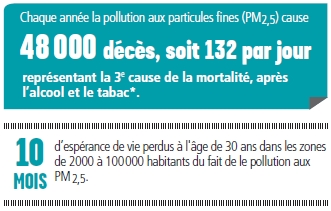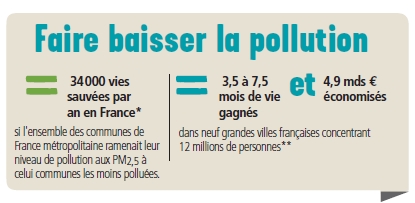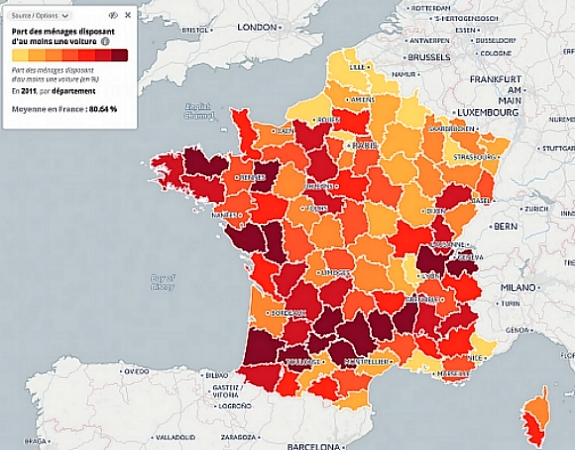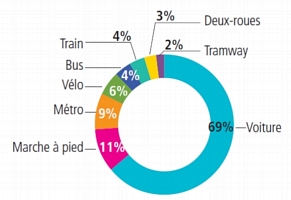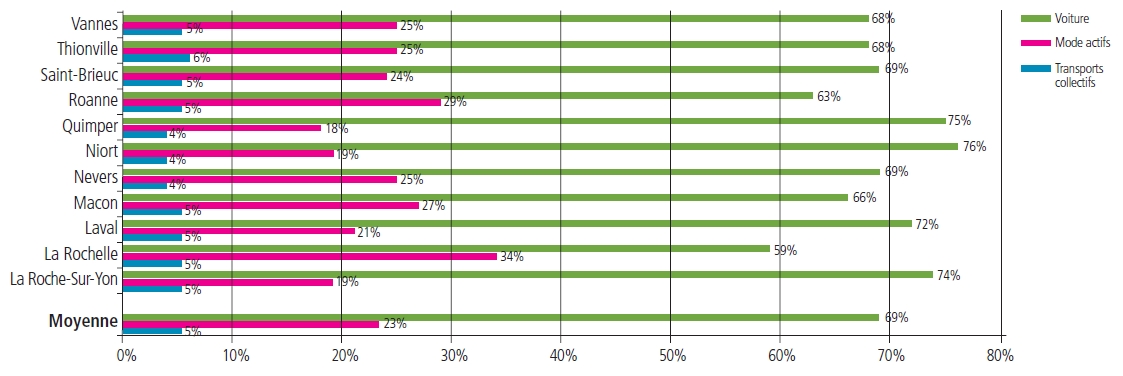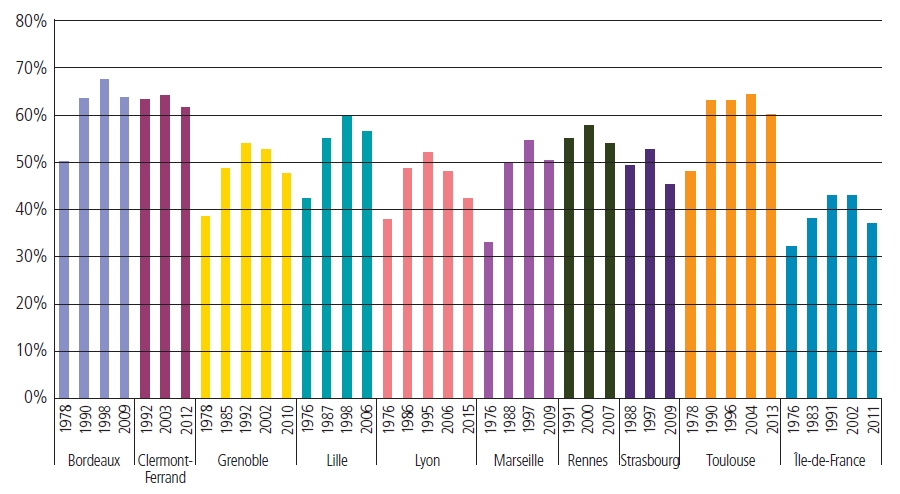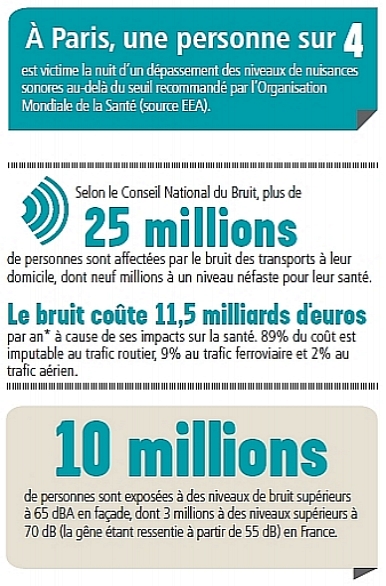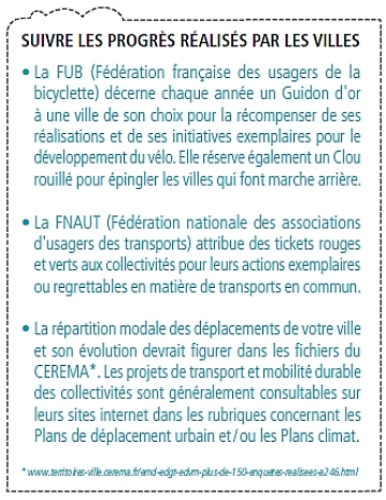|
Donner
aux collectivités locales le déclic pour réguler
le trafic routier et agir sur la pollution de l’air et la réduction
des émissions de gaz
à effet de serre, telle est l’ambition de ce nouveau guide
du Réseau Action Climat. Destiné en particulier aux élus
locaux, il s’adresse à
la multitude d’acteurs impliqués, ou souhaitant s’investir
dans la construction d’une politique de mobilité plus soutenable,
dans le projet
de bâtir des villes qui respirent avec une approche transversale
et multimodale. En plus de dresser un constat des problématiques
liées aux impacts des transports sur la santé et les changements
climatiques, cette publication présente les nouveaux leviers d’actions
qui existent et sont à disposition des collectivités locales
pour mieux réguler l’usage des véhicules motorisés
et polluants
qui causent de nombreuses nuisances en ville et privilégier les
mobilités alternatives.
MOTIVATION
: Pourquoi modérer la place des véhicules motorisés
?
|
|
Les
transports : moteurs des changements climatiques
À l’échelle nationale, les transports constituent
le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre
avec 28% des émissions de gaz à effet de serre en
2014, dont 92% sont imputables aux transports routiers et la moitié
aux voitures. Les émissions sont liées à
la dépendance du mode routier, prédominant dans
le transport de marchandises et de personnes, aux énergies
fossiles.
Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par la
loi de transition énergétique adoptée en
juillet 2015, la Stratégie nationale bas carbone prévoit
une baisse de 70% des émissions de gaz à effet de
serre du secteur des transports d’ici à 2050 et de
29% d’ici à 2028. Cet objectif s’ajoute à
celui de la Loi Grenelle de 2009 de réduire de 20% les
émissions de gaz à effet de serre des transports
d’ici à 2020, pour les ramener au niveau de 1990.
Or, les efforts déployés jusqu’à maintenant
se sont révélés insuffisants pour véritablement
inverser la tendance. La concrétisation de ces objectifs
doit impliquer tous les acteurs.
Au niveau local, la mobilité est également un secteur
d’action prioritaire. À l’échelle des
métropoles le constat est le même : les transports
routiers représentent entre un quart et le tiers des émissions
de gaz à effet de serre rejetées sur leurs territoires
- 30% à Bordeaux, 20% à Lyon -, les voitures particulières
comptant pour 60% des émissions environ.
Dans les petites et moyennes villes, la part du transport routier
dans les émissions de gaz à effet de serre est généralement
encore plus importante. Lutter contre les changements climatiques
à l’échelle locale passe donc nécessairement
par une réduction des déplacements motorisés
en ville.
Il existe un gisement important de report modal vers la marche
à pied, le vélo, et les transports en commun à
l’échelle des courtes distances puisqu’en ville
plus de la moitié des déplacements motorisés
s’étendent sur moins de 3 km. Pour les plus longues
distances, l’intermodalité, ou la possibilité
de passer d’un mode de transport à un autre, sera
déterminante. |
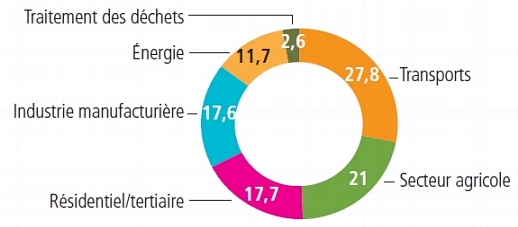
Répartition
des GES par secteur en France en 2013 (en %)
(Source : Inventaire France, périmètre Kyoto, CITEPA/MEDDE,
soumission avril 2014.
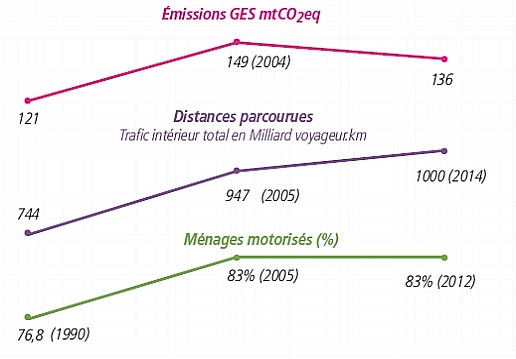
Croissance de mobilité et des émissions de gaz à
effet de serre de 1990 à aujourd'hui
Sources : Insee - SOeS - Inrets, enquêtes
nationales transports et communication 1993-1994, transports et
déplacements 2007-2008. Stratégie nationale de mobilité
propre 2016. Data France.
|
|
La
croissance des émissions du secteur des transports est
directement liée à la sur-motorisation des ménages
et l'accroissement de la mobilité. La part des ménages
possédant deux véhicules est passée de 15
à 30% entre 1980 et 2009. Au total, les distances parcourues
ont augmenté de manière prononcée (+6%)
mais différenciée dans les territoires faiblement
urbanisés (+12% entre 1993 et 2008) et les grandes agglomérations
(-5%).
|
|
|
L’impact
des transports sur la pollution de l’air
Les
polluants atmosphériques
La pollution atmosphérique nous concerne tous, en raison
de ses causes multiples et de ses impacts sur l’environnement
et la santé. Les principaux polluants atmosphériques
nocifs sont :
- Les
particules fines PM10 et PM2,5 causées par les combustions
liées au chauffage, aux transports et aux activités
agricoles.
-
Le dioxyde d’azote (NO2) émis par les combustions
liées au chauffage et aux transports ainsi qu'à
la production d'électricité...
-
Les composants organiques volatiles (COV), des substances
que l’on retrouve dans l’industrie, le secteur
résidentiel tertiaire et les transports, par exemple
le benzène.
-
L’ozone (O3) causé par la réaction chimique
du NO2 et des COV.
De
plus, des particules secondaires qu’il est plus difficile
de mesurer et dont on méconnait les impacts sur la santé,
se créent dans l’air suite à des réactions
chimiques des gaz en présence. |
| |
Le
poids des transports
sur les émissions de polluants
Les transports constituent la première cause des émissions
d'oxydes d'azote NOx dans les zones denses où vivent 80%
de la population et l'une des principales sources de particules
fines. |
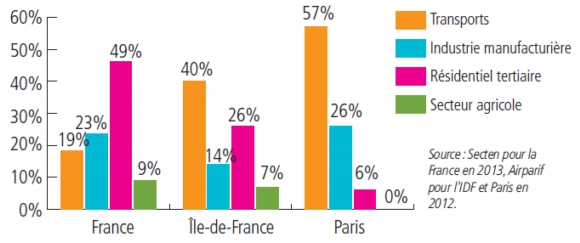 |
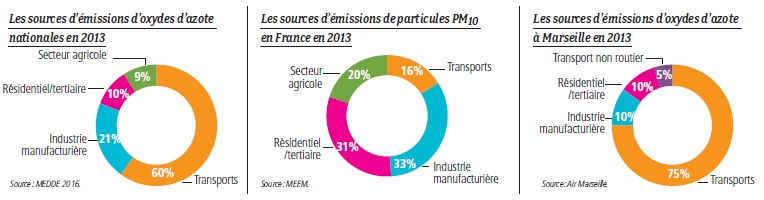 L’exposition
à la pollution de l’air n’est pas uniforme
sur le territoire. La concentration de polluants et par là,
L’exposition
à la pollution de l’air n’est pas uniforme
sur le territoire. La concentration de polluants et par là,
l'exposition de la population à la pollution atmosphérique,
est plus forte dans les zones plus denses
et situées à proximité d’axes routiers
où les émissions sont plus fortes.
|
|
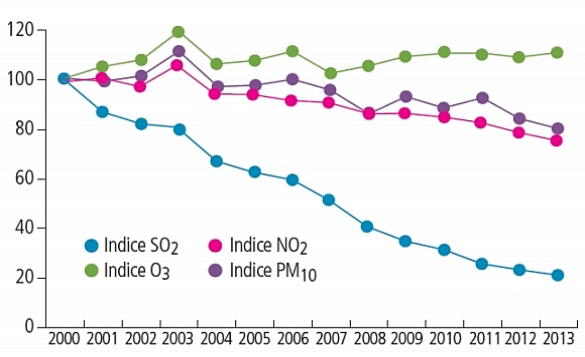
Évolution
des concentrations en SO2, NO2, PM10 et O3 sur la période
2000-2013
Source : Bilan de la qualité de l’air
en France en 2013 et principales tendances observées sur
la période 2000-2013,
CGDD (Commissariat Général au Développement
Durable), octobre 2014.

Les
zones visées par les procédures contentieuses européennes
Source : MEEM, www.developpement-durable.gouv.fr
|
Le
poids des différents véhicules routiers
Le transport routier a une forte responsabilité dans les
émissions de polluants :
-
Les émissions de NOx des transports routiers proviennent
à 89% des véhicules qui roulent au diesel :
poids-lourds diesel 41% ; véhicules particuliers diesel
catalysés 33%, véhicules utilitaires légers
diesel catalysés 15%. Les voitures - à moteur
essence comprises - représentent donc presque la moitié
des émissions de NOx à l’échelle
nationale.
-
Les particules émises par les véhicules diesel
proviennent à 57% des voitures, à hauteur de
27% des véhicules utilitaires et à hauteur de
16% des poids lourds. Les moteurs essence émettent
également des particules fines et des oxydes d'azote.
La
pollution de l’air diminue trop lentement
Sur la période 2000-2014, les niveaux de pollution ont
diminué de façon très modeste :
-
Seule la concentration de dioxyde de soufre a diminué
significativement.
-
Les niveaux de pollution en dioxyde d’azote (NO2) ont
diminué légèrement, mais dans une proportion
inférieure aux émissions d’oxydes d’azote
(NOx).
-
La concentration des particules dans l’air a diminué
très légèrement.
-
Enfin le niveau de concentration de l’ozone (O3) a augmenté.
La
pollution de l’air sévit en France
La France ne respecte ni les plafonds de concentration de polluants
de l’Organisation Mondiale de la Santé, ni les normes
européennes. L'État français s’expose
devant la cour de justice européenne à des amendes
de 10 à 20 millions d'euros pour non-respect des seuils
de pollution en NO2 et PM10.
-
Ozone, PM10 et le NO2 : aucun seuil réglementaire européen
n’est respecté en France en 2013.
-
Plus d’un tiers des agglomérations de plus de
100 000 habitants ont eu au moins un site de mesure qui a
dépassé la valeur limite annuelle de dioxyde
d’azote (NO2) en 2013.
-
En 2011, 12 millions de personnes étaient exposés
aux dépassements des valeurs limites de concentrations
en PM10 en France
|
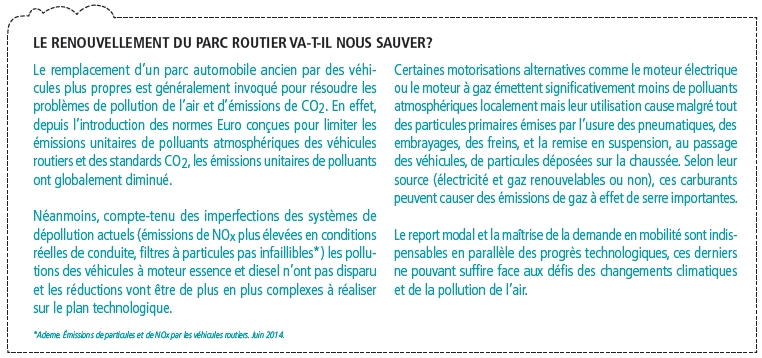
La
pollution de l’air : une catastrophe sanitaire
|
Des
pics de pollution à la pollution chronique
Chaque année, on constate des épisodes et des
pics de pollution à l’ozone, aux particules fines
et au dioxyde d’azote. La population est alors très
attentive à la qualité de l’air. De nouvelles
mesures ont été mises en place en 2016 pour permettre
aux collectivités d’agir plus vite en cas d’épisode
de pollution. Ces derniers représentent aussi une opportunité
d’agir de manière pérenne et acceptée
par la population contre la pollution chronique qui a le plus
d’effets néfastes sur la santé. La pollution
de l’air est la troisième cause de décès
en France. Dans les zones urbaines de plus de 100 000 habitants,
l'espérance de vie à 30 ans est réduite
de 15 mois du fait des PM2,5. Dans les zones rurales, la perte
est estimée à 9 mois d'espérance de vie
en moyenne.
|
Inégaux
face à la pollution
Nous ne sommes pas tous égaux devant les risques de la
pollution. Elle affecte les plus fragiles d’entre nous :
- Les
personnes vulnérables : les nourrissons et les enfants,
les femmes enceintes et les personnes de plus de 65 ans sont
plus fragiles face à la pollution. Des nanotubes de
carbone issus de la pollution atmosphérique ont été
retrouvés dans des poumons d’enfants de 2 mois
à 17 ans. La pollution de l’air a un impact sur
la grossesse, le poids des bébés et les naissances
prématurées. Entre 15 et 30% des nouveaux cas
d’asthme chez les enfants sont liés à
la proximité du trafic routier.
-
Les personnes sensibles - cardiaques, asthmatiques, bronchitiques,
insuffisants respiratoires - sont directement affectées
par les polluants de l’air : leurs troubles sont aggravés.
-
Les personnes à revenus modestes, qui résident
à proximité des axes routiers, sont davantage
exposées à la pollution de l’air. Le risque
de mort subite cardiaque est 38% supérieur pour une
personne habitant à moins de 50 mètres d’un
axe routier. Les nuisances sonores auxquelles ces personnes
sont plus exposées augmentent également les
risques de stress, de troubles de sommeil, de troubles cardiovasculaires,
de baisse des performances cognitives.
-
La double-peine : l'exposition plus forte des personnes modestes
à la pollution voit ses effets démultipliés
par les inégalités socio-économiques
auxquelles ces personnes font déjà face. Ainsi,
une personne de classe modeste est trois fois plus exposée
au risque de décès lors d’un pic de pollution.
Le cumul des facteurs à risques - exposition à
la pollution dans le travail ou l’alimentation par exemple
-, couplé aux conditions de vie, expliquent ce surcroit
d’inégalités. Au-delà des nécessaires
études d'impact environnemental, la réalisation
d'une Évaluation d'Impact en Santé est recommandée
en amont des projets de toute sorte pour anticiper et valoriser
leurs impacts sur la santé et les inégalités.
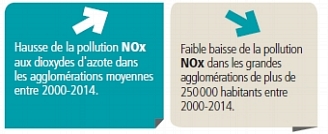
Sources
: France Santé Publique 2016. MEEM Bilan - Qualité
de l’air en France en 2014. |
|
*
Impacts sanitaires de la pollution de l'air en France : nouvelles
données et perspectives 2016 Santé Publique France
(Fusion de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes), l'Institut de veille sanitaire (InVS)
et l'Établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires (Eprus).
** Étude Assessing the link between air pollution and heart
failureanglo-saxonne. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60898-3/abstract
***Par Pr V. L. Feigin, de l'Université de technologie
d'Auckland The Lancet Neurology. 2015. |
|
Qui
paiera la facture ?
La pollution de l’air a un coût astronomique pour
la société, chiffré à plus de 100
milliards d’euros par an par une commission d’enquête
du Sénat en 2015. La prise en charge des soins et des
hospitalisations liés à la pollution de l’air
coûte à elle-seule entre 0,9 à 1,8 milliards
d’euros par an au système de soin.
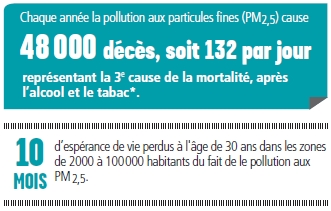
|
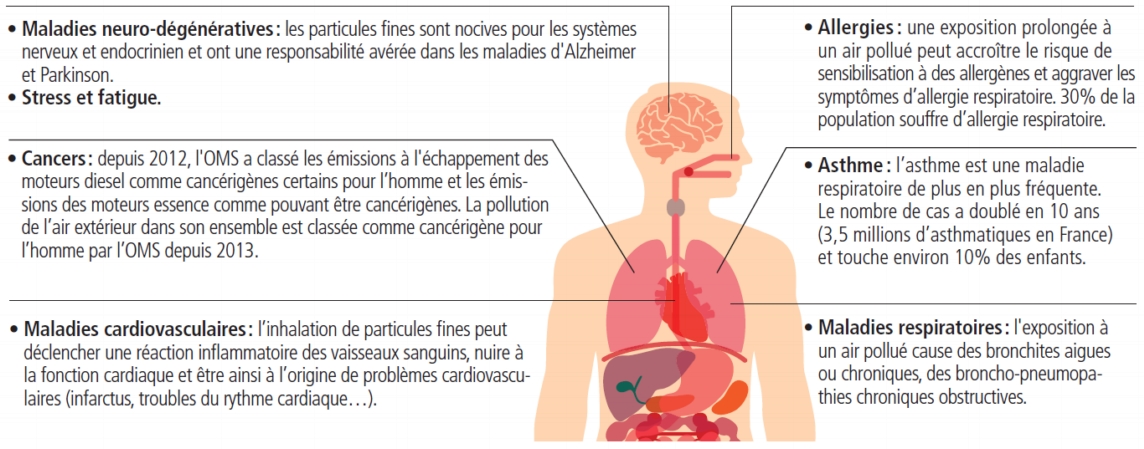 La
pollution de l'air chronique, cause de maladies
La
pollution de l'air chronique, cause de maladies
Les particules, l’ozone et les oxydes d’azote
ont une responsabilité avérée dans les maladies
respiratoires, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.
La baisse des niveaux de pollution de l’air constitue l’un
des leviers d’action majeurs pour la prévention des
maladies respiratoires, cardiovasculaires et des cancers en France.
|

©
Frédéric BISSON
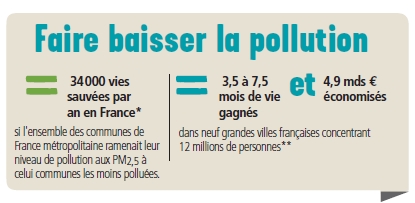
|
Les
interactions entre climat et pollution de l'air
Les émissions de GES et les polluants atmosphériques
sont respectivement responsables de deux phénomènes
aux conséquences très différentes : le
réchauffement de l’atmosphère bouleverse
l’équilibre climatique et la pollution de l’air
est une catastrophe sanitaire. Néanmoins, ces fléaux
sont étroitement liés par leurs causes, et parfois
même dans leurs effets :
-
Les secteurs du chauffage, des transports, de l’industrie,
compte tenu de leur dépendance actuelle aux énergies
fossiles, sont très émetteurs de polluants
atmosphériques et de GES. L’agriculture contribue
aux deux phénomènes en raison de sa consommation
d’engrais azotés notamment.
-
Certains polluants atmosphériques comme l’ozone
et les particules de suie, émis par les véhicules
diesel ont des effets sur les changements climatiques, en
plus d'effets sanitaires directs.
-
En réchauffant l’atmosphère, les effets
des changements climatiques se feront également ressentir
sur la concentration en ozone dont l’impact sur la
santé est considérable.
Agir
à la source permet donc d'améliorer la qualité
de l'air au niveau local tout en ayant un impact global sur
les changements climatiques. Certaines mesures climatiques ont
pu se révéler contre-productives sur le plan de
la qualité de l’air par le passé (le bonus-malus
automobile a contribué à diésélisé
le parc automobile en étant modulé en fonction
des émissions de CO2 /km seulement par exemple10), une
grande vigilance doit être de mise à l’avenir
pour adopter une approche intégrée air-climat
dans la transition énergétique. Ce doit être
le cas au niveau local dans la définition des politiques
et mesures qui seront décidées dans le cadre des
schémas et PCAET.
*Source:
France Santé Publique 2016.
** Résultats du projet Alphekom portant sur Bordeaux,
Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rouen, Strasbourg et
Toulouse.
|
| INSPIRATION
: Participez à la tendance européenne ! |
|
Libérer
la ville de la voiture : Les villes européennes sont en
bonne voie !
Un nombre croissant de villes européennes, petites ou grandes,
a décidé de tourner la page de l’essor automobile
en ville pour diminuer les nuisances liées à la
circulation routière dans les aires urbaines et favoriser
le report modal. Si elles ont conclu à cette nécessité,
la mise en oeuvre concrète s’est faite de manière
très différente d’une ville ou d’un
pays à l’autre et selon des objectifs variés.
Ainsi, la sécurité routière et l'épanouissement
des enfants semblent avoir été l'élément
déclencheur dans le rééquilibrage du partage
de l’espace public aux Pays-Bas alors que les villes allemandes
ont été davantage motivées par les nuisances
sonores et la pollution de l’air dans la mise en oeuvre
des zones à basses émissions. Les villes italiennes,
particulièrement soucieuses de protéger leur patrimoine
historique des suies, ont créé les zones à
trafic limité. Certaines métropoles comme Londres
ou Stockholm ont introduit des péages urbains pour diminuer
la congestion. La France est le 4e pays européen où
l'on se déplace le plus en voiture ou en moto, derrière
la République Tchèque, la Slovénie et la
Lettonie (Gallup-Eurobaromètre 2011), mais la répartition
modale des déplacements varie d’une ville à
l’autre et certaines collectivités sont à
l'avant-garde. Voici quelques exemples qui annoncent des évolutions
positives pour le climat, la santé et la qualité
de vie. |
|
Oslo,
Norvège
Oslo va interdire tous les véhicules diesel en centre-ville
dès 2017 sur l’intégralité de la voirie
locale en vue de bannir toutes les voitures thermiques du centre-ville
et de réduire de 50% les émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2020. La ville prévoit aussi
une centaine de kilomètres de pistes cyclables supplémentaires,
la suppression de nombreuses places de parkings en surface et
un péage additionnel au péage urbain existant pour
limiter la circulation et la congestion pendant les heures de
pointe. |
|
|
|
En
Allemagne
Il y a une soixantaine de zones à basses émissions
en Allemagne. En Rhénanie du nord et en Westphalie tous
les véhicules diesels antérieurs à 2011 sont
interdits dans les zones vertes. Au total, 500 000 véhicules
sont concernés par l'interdiction. 28 des villes de plus
de 100 000 habitants ne sont pas encore couvertes par une zone
à basses émissions en Allemagne.
Hambourg
Hambourg a décidé de bannir la voiture sur différentes
artères pour la faire disparaître totalement du centre-ville
d’ici à 2034. La ville sera bientôt maillée
d’un réseau de voies piétonnes et cyclables
reliant tous les parcs de la ville et recouvrant 40% de sa superficie.
Bruxelles,
Belgique
Connue pour ses embouteillages, Bruxelles est passée au
rang de première ville piétonne grâce à
l’extension de son hyper-centre piéton en 2015, sur
le principal axe de circulation Nord-Sud. À l’issue
de la phase d’expérimentation, la commune a décidé
de pérenniser la mesure en revoyant certaines de ses modalités
pour mieux tenir compte de flux de circulation et de l'avis des
commerçants.
Ljubljana,
Slovénie
La ville de Ljubljana a pris le virage de la piétonisation
il y a 10 ans en fermant complètement son centre-ville
aux voitures, occasionnant une véritable transformation
des rues : la part modale de la voiture est passée de 47%
en 2003 à 19% en 2013, la marche à pied devenant
le premier mode de déplacement dans le centre. Les émissions
de particules de suie ont chuté de 70% suite à la
requalification de l’avenue principale en centre piéton,
tandis que le soutien de la population est quasi unanime (92%).
En
Italie
Une quarantaine de zones à trafic limité ont été
mises en place depuis la fin des
années 1980 pour limiter fortement la circulation routière
en réservant l’accès au centre-ville aux résidents,
aux services d’urgence et aux transports en commun. Dans
les petites, moyennes et grandes villes concernées, la
mise en oeuvre de cette mesure est allée de paire avec
l’essor du vélo et de la marche à pied. |
|
Grenoble
En 2015, la métropole de Grenoble a lancé en 2015
son opération Métropole Apaisée avec la réduction
généralisée des vitesses en ville à
30 km/h dans 43 des 49 communes. L’aménagement d’un
réseau express vélo (REV) est prévu pour
conforter ses actions pour la qualité de l’air. Une
agence de mobilité a été créée
en ville pour mettre à disposition des habitants des conseils
en mobilité, et a été déclinée
de manière virtuelle avec la création d’un
système d’information multimodal et en temps réel. |
Paris
La capitale a adopté en 2015 un plan anti-pollution visant
à restreindre progressivement la circulation des véhicules
les plus polluants d’ici à 2020 et un plan vélo
ambitieux. Devant le succès de la transformation des voies
sur berges de la rive gauche en 2013, la ville poursuit également
la piétonisation sur la rive droite où circulent chaque
jour des milliers de voitures. La mairie ambitionne également
de passer la moitié de la voirie parisienne à 30 km/h
d’ici la fin de 2016. |
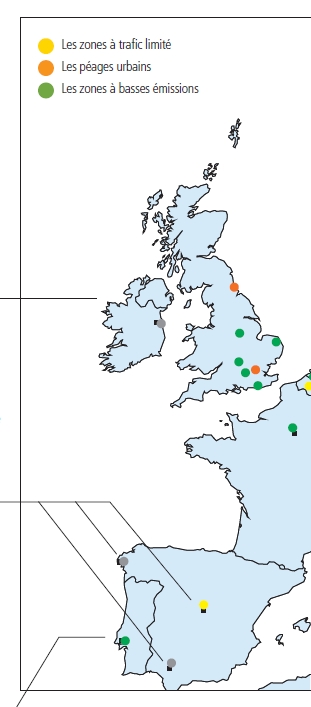
Lisbonne, Portugal
Lisbonne a mis en oeuvre une zone à basses émissions
où les véhicules les plus polluants sont interdits.
La concentration de PM10 a diminué de 16% en moyenne entre
2011 et 2012, ce qui a permis de passer en deçà des
plafonds réglementaires dans cette zone centrale de la capitale
ibérique. Le nombre de jours de dépassement de la
limite en PM10 est passé de 113 jours en 2011 à 75
jours en 2012 et 32 jours en 2014. Les effets des zones à
basses émissions sont immédiats.
|
|
Dublin,
Irlande
Dublin a décidé de faire la part belle aux transports
en commun et aux mobilités actives en interdisant à
tous les véhicules de circuler en centre-ville d’ici
à 2017. Dans une ville connue pour la difficulté
de circuler à pied ou en vélo, en raison notamment
d’une forte congestion routière (Tom Tom trafic place
Dublin au 10e rang mondial des villes les plus congestionnées),
cette nouvelle politique volontariste est bien accueillie.
Madrid,
Espagne
Le nouveau plan de mobilité de la capitale espagnole a
pour objectif la piétonisation
progressive du centre-ville d’ici à 2020. Marid a
décidé d’activer plusieurs leviers en augmentant
les tarifs du stationnement et en abaissant les limitations de
vitesses. Surtout, les véhicules motorisés (notamment
les deux-roues motorisés) des non-résidents ont
été interdits de circulation, sauf sur certains
horaires, pour atteindre l’objectif d’une baisse d’un
tiers du trafic routier dans le centre-ville. Enfin, les voies
de bus en site propre gagnent du terrain.
Pontevedra,
Espagne
En 1999, le maire de Pontevedra a décidé de fermer
le centre-ville aux voitures et de requalifier l’espace
public au profit des piétons. Cette politique a porté
ses fruits puisqu’aujourd’hui 66% des déplacements
sont effectués à pied ou à vélo et
le trafic routier a baissé de 90%. Le nombre d'accidents
a été divisé par 3 entre 2000 et 2014. La
pollution atmosphérique a baissé de 61% et les émissions
de CO2 de 66%.
Séville,
Espagne
Séville est la démonstration même que le développement
rapide et massif du vélo en ville n’est pas réservé
qu’aux pays nordiques. En 2010, l’aménagement
de 120 km d’infrastructures cyclables réalisé
pour un coût de 53 millions d’euros pour la ville,
a entrainé un report modal important, composé pour
un tiers d'automobilistes mais aussi d'anciens motards (5,4%).
Le vélo est utilisé dans 7% des déplacements
en 2013, contre 0,5 en 2006. |
|
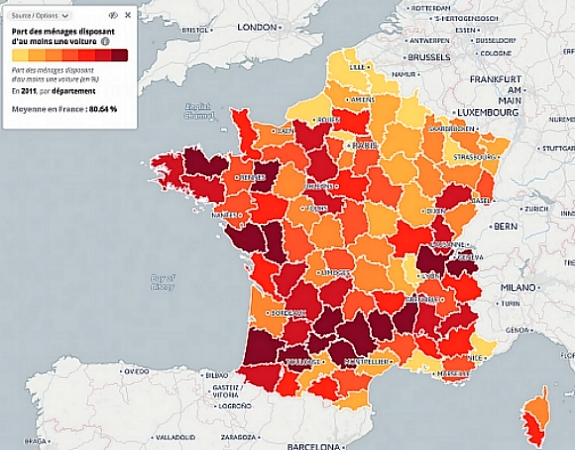
Taux de motorisation des ménages dans les
départements de France
Source : http://map.datafrance.info
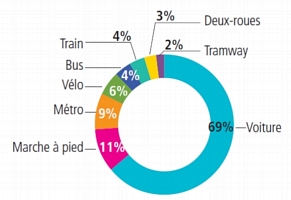
Parts modales des déplacements domicile-travail
|
Pourquoi
pas nous ? Le retard et le potentiel français
Quelle
place prend la voiture en France ?
Dans le coeur des gens
Même si la population reste globalement attachée
à la voiture, le regard et les usages évoluent,
notamment chez les jeunes générations dont le
taux de détention du permis de conduire a cessé
de progresser pour redescendre, en 2012, en deçà
du niveau de 1992 / 76% chez les 18-29 ans en 2012.
Les sondages réalisés ces dernières années
sont éclairants sur l’attachement des gens à
la voiture. Plus des deux-tiers d’entre eux :
-
Veulent diminuer la place de la voiture en ville.
-
Aimeraient combiner plus facilement voiture et les autres
modes de transports.
-
Sont prêts à utiliser leur voiture différemment
: autopartage, covoiturage.
-
Pensent que la voiture est très nuisible à l’environnement.
- Cherchent
avant tout à faire des économies pour tout ce
qui concerne leur véhicule.
Dans l'équipement des ménages
Le taux de motorisation des ménages, certes encore très
élevé, a tendance à diminuer, surtout dans
les métropoles. À l’échelle nationale,
19% des ménages n’ont pas de voiture, un taux qui
s’élève à 67% en Île-de-France
et tombe à 13% en Poitou-Charente. Plus la ville est dense,
moins la population est équipée de véhicules
motorisés mais les villes moyennes ne sont pas toutes dans
la même situation. Ainsi à Chambéry, un quart
des ménages n’a pas de voiture, tout comme 31% des
ménages de Sedan.
Dans
les villes moyennes, 42% des ménages possèdent au
moins deux véhicules contre 29% dans les grandes agglomérations.
Le taux de motorisation est aussi largement lié au revenu,
à l’âge du chef de ménage,
à la catégorie socioprofessionnelle, aux zones d’habitation
et au nombre de personnes composant le ménage. L’âge
moyen de l’acheteur d’une voiture neuve augmente d’année
en année pour s’élever à 54 ans en
2015.
La
voiture individuelle est choisie dans 69% des déplacements
domicile-travail (INSEE) |
|
Dans
les déplacements, selon les villes
La voiture est utilisée dans 65% des cas de déplacement
local pour des raisons de confort, de flexibilité horaire,
mais aussi de gain de temps. Or, 50% des trajets faits en automobile
en ville sont inférieurs à 3 km, 15% sont inférieurs
à 500 m. Sur des distances aussi courtes, les véhicules
sont particulièrement polluants, le moteur n’ayant
pas le temps de se réchauffer et d'autres modes déplacement
sont plus pertinents et plus rapides.
La part de la voiture dans les déplacements est passée
en dessous de 50% dans certaines grandes agglomérations
comme Strasbourg, Lyon et Grenoble, tandis qu’elle reste
prépondérante dans d’autres grandes villes
comme Lille (56%), Rennes (54%) Marseille (50%).
Dans les villes moyennes, la place de la voiture est particulièrement
ancrée, étant encore utilisée dans 69% des
déplacements en moyenne, la marche à pied représentant
23% des déplacements, les transports en commun 5% et le
vélo et les deux roues motorisés 2% respectivement.
La part modale de la voiture se situe encore au-dessus de 70%
dans plusieurs villes moyennes comme Albi, Quimper, Niort…
Mais dans certaines villes comme La Rochelle, elle est en-deçà
de 60%.
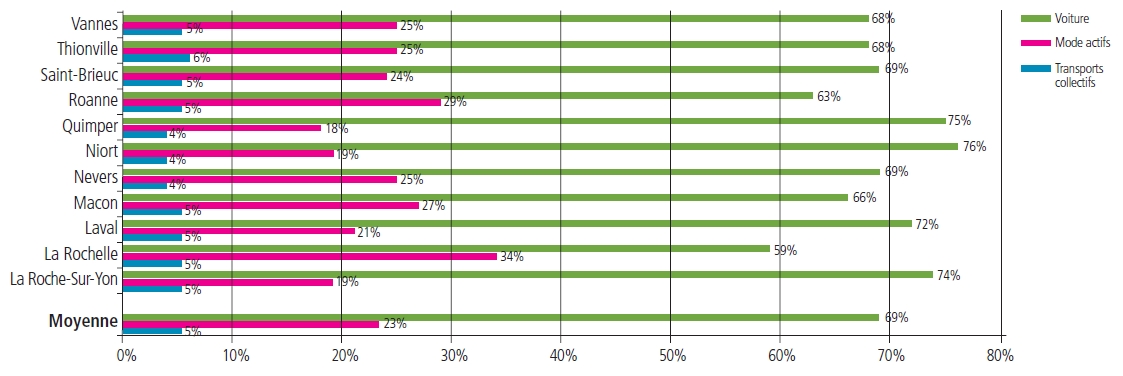
Part
modale de la voiture dans les agglomérations moyennes
Source : CEREMA, enquêtes ménages
déplacements dans les villes moyennes, 2014.
|
|
Et
petit à petit, dans les faits… les villes changent
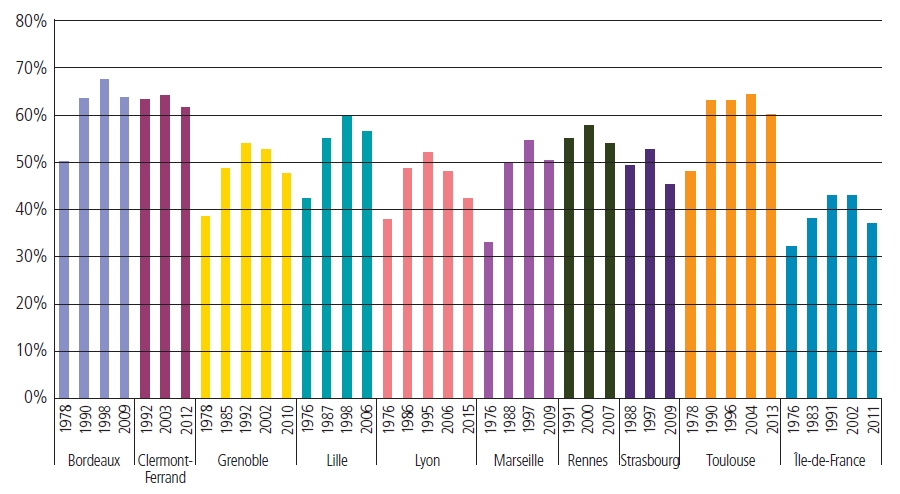
Évolution
de la part modale de la voiture dans les grandes agglomérations
Source : CEREMA,
DT ec TV.
|
|
D’un
côté, l’utilisation de la voiture baisse à
un rythme soutenu dans différentes agglomérations
et devance même parfois les politiques de mobilité
durable.
- À
Paris, le trafic automobile a diminué de 30% entre
2001 et 2014 grâce notamment aux nouveaux tramways,
à la régulation du stationnement et au système
de vélos en libre-service.
- La
tendance est similaire à Lyon où la part modale
de la voiture dans les déplacements est descendue sur
l’aire métropolitaine de 58 à 53% et de
35 à 26% sur le centre de l’agglomération
- communes de Lyon et Villeurbanne - entre 2006 et 2015. Dans
cette zone, le taux de motorisation des ménages est
passé de 0,93 à 0,75, soit une baisse de 20%
en moins de 10 ans.
De
l’autre, un certain nombre d’agglomérations
ont fait marche arrière sur la mobilité durable
depuis les élections municipales en 2014 :
-
9 villes ont remis en cause leur projet de transports collectifs
en site propre.
- 6
villes ont supprimé des couloirs réservés
aux bus ou aux cyclistes.
- 8
villes ont rendu le stationnement gratuit.
- 10
villes ont restauré des parkings en centre-ville sur
des espaces piétons.
Une
ville avec moins de trafic routier est apaisée
Les transports routiers sont fortement responsables des nuisances
sonores et des effets sur la santé associés. Les
transports constituent en effet la première source de bruit
dans la ville et sont sources d’impacts sur l’audition,
la qualité du sommeil, les facultés d’apprentissage,
les maladies cardiovasculaires, le stress. Selon une étude
de l’Observatoire régional de santé Île-de-France
et Bruitparif, les Franciliens perdent chaque année 75
000 années de vie en bonne santé rien qu’à
cause du bruit des transports. Cette catastrophe sanitaire a aussi
un coût : 3,8 milliards d’euros par an !
La rue aux enfants
Alors que l’espace de vie des enfants est limité
du fait des insécurités routières en ville,
ralentir voire restreindre la circulation routière tout
en requalifiant l’espace public au profit d'usages variés
de la voirie - piétonisation, espaces verts - se fait au
bénéfice des enfants qui disposent alors d'un espace
apaisé et sécurisant pour les parents et propice
à leur développement personnel.
Toutes les villes sont désormais à un tournant
Si la voiture ne peut être entièrement bannie des
villes, la mobilité durable ne peut rester l’apanage
des seules grandes agglomérations et des métropoles
dont les capacités financières ont permis d’investir
dans les projets des transports collectifs lourds : métros,
tramways, RER.
Les agglomérations et les villes moyennes ont pour défi
de requalifier l’espace urbain au profit des mobilités
alternatives à la voiture individuelle, de rapprocher le
périurbain des pôles générateurs de
déplacements, grâce à un urbanisme plus dense
et axé sur la mixité fonctionnelle et les stations
de transports publics et les gares.
Agir pour la qualité de l’air et contre les changements
climatiques au niveau local en choisissant de modérer la
circulation routière concourt à rendre la ville
plus calme, moins congestionnée et à protéger
l’environnement. |
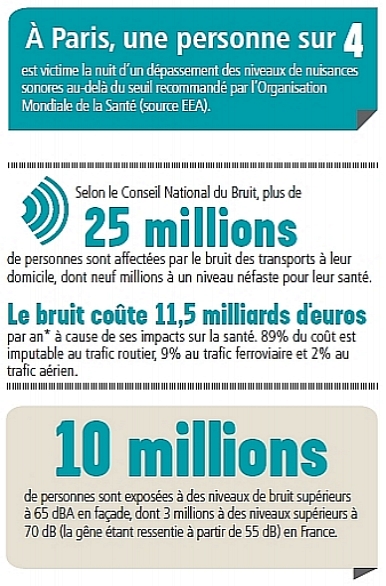
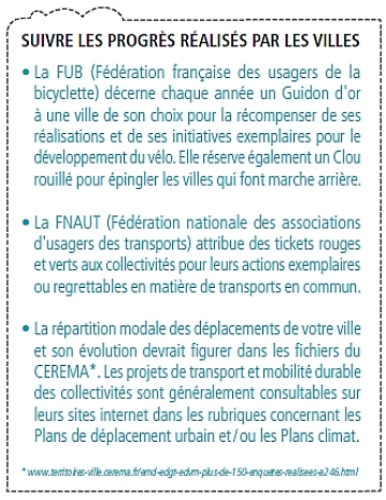
|
Les villes Respire de
demain : agir sur la mobilité et les transports pour
faire face à l'urgence sanitaire et climatique
Basé en large partie sur le transport
routier, notre modèle de transports est à bout
de souffle : premier secteur d'émissions de gaz à
effet de serre en
ville et l'une des principales causes de pollution de l'air,
la prédominance du tout voiture a un coût élevé
pour les acteurs économiques, les citoyens et la collectivité
toute entière. Fort heureusement, les collectivités
territoriales disposent d'un nombre croissant d'outils pour
agir à la source et modérer la place des véhicules
motorisés et polluants au profit des mobilités
alternatives, qu'elles soient actives comme le vélo et
la marche à pied ou collectives et partagées.
Comment assumer ses responsabilités tout en bâtissant
des villes où il fait bon respirer en emportant le soutien
de la population locale ? Les solutions favorables au report
modal ne manquent pas. Elles n'attendent que vous pour être
concrétisées dans les territoires !
|
Le
Réseau Action Climat-France
Association spécialisée sur le thème des
changements climatiques, regroupant 15 associations nationales
de protection de l’environnement,
de solidarité internationale, d’usagers des transports
et d’alternatives énergétiques, elle est
le représentant français
du Climate Action Network International, fort de 900
associations membres dans le monde.
Les
missions du rac sont :
-
Suivre les engagements et les actions de l'État et
des collectivités locales en ce qui concerne la lutte
contre les changements climatiques.
-
Dénoncer les lobbies et les États qui ralentissent
ou affaiblissent l'action internationale.
-
Proposer des politiques publiques cohérentes avec les
engagements internationaux de la France
|
 Les
villes Respire de demain
Les
villes Respire de demain
Rédactrice
: Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports
au Réseau Action Climat France
Graphisme : solennmarrel.fr
Remerciements
:
Aux membres du Comité de pilotage pour leurs précieux
conseils.
Aux experts du service de la Qualité de l'air et
du service Transports et mobilités de l'Ademe ainsi
qu'aux membres du Réseau Action Climat pour leur
relecture attentive.
|
| |
Les
villes Respire
de demain |
|
Comité de pilotage :
Mohamedou
Ba, Marie Pouponneau, Ademe
Silvano Domergue, Stéphane Taszka, Commissariat Général
au Développement Durable
Marie Molino, Groupement des Autorités Responsables
des Transports
Bernadette Humeaux, Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette
Marie Larnaudie, Plaine Commune
Charlotte Marchandise, ville de Rennes, réseau des
villes-santé de l'OMS
Experts
du service de la Qualité de l'air et du service Transports
et mobilités de l'Ademe :
Nathalie
Martinez et Bertrand-Olivier Ducreux
Membres
du Réseau Action Climat :
Morgane
Creach, Charlotte Isard, Meike Fink
Bruno Gazeau, Fédération Nationale des Associations
d'Usagers des Transports
Olivier Schneider, Fédération Française
des Usagers de la Bicyclette |
|
|
|
|
|
|
|
![]() Les villes Respire de demain
Les villes Respire de demain